The Project Gutenberg EBook of Rťcits d'une tante (Vol. 2 de 4), by
Louise-Elťonore-Charlotte-Adťlaide d'Osmond, comtesse de Boigne
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Rťcits d'une tante (Vol. 2 de 4)
Mťmoires de la Comtesse de Boigne, nťe d'Osmond
Author: Louise-Elťonore-Charlotte-Adťlaide d'Osmond, comtesse de Boigne
Release Date: May 12, 2010 [EBook #32348]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK R…CITS D'UNE TANTE (VOL. 2 DE 4) ***
Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by the
BibliothŤque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr) and Internet Archive.
M…MOIRES
DE LA
COMTESSE DE BOIGNE
II
_Il a ťtť tirť de cet ouvrage
mille exemplaires sur vergť teintť des Papeteries
de Corvol-l'Orgueilleux
tous numťrotťs._
Nļ
[Illustration: H…L»NE DILLON, MARQUISE D'OSMOND,
M»RE DE LA COMTESSE DE BOIGNE,
d'aprŤs un portrait de J. Isabey
(Collection de Mademoiselle Osmonde d'Osmond).]
R…CITS D'UNE TANTE
M…MOIRES DE LA COMTESSE DE BOIGNE N…E D'OSMOND
PUBLI…S INT…GRALEMENT D'APR»S LE MANUSCRIT ORIGINAL
II
_1815.--L'Angleterre et la France de 1816 ŗ 1820._
_PARIS_
…MILE-PAUL FR»RES, …DITEURS
100, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONOR…
1921
CINQUI»ME PARTIE
1815
CHAPITRE I
Sťjour en Piťmont. -- Restauration de 1815. -- Passage ŗ Lyon. --
Marion. -- Arrivťe ŗ Turin. -- Dispositions du Roi. -- Son
gouvernement. -- Le cabinet d'ornithologie. -- Le comte de
Roburent. -- Les _Biglietto regio_. -- La sociťtť. -- Le lustre.
-- Les loges. -- Le thť‚tre. -- L'Opťra. -- Dťtails de moeurs. --
Le marquis del Borgo.
J'ai toujours pensť que, pour conserver de la dignitť ŗ son existence,
il fallait la diriger dans le sens d'une principale et persťvťrante
affection et que le dťvouement ťtait le seul lien de la vie des
femmes. N'ayant ťtť, de fait, ni ťpouse ni mŤre, je m'ťtait
entiŤrement donnťe ŗ l'amour filial. Quelque rťpugnance que j'eusse ŗ
la carriŤre que mon pŤre venait de reprendre, ŗ la rťsidence oý on
l'envoyait, et malgrť ma complŤte indťpendance de position, je ne me
rappelle pas avoir ťprouvť un instant d'hťsitation ŗ le suivre. Ce
souvenir, placť ŗ une distance de vingt annťes, m'est doux ŗ
retrouver.
Nous nous arrÍt‚mes trois jours ŗ Lyon. Je me rappelle une
circonstance de ce sťjour dont je fus trŤs touchťe. Ma femme de
chambre, qui ťtait lyonnaise, me pria de lui donner quelques heures de
libertť pour aller voir un ancien ami de son pŤre. Le lendemain,
pendant que je faisais ma toilette, on vint la demander. Elle avait
fait appeler des marchands d'ťtoffes pour moi et s'informa si c'ťtait
eux qui attendaient; on lui rťpondit que c'ťtait une vieille paysanne
n'ayant qu'un bras.
ęOh! fit-elle, c'est la bonne Marion? c'est bien beau, son bras,
allez, madame! Ma mŤre nous l'a souvent fait baiser avec respect.Ľ
Cette phrase excita ma curiositť, et j'obtins le rťcit suivant:
ęMadame sait que mon pŤre ťtait libraire du Chapitre et vendait
principalement des livres d'ťglise, ce qui le mettait en relation avec
les ecclťsiastiques. Parmi eux, monsieur Roussel, curť de Vťriat,
venait le plus ŗ la maison; mon pŤre allait souvent chez lui et ils
ťtaient trŤs amis.
ęLors de la Terreur, tous deux furent arrÍtťs et jetťs dans la mÍme
prison. Marion, servante de monsieur Roussel, et bien attachťe ŗ son
maÓtre, quitta le village de Vťriat, et vint ŗ Lyon pour se rapprocher
de lui. Ma mŤre lui donna un asile chez nous oý, comme Marion, nous
ťtions trŤs inquiets et trŤs malheureux, manquant de pain encore plus
que d'argent et ayant bien de la peine ŗ trouver de quoi manger.
Cependant Marion parvenait, ŗ force d'industrie, ŗ se procurer chaque
jour un petit panier de provisions qu'elle rťussissait ordinairement ŗ
faire arriver jusqu'ŗ monsieur Roussel.
ęUn matin oý elle avait ťtť brutalement repoussťe, sa persťvťrance ŗ
rťclamer l'entrťe de la prison ayant impatientť un des sans-culottes
qui ťtait de garde, il s'avisa de dire qu'assurťment son panier
contenait une conspiration contre la Rťpublique et voulut s'en
emparer. Marion, prťvoyant le pillage de son pauvre dÓner, voulut le
dťfendre. Alors un de ces monstres, un peu plus tigre que les autres,
s'ťcria: ęHť bien! nous allons voirĽ, et il abattit d'un coup de sabre
le bras qui tenait le panier. Les ťclats de rire accueillirent cette
action. La pauvre Marion, laissant sa main et la moitiť de son
avant-bras sur le pavť de la prison, serra sa plaie sanglante dans son
tablier et revint chez nous. Ma mŤre lui donna les premiers soins,
tandis qu'on alla chercher un chirurgien pour la panser. Elle montra
une force et un courage prodigieux. BientŰt aprŤs, ma mŤre la vit
chercher un autre panier et le remplir de nouvelles provisions.
ęQue faites-vous lŗ, Marion?
ę--Eh bien donc, j'arrange le dÓner pour monsieur.
ę--Mais, Marion, vous ne pensez pas retourner lŗ-bas.
ę--Eh! il n'y pas dťjŗ tant si loin.Ľ
ęEnfin, quoi qu'on lui pŻt dire, elle partit, mais rentra au bout
d'une minute.
ęVous voyez bien, Marion, que vous n'ťtiez pas en ťtat d'aller, lui
dit ma mŤre, en lui avanÁant une chaise.
ę--Si fait bien! merci; mais, madame Vernerel, je voudrais que vous
m'arrangiez ce linge roulť au bout du bras pour y donner la longueur,
parce que, si monsieur s'apercevait qu'il manque, cela pourrait lui
faire de la peine et qu'il en a dťjŗ bien assez, le pauvre cher
homme.Ľ
ęMa mŤre, touchťe jusqu'aux larmes, obťit ŗ Marion. Celle-ci fit ŗ
monsieur Roussel l'histoire d'un panaris au doigt qui expliquait son
bras en ťcharpe. Elle ne cessa pas un seul jour ses pieux soins; il
n'apprit qu'ŗ sa sortie de prison la perte de son bras.Ľ
On peut croire que j'ťprouvai un vif dťsir de voir l'admirable Marion.
J'entrai dans la chambre oý elle se trouvait, apportant un petit
cadeau d'oeufs frais et de fromage ŗ la crŤme pour sa chŤre enfant,
comme elle appelait mademoiselle Louise. C'ťtait une vieille paysanne,
grande, maigre, ridťe, h‚lťe jusqu'au noir, mais encore droite et
conservant l'aspect de la force.
Je la questionnai sur l'aventure qu'on venait de me raconter et j'eus
la satisfaction qu'elle ne se doutait pas avoir ťtť sublime. Elle
paraissait presque contrariťe de mon admiration et n'ťtait occupťe
qu'ŗ se disculper d'avoir trompť monsieur le Curť.
ęMais, disait-elle, c'est qu'il est si bÍte, ce brave homme, ŗ se
faire du mal, ŗ se tourmenter pour les autres!Ľ
Et, comme je la rassurais de mon mieux sur ce pieux mensonge:
ęAu fait, monsieur le Curť m'a dit depuis qu'il m'aurait dťfendu de
revenir s'il avait su cette drŰlerie, reprit-elle en regardant son
bras; ainsi j'ai bien fait tout de mÍme de le tromperĽ, et elle partit
d'un ťclat de rire de franche gaietť.
Mademoiselle Louise me dit: ęEt Marion, madame, n'en fait pas moins
bien le mťnage et la bonne soupe que j'ai mangťe hier.Ľ
Marion sourit ŗ ces paroles flatteuses, mais, hochant la tÍte ęAh!
dame, non, ma chŤre enfant; je ne suis pas si habile qu'avant, mais ce
pauvre cher homme du bon Dieu, Áa ne s'impatiente jamais.Ľ J'ai
regrettť de n'avoir pas vu monsieur Roussel. L'homme ęassez bÍteĽ,
comme disait Marion, pour inspirer un pareil dťvouement devait Ítre
bien intťressant a connaÓtre.
Nous arriv‚mes ŗ Turin au moment oý la sociťtť y ťtait le plus
dťsorganisťe. Le Roi n'avait rapportť de Cagliari qu'une seule pensťe;
il y tenait avec l'entÍtement d'un vieil enfant: il voulait tout
rťtablir comme en _Novant-ott_. C'ťtait sa maniŤre d'exprimer, en
patois piťmontais, la date de 1798, ťpoque ŗ laquelle il avait ťtť
expulsť de ses …tats par les armťes franÁaises.
Il en rťsultait des consťquences risibles: par exemple, ses anciens
pages reprenaient leur service ŗ cŰtť des nouveaux nommťs, de sorte
que les uns avaient quinze ans et les autres quarante. Tout ťtait ŗ
l'avenant. Les officiers, ayant acquis des grades supťrieurs, ne
pouvaient rester dans l'armťe qu'en redevenant cadets. Il en ťtait de
mÍme dans la magistrature, dans l'administration, etc. C'ťtait une
confusion oý l'on se perdait. La seule exception ŗ la loi du
_Novant-ott_ et, lŗ, le bon Roi se montrait trŤs facile, ťtait en
faveur de la perception des impŰts: ils ťtaient triplťs depuis
l'occupation des franÁais, et Sa Majestť sarde s'accommodait fort bien
de ce changement.
Le Roi avait ramenť tous les courtisans qui l'avaient suivi ŗ Cagliari
pendant l'ťmigration. Aucun n'ťtait en ťtat de gouverner un seul jour.
D'une autre part, l'empereur Napolťon avait, selon son usage, ťcrťmť
le Piťmont de tous les gens les plus distinguťs et les avait employťs
dans l'Empire, ce qui, aux yeux du Roi, les rendait incapable de le
servir. L'embarras ťtait grand.
On alla rechercher un homme restť en dehors des affaires mais qui ne
manquait pas de moyens, le comte de Valese, enfermť depuis nombre
d'annťes dans son ch‚teau du val d'Aoste. Il y avait conservť bon nombre
de prťjugťs et d'idťes aristocratiques et contre-rťvolutionnaires, mais
pourtant c'ťtait un libťral en comparaison des arrivants de Sardaigne.
Il lui fallait encore les mťnager, et je crois qu'il a bien souvent
rougi des concessions qu'il ťtait obligť de faire ŗ leur ignorance.
Dans sa passion pour revenir au _Novant-ott_, le Roi voulait dťtruire
tout ce qui avait ťtť crťť par les franÁais et, entre autres,
plusieurs collections scientifiques. Un jour, on lui demanda gr‚ce
pour celle d'ornithologie qu'il avait visitťe la veille et dont il
semblait ravi; il entra dans une grande colŤre, dit que toutes ces
innovations ťtaient oeuvres de Satan.... Ces cabinets n'existaient pas
en _Novant-ott_, et les choses n'en allaient pas plus mal.... Il
n'ťtait nul besoin d'Ítre plus habile que ses pŤres.... Sa verve
ťpuisťe, il ajouta qu'il n'admettrait d'exception que pour les
oiseaux; ils lui plaisaient, il voulait qu'on en prÓt grand soin. La
partie sarde du Conseil approuva l'avis du Roi. Monsieur de Valese et
monsieur de Balbe se turent en baissant les yeux. La destruction du
cabinet d'ornithologie et la conservation de celui des oiseaux passa ŗ
l'immense majoritť.
Ces niaiseries, dont je ne rapporterai que celle-lŗ mais qui se
renouvelaient journellement, rendaient le gouvernement ridicule, et,
lorsque nous arriv‚mes ŗ Turin, il ťtait dans le plus haut degrť de
dťconsidťration. Depuis, l'extrÍme bonhomie du Roi lui avait rendu une
sorte de popularitť, et la nťcessitť l'avait forcť, de son cŰtť, ŗ
tempťrer les dispositions absurdes rapportťes de Cagliari. Il fallait
en revenir aux personnes dont le pays connaissait et apprťciait le
mťrite, lors mÍme qu'elles n'auraient pas passť vingt-cinq annťes de
leur vie dans l'oisivetť.
Monsieur de Valese avait bien un peu de peine ŗ s'associer des gens
avec lesquels il avait ťtť longtemps en hostilitť: peut-Ítre mÍme
craignait-il que les rťpugnances, une fois complŤtement surmontťes, on
ne trouv‚t parmi ceux qui avaient servi l'Empereur des capacitťs
supťrieures ŗ la sienne. Cependant, comme il ťtait homme d'honneur et
voulant le bien, il engageait le Roi ŗ confier les places importantes
aux personnes en ťtat de les faire convenablement et chaque jour
apportait quelque amťlioration aux premiŤres extravagances.
L'absence de la Reine, restťe en Sardaigne, rendait le Roi plus
accessible aux conseils de la raison. Cependant elle avait dťlťguť son
influence ŗ un comte de Roburent, grand ťcuyer et espŤce de favori
dont l'importance marquait dans cette Cour. C'ťtait le reprťsentant de
l'ťmigration et de l'ancien rťgime, avec toute l'exagťration qu'on
peut supposer ŗ un homme trŤs bornť et profondťment ignorant. Je me
rappelle qu'un jour, chez mon pŤre, on parla du baptÍme que les
matelots font subir lorsqu'on passe la ligne; mon pŤre dit l'avoir
reÁu; monsieur de Roburent reprit avec un sourire bien gracieux:
ęVotre Excellence a passť sous la ligne; vous avez donc ťtť
ambassadeur ŗ Constantinople?Ľ
Il y avait alors trois codes ťgalement en usage en Piťmont; l'ancien
code civil, le code militaire qui trouvait moyen d'ťvoquer toutes les
affaires, et le code Napolťon. Selon que l'un ou l'autre ťtait
favorable ŗ la partie protťgťe par le pouvoir, un _Biglietto regio_
enjoignait de s'en servir; cela se renouvelait ŗ chaque occasion. ņ la
vťritť, si cette prťcaution ťtait insuffisante, un second _Biglietto
regio_ cassait le jugement et, sans renvoyer devant une autre cour,
dťcidait le contraire de l'arrÍt rendu. Mais il faut l'avouer, ceci
n'arrivait guŤre que pour les gens tout ŗ fait en faveur.
Il y eut une aventure qui fit assez de bruit pendant notre sťjour.
Deux nobles piťmontais de province avaient eu un procŤs qui fut jugť ŗ
Casal. Le perdant arriva en poste ŗ Turin, parvint chez monsieur de
Roburent et lui reprťsenta que ce jugement ťtait inique, attendu qu'il
ťtait son cousin. Monsieur de Roburent comprit toute la force de cet
argument, et obtint facilement un _Biglietto regio_ en faveur du
cousin. Trois jours aprŤs, arrive l'autre partie, apportant pour
toute piŤce ŗ consulter une gťnťalogie prouvant qu'il ťtait, aussi,
cousin de monsieur de Roburent et d'un degrť plus rapprochť. Celui-ci
l'examine avec grand soin, convient de l'injustice qu'il a commise,
descend chez le Roi, et rapporte un second _Biglietto regio_ qui
rťtablit le jugement du tribunal. Tout cela se passait sans mystŤre;
il ne fallait en mettre un peu que pour en rire, quand on ťtait dans
une position officielle comme la nŰtre.
L'intolťrance ťtait portťe au point que l'ambassade de France devint
un lieu de rťprobation. On ne pardonnait pas ŗ notre Roi d'avoir donnť
la Charte, encore moins ŗ mon pŤre de l'approuver et de proclamer
hautement que cette mesure, pleine de sagesse, ťtait rendue
indispensable par l'esprit public en France.
Ces doctrines subversives se trouvaient tellement contraires ŗ
l'esprit du gouvernement sarde que, ne pouvant empÍcher l'ambassadeur
de les professer, on laissait entrevoir aux piťmontais qu'il valait
mieux ne point s'exposer ŗ les entendre.
Les _Purs_ ťtaient peu disposťs ŗ venir ŗ l'ambassade. Ceux qui, ayant
servi en France, avaient des idťes un peu plus libťrales, craignaient
de se compromettre, de sorte que nous ne voyions guŤre les gens du
pays qu'en visite de cťrťmonie. Il n'y avait pas grand'chose ŗ
regretter.
La sociťtť de Turin, comme celle de presque toutes les villes
d'Italie, offre peu de ces honnÍtes mťdiocritťs dont se compose le
_monde_ dans les autres contrťes. Quelques savants et des gens de la
plus haute distinction, plus nombreux peut-Ítre qu'ils ne sont
ailleurs, y mŤnent une vie retirťe, pleine d'intťrÍt et
d'intelligence. Si on peut pťnťtrer dans cette coterie ou en faire
sortir quelques-uns des membres qui la composent, on est amplement
payť des soins qu'il a fallu se donner pour atteindre ŗ ce but, mais
cela est fort difficile. En revanche, la masse dansante et visitante
est d'une sottise, d'une ignorance fabuleuses.
On dit que, dans le sud de l'Italie, on trouve de l'esprit naturel. Le
Piťmont tient du nord pour l'intelligence et du midi pour l'ťducation.
En tout, ce pays est assez mal partagť. Son climat, plus froid que
celui de France en hiver, est plus orageux, plus pťniblement ťtouffant
que l'Italie en ťtť; et les beaux-arts n'ont pas franchi les Apennins
pour venir jusqu'ŗ lui: ils seraient effarouchťs par l'horrible jargon
qu'on y parle; il les avertirait bien promptement qu'ils ne sont point
dans leur patrie.
Tout le temps de mon sťjour ŗ Turin, j'ai entendu rťguliŤrement chaque
jour, pendant ce qu'on appelait l'avant-soirťe oý mon pŤre recevait
les visites, discuter sur une question que je vais prťsenter
consciencieusement sous toutes ses faces.
Le prince BorghŤse, gouverneur du Piťmont sous l'Empereur, avait fait
placer un lustre dans la salle du grand thť‚tre. C'ťtait, il faut tout
dire, une innovation. Il offrit de le donner, il offrit de le vendre,
il offrit de le faire Űter ŗ ses frais, il offrit d'Ítre censť le
vendre sans en rťclamer le prix, il offrit d'accepter tout ce que le
Roi en voudrait donner, il offrit enfin qu'il n'en fŻt fait aucune
mention.... Je me serais volontiers accommodťe de ce dernier moyen.
Lorsque j'ai quittť Turin au bout de dix mois, il n'y avait pas encore
de parti pris, et la sociťtť continuait ŗ Ítre agitťe par des opinions
trŤs passionnťes au sujet du lustre; on attendait l'arrivťe de la
Reine pour en dťcider.
La distribution des loges avait, pour un temps, apportť quelque
distraction ŗ cette grande occupation. J'ťtais si peu prťparťe ŗ ces
usages que je ne puis dire avec quel ťtonnement j'appris qu'aux
approches du carnaval le Roi s'ťtait rendu au thť‚tre, avec son
confesseur, pour dťcider ŗ qui les loges seraient accordťes. Les gens
_bien pensants_ ťtaient les mieux traitťs. Cependant, il fallait
ajouter aux bonnes opinions la qualitť de grand seigneur pour en avoir
une aux premiŤres et tous les jours. La premiŤre noblesse ťtait admise
aux secondes, la petite noblesse se disputait les autres loges avec la
haute finance. Toutefois, pour avoir un tiers ou un quart de loge aux
troisiŤmes, il fallait quelque alliance aristocratique.
Pendant que cette liste se formait, Dieu sait quelles intrigues
s'agitaient autour du confesseur et ŗ combien de rťclamations sa
publication donna lieu! Cela se comprend cependant en rťflťchissant
que tous les amours-propres ťtaient mis en jeu d'une faÁon dont la
publicitť ťtait rťvťlťe chaque soir pendant six semaines. On
s'explique aussi la fureur et la colŤre des personnes qui, depuis
vingt ans, vivaient sur le pied d'ťgalitť avec la noblesse et qui,
tout ŗ coup, se voyaient repoussťes dans une classe exclue des seuls
plaisirs du pays.
Ce qui m'a paru singulier, c'est que la fille noble qui avait ťpousť
un roturier (il faut bien se servir de ces mots, ils n'ťtaient pas
tombťs en dťsuťtude ŗ Turin) ťtait mieux traitťe dans la distribution
des loges que la femme d'un noble qui ťtait elle-mÍme roturiŤre. Je
suppose que c'ťtait dans l'intťrÍt des filles de qualitť qui n'ont
aucune espŤce de fortune en Piťmont. Je le crois d'autant plus
volontiers que j'ai entendu citer comme un des avantages d'une jeune
fille ŗ marier qu'elle apportait le droit ŗ une demi-loge.
Quand la liste, revue, commentťe, corrigťe, fut arrÍtťe, on expťdia
une belle lettre officielle, signťe du nom du Roi et cachetťe de ses
armes, qui prťvint que telle loge, en tout ou en partie, vous ťtant
dťsignťe, vous pouviez en envoyer chercher la clef. Pour l'obtenir
alors, il fallait payer une somme tout aussi considťrable qu'ŗ aucun
autre thť‚tre de l'Europe. De plus, il fallait faire meubler la loge,
y placer des tentures, des rideaux, des siŤges, car la clef ne donnait
entrťe que dans un petit bouge vide avec des murailles sales. C'ťtait
une assez bonne aubaine pour le tapissier du Roi.
Ces frais faits, on achŤte encore ŗ la porte (pour un prix assez
modique, ŗ la vťritť) le droit d'entrer au thť‚tre, de sorte que
l'ťtranger qu'on engage ŗ venir au spectacle est forcť de payer son
billet. Malgrť, ou peut-Ítre ŗ cause de toutes ces formalitťs,
l'ouverture du grand Opťra fut un ťvťnement de la plus haute
importance. DŤs le matin, toute la population ťtait en agitation, et
la foule s'y porta le soir avec une telle affluence que, malgrť toutes
les prťrogatives des ambassadeurs, nous pens‚mes Ítre ťcrasťes, ma
mŤre et moi en y arrivant.
La salle est fort belle, le _lustre_ y ťtait demeurť _provisoirement_
et l'ťclairait assez bien, mais les vťritables amateurs de l'ancien
rťgime lui reprochaient de ternir l'ťclat de la _couronne_ (On appelle
_la couronne_ la loge du Roi). C'est un petit salon qui occupe le fond
de la salle, est ťlevť de deux rangs de loges sur une largeur de cinq
ŗ peu prŤs, extrÍmement dťcorť en ťtoffes et en crťpines d'or et
brillamment ťclairť en girandoles de bougies. Avant l'innovation du
lustre, la salle ne recevait de lumiŤre que de la loge royale. Celle
de l'ambassadeur de France ťtait de tout temps vis-ŗ-vis de la loge du
prince de Carignan et la meilleure possible. On aurait bien ťtť tentť
de l'Űter ŗ l'ambassadeur d'un Roi constitutionnel, mais pourtant on
n'osa pas, mon pŤre ayant fait savoir qu'il serait forcť de le trouver
mauvais. Cela ne se pouvait autrement, d'aprŤs l'importance qu'on y
attachait dans le pays.
Le spectacle ťtait comme par toute l'Italie: deux bons chanteurs
ťtaient entourťs d'acolytes dťtestables, de sorte qu'il n'y avait
aucun ensemble. Mais cela suffisait ŗ des gens qui n'allaient au
thť‚tre que pour y causer plus librement. On ťcoutait deux ou trois
morceaux, et le reste du temps on bavardait comme dans la rue; le
parterre, debout, se promenait lorsqu'il n'ťtait pas trop pressť. Un
ballet dťtestable excitait des transports d'admiration; les
dťcorations ťtaient moins mauvaises que la danse.
Les jeunes femmes attendent l'ouverture de l'Opťra avec d'autant plus
d'empressement qu'elles habitent toujours chez leur belle-mŤre et que,
tant qu'elles la conservent, elles ne reÁoivent personne chez elles.
En revanche, la loge est leur domicile et, lŗ, elles peuvent admettre
qui elles veulent. Les hommes de la petite noblesse mÍme s'y trouvent
en rapport avec les femmes de la premiŤre qui ne pourraient les voir
dans leurs hŰtels. On entend dire souvent: ęMonsieur un tel est un de
mes _amis de loge_Ľ. Et monsieur un tel se contente de ce rapport qui,
dit-on, devient quelquefois assez intime, sans prťtendre ŗ passer le
seuil de la maison. L'usage des _cavaliers servants_ est tombť en
dťsuťtude. S'il en reste encore quelques-uns, ils n'admettent plus que
ce soit ŗ titre gratuit et, hormis qu'elles sont plus affichťes, les
liaisons n'ont pas plus d'innocence qu'ailleurs.
L'usage en Piťmont est de marier ses enfants sans leur donner aucune
fortune. Les filles ont une si petite dot qu'ŗ peine elle peut suffire
ŗ leur dťpense personnelle, encore est-elle toujours versťe entre les
mains du beau-pŤre; il paye la dťpense du jeune mťnage, mais ne lui
assure aucun revenu.
J'ai vu le comte TancrŤde de Barolle, fils unique d'un pŤre qui avait
cinq cent mille livres de rente, obligť de lui demander de faire
arranger une voiture pour mener sa femme aux eaux. Le marquis de
Barolle calculait largement ce qu'il fallait pour le voyage, le sťjour
projetť et y fournissait sans difficultť. Sa belle-fille
tťmoignait-elle le dťsir de voir son appartement arrangť: architectes
et tapissiers arrivaient, et le mobilier se renouvelait
magnifiquement; mais elle n'aurait pas pu acheter une table de dix
louis dont elle aurait eu la fantaisie. Permission plťniŤre de faire
venir toutes les modes de Paris; le mťmoire ťtait toujours acquittť
sans la moindre rťflexion. En un mot, monsieur de Barolle ne refusait
rien ŗ ses enfants, que l'indťpendance. J'ai su ces dťtails parce que
madame de Barolle ťtait une franÁaise (mademoiselle de Colbert) et
qu'elle en ťtait un peu contrariťe, mais c'ťtait l'usage gťnťral. Tant
que les parents vivent, les enfants restent _fils de famille_ dans
toute l'ťtendue du terme, mais aussi, dans la proportion des fortunes,
on cherche ŗ les en faire jouir.
Le marquis de Barolle, dont je viens de parler, ťtait sťnateur et
courtisan fort assidu de l'Empereur. Pendant un sťjour de celui-ci ŗ
Turin, le marquis lui fit de vives reprťsentations sur ce qu'il payait
cent vingt mille francs d'impositions.
ęVraiment, lui dit l'Empereur, vous payez cent vingt mille francs?
--Oui, sire, pas un sol de moins, et je suis en mesure de le prouver ŗ
Votre Majestť, voici les papiers.
--Non, non, c'est inutile, je vous crois; et je vous en fais bien mon
compliment.Ľ
Le marquis de Barolle fut obligť de se tenir pour satisfait.
Le charme que les dames piťmontaises trouvent au thť‚tre les y rend
trŤs assidues, mais cela n'est plus d'obligation comme avant la
Rťvolution. Quand une femme manquait deux jours ŗ aller ŗ l'Opťra, le
Roi envoyait s'enquťrir du motif de son absence et elle ťtait
rťprimandťe, s'il ne le jugeait pas suffisant.
En tout, rien n'ťtait si despotique que ce gouvernement soi-disant
paternel, surtout pour la noblesse. ņ la vťritť, il la dispensait
souvent de payer les dettes qu'elle avait contractťes envers les
roturiers (ce qui, par parenthŤse, rendait les prÍts tellement onťreux
que beaucoup de familles en ont ťtť ruinťes); mais, en revanche, il
dťcidait de la faÁon dont on devait manger son revenu. Il disait aux
uns de b‚tir un ch‚teau, aux autres d'ťtablir une chapelle, ŗ celui-ci
de donner des concerts, ŗ cet autre de faire danser, etc. Il fixait la
rťsidence de chacun dans la terre ou dans la ville qui lui convenait.
Pour aller ŗ l'ťtranger, il fallait demander la permission
particuliŤre du Roi; il la donnait difficilement, la faisait toujours
attendre et ne l'accordait que pour un temps trŤs limitť. Un sťjour
plus ou moins long dans la forteresse de Fťnestrelle aurait ťtť le
rťsultat de la moindre dťsobťissance ŗ l'intťrieur. Si on avait
prolongť l'absence ŗ l'ťtranger au delŗ du temps fixť, la
sťquestration des biens ťtait de droit sans autre formalitť.
Le marquis del Borgo, un des seigneurs piťmontais les plus riches,
souffrait tellement de rhumatismes qu'il s'ťtait ťtabli ŗ Pise, ne
pouvant supporter le climat de Turin. Lorsque le roi Charles Amťdťe
fit construire la place Saint-Charles, un _Biglietto regio_ enjoignit
au marquis d'acheter un des cŰtťs de la place et d'y faire une faÁade.
BientŰt aprŤs un nouveau _Biglietto regio_ commanda un magnifique
hŰtel dont le plan fut fourni, puis vint l'ordre de le dťcorer, puis
de le meubler avec une magnificence royale imposťe piŤce par piŤce.
Enfin, un dernier _Biglietto regio_ signifia que le propriťtaire d'une
si belle rťsidence devait l'habiter, et la permission de rester ŗ
l'ťtranger fut retirťe. Le marquis revint ŗ Turin en enrageant,
s'ťtablit dans une chambre de valet, tout au bout de son superbe
appartement qu'il s'obstina ŗ ne jamais voir mais qui ťtait traversť
matin et soir par la chŤvre dont il buvait le lait. C'est la seule
femelle qui ait montť le grand escalier tant que le vieux marquis a
vťcu. Ses enfants ťtaient restťs dans l'hŰtel de la famille.
J'ai vu sa belle-fille ťtablie dans celui de la place Saint-Charles;
il ťtait remarquablement beau. C'est elle qui m'a racontť l'histoire
des _Biglietto regio_ du marquis et de la chŤvre. Elle ťtait d'autant
plus volontiers hostile aux formes des souverains sardes qu'elle-mÍme,
ťtant fort jeune et assistant ŗ un bal de Cour, la reine Clotilde
avait envoyť sa dame d'honneur, ŗ travers la salle, lui porter une
ťpingle pour attacher son fichu qu'elle trouvait trop ouvert.
La marquise del Borgo, soeur du comte de Saint-Marsan, ťtait
spirituelle, piquante, moqueuse, amusante, assez aimable. Mais elle
nous ťtait d'une faible ressource; elle se trouvait prťcisťment en
position de craindre des rapports un peu familiers avec nous.
La conduite des dames piťmontaises est gťnťralement assez peu
rťguliŤre. Peut-Ítre, au surplus, les ťtrangers s'exagŤrent-ils leurs
torts, car elles affichent leurs liaisons avec cette effronterie naÔve
des moeurs italiennes qui nous choque tant. Quant aux maris, ils n'y
apportent point d'obstacle et n'en prennent aucun souci. Cette
philosophie conjugale est commune ŗ toutes les classes au delŗ des
Alpes. Je me rappelle ŗ ce propos avoir entendu raconter ŗ Mťnageot
(le peintre), que, dans le temps oý il ťtait directeur des costumes ŗ
l'Opťra de Paris, il ťtait arrivť un jour chez le vieux Vestris et
l'avait trouvť occupť ŗ consoler un jeune danseur, son compatriote,
dont la femme, vive et jolie figurante, lui donnait de noires
inquiťtudes. AprŤs toutes les phrases banales appropriťes ŗ calmer les
fureurs de l'Othello de coulisse, Vestris ajouta dans son baragouin
semi italien:
ęEt _pouis_, vois-_tou_, ami, dans _noutre_ ťtat les _cournes_ c'est
_coumme_ les dents: quand elles poussent, cela fait _oun_ mal _dou
diavolo_ ... _pou_ ŗ _pou_ on _s'accoutoume_, et _pouis_ ... et
_pouis_ ... on finit par manger avec.Ľ
Mťnageot prťtendait que le conseil avait prospťrť assez promptement.
CHAPITRE II
Les visites ŗ Turin. -- Le comte et la comtesse de Balbe. --
Monsieur DauzŤre. -- Le prince de Carignan. -- Le corps
diplomatique. -- Le gťnťral Bubna. -- Ennui de Turin. -- Aspect
de la ville. -- Appartements qu'on y trouve. -- Rťunion de GÍnes
au Piťmont. -- DÓner donnť par le comte de Valese. -- Jules de
Polignac.
Tant que dure la saison de l'Opťra, on ne fait ni ne reÁoit de
visites: c'est un d'autant plus grand bťnťfice qu'ŗ Turin l'usage
n'admet que celles du soir. Les palais sont sans portier et les
escaliers sans lumiŤre. Le domestique qui vous suit est muni d'une
lanterne avec laquelle il vous escorte jusqu'au premier, second,
troisiŤme ťtage d'une immense maison dont le propriťtaire titrť habite
un petit coin, le reste ťtant louť, souvent ŗ des gens de finance. On
doit arriver en personne ŗ la porte de l'appartement, rester dans sa
voiture et envoyer savoir si on y est passť pour une impertinence.
Cependant les dames reÁoivent rarement. Le costume dans lequel on les
trouve, l'arrangement de leur chambre, aussi bien que de leur
personne, prouve qu'elles ne sont pas prťparťes pour le monde. Il faut
excepter quelques maisons ouvertes, les del Borgo, les Barolle, les
Bins, les Mazin, etc.
Comme nous ne suivions pas fort rťguliŤrement le thť‚tre, nous
restions assez souvent le soir chez nous en trŤs petit comitť.
Monsieur et madame de Balbe faisaient notre plus grande ressource. Le
comte de Balbe ťtait un de ces hommes distinguťs que j'ai signalťs
plus haut: des connaissances acquises et profondes en tout genre ne
l'empÍchaient pas d'Ítre aimable, spirituel, gai et bon homme dans
l'habitude de la vie. L'Empereur l'avait placť ŗ la tÍte de
l'Universitť. La confiance du pays l'avait nommť chef du gouvernement
provisoire qui s'ťtait formť entre le dťpart des franÁais et l'arrivťe
du Roi. Il s'y ťtait tellement conciliť tous les suffrages qu'on
n'avait pas osť l'expulser tout ŗ fait et il ťtait restť directeur de
l'instruction publique, avec entrťe au conseil oý, cependant, il
n'ťtait appelť que pour les objets spťciaux, tels que les cabinets
d'ornithologie. Il ťtait fort au-dessus de la crainte puťrile de
montrer de la bienveillance pour nous, et nous le voyions
journellement. Sa femme ťtait franÁaise, trŤs vive, trŤs bonne, trŤs
amusante; elle ťtait cousine de monsieur de Maurepas, avait connu mes
parents ŗ Versailles et s'ťtablit tout de suite dans notre intimitť.
La famille des Cavour y ťtait aussi entrťe. Ceux-lŗ se trouvaient trop
compromis pour avoir rien ŗ mťnager; la mŤre avait ťtť dame d'honneur
de la princesse BorghŤse et le fils marťchal du palais et l'ami du
prince. La soeur de sa femme avait ťpousť un franÁais qui a
certainement rťsolu un grand problŤme. Monsieur DauzŤre, directeur de
la police gťnťrale pendant toute l'administration franÁaise, en
satisfaisant pleinement ses chefs, ťtait parvenu ŗ se faire tellement
aimer dans le pays qu'il n'y eut qu'un cri lorsque le Roi voulut
l'expulser comme les autres franÁais employťs en Piťmont. Il est restť
ŗ Turin, bien avec tout le monde; il a fini par avoir une grande
influence dans le gouvernement et, depuis mon dťpart, j'ai entendu
dire qu'il y jouait un principal rŰle.
Nous voyions aussi, mais avec moins d'intimitť, la comtesse Mazin,
personne d'un esprit fort distinguť; elle avait ťtť ťlevťe par son
oncle, l'abbť Caluzzo, dont le nom est familier ŗ tous les savants de
l'Europe. Voilŗ, avec le corps diplomatique, ce qui formait le fond de
notre sociťtť.
Le prince de Carignan ťtait bien content lorsque son gouverneur
l'amenait chez nous. ņ peine ťchappť d'une pension ŗ GenŤve, oý il
jouissait de toute la libertť d'un ťcolier, on l'avait mis au rťgime
d'un prince piťmontais, et cependant on hťsitait ŗ le proclamer
hťritier de la Couronne. Il ťtait dans les instructions de mon pŤre
d'obtenir cette reconnaissance; il y travaillait avec zŤle, et le
jeune prince, le regardant comme son protecteur, venait lui raconter
ses dolťances.
Une des choses qui l'affligeait le plus ťtait les prťcautions
exagťrťes qu'on prenait de sa santť, aussi bien que de son salut, et
les sujťtions qu'elles lui imposaient. Par exemple, il ne pouvait
monter ŗ cheval que dans son jardin, entre deux ťcuyers, et sous
l'inspection de son mťdecin et de son confesseur.
Ce confesseur suivait toutes les actions de sa vie; il assistait ŗ son
lever, ŗ son coucher, ŗ tous ses repas, lui faisait faire ses priŤres
et dire son bťnťdicitť; enfin il cherchait constamment ŗ exorciser le
dťmon qui devait Ítre entrť dans l'‚me du prince pendant son sťjour
dans ces deux pays maudits, Paris et GenŤve. Au lieu d'obtenir sa
confiance pourtant, il ťtait seulement parvenu ŗ lui persuader qu'il
ťtait son espion et qu'il rendait compte de toutes ses actions et de
toutes ses pensťes au confesseur du Roi, qui l'avait placť prŤs de
lui. Mon pŤre l'encourageait ŗ la patience et ŗ la prudence, tout en
compatissant ŗ ses peines. Il comprenait combien un jeune homme de
quinze ans, ťlevť jusque-lŗ dans une libertť presque exagťrťe (sa
mŤre s'en occupait trŤs peu) devait souffrir d'un changement si
complet.
Le prince ťtait fort aimť de son gouverneur, monsieur de Saluces; il
avait confiance en lui et en monsieur de Balbe, un de ses tuteurs.
Quand il se trouvait chez mon pŤre, et qu'il n'y avait qu'eux et nous,
il ťtait dans un bonheur inexprimable. Il ťtait dťjŗ trŤs grand pour
son ‚ge et avait une belle figure. Il habitait tout seul l'ťnorme
palais de Carignan qu'on lui avait rendu. Il n'ťtait pas encore en
possession de ses biens, de sorte qu'il vivait dans le malaise et les
privations; encore avait-on peine ŗ solder les frais de sa trŤs petite
dťpense.
Au reste, le Roi n'avait guŤre plus de luxe. Le palais ťtait restť
meublť, mais le matťriel de l'ťtablissement, appartenant au prince
BorghŤse, avait ťtť emportť par lui; de sorte que le Roi n'avait rien
trouvť en arrivant; et, pendant fort longtemps, il s'est servi de
vaisselle, de linge, de porcelaine, de chevaux, de voitures empruntťs
aux seigneurs piťmontais. J'ignore comment les frais s'en seront
soldťs entre eux.
La nťgociation pour la reconnaissance du prince de Carignan ťtait
terminťe; mais l'influence de l'Autriche et les intrigues du duc de
ModŤne, gendre du Roi, empÍchaient toujours de la publier. Par un
hasard prťmťditť, un jour de Cour, la voiture de mon pŤre se trouva en
conflit avec celle du prince de Carignan; mon pŤre tira le cordon, et
donna le pas au prince. L'ambassadeur de France l'avait de droit sur
le prince de Carignan. Cette concession qui l'annonÁait hťritier de la
Couronne, fit brusquer la dťclaration que le Roi dťsirait
personnellement et le prince en eut une extrÍme reconnaissance.
Ce point gagnť, la France ayant intťrÍt ŗ conserver le trŰne dans la
maison de Savoie, mon pŤre se mit en devoir de faire admettre la
lťgitimitť de l'autre Carignan, fils du comte de Villefranche. Il fit
rechercher soigneusement l'acte que le confesseur du feu Roi lui avait
arrachť ŗ ses derniers moments. Malheureusement, on le retrouva. Il
portait que le Roi consentait ŗ reconnaÓtre le mariage de
_conscience_, contractť par son cousin, le comte de Villefranche, sans
que, de cette reconnaissance, il pŻt jamais rťsulter aucun droit pour
la femme de prendre le titre et le rang de princesse, ni que les
enfants de cette union pussent ťlever une prťtention quelconque ŗ
faire valoir, sous quelque prťtexte que ce pŻt Ítre, leur naissance
ťtant et demeurant illťgitime.
AprŤs la trouvaille de ce document rťclamť ŗ grands cris par la
famille La Vauguyon, il fallut se taire, au moins pour quelque temps.
Cependant mon pŤre avait derechef entamť cette nťgociation pendant les
Cent-Jours et, si monsieur de Carignan s'ťtait rendu ŗ Turin, au lieu
de prendre parti pour l'empereur Napolťon, ŗ cette ťpoque ses
prťtentions auraient ťtť trŤs probablement admises. Le roi de
Sardaigne, personnellement, craignait autant que nous l'extinction de
la maison de Savoie.
Le corps diplomatique se composait de monsieur Hill, pour
l'Angleterre, homme de bonne compagnie, mais morose et valťtudinaire,
sortant peu d'un intťrieur occulte qui rendait sa position assez
fausse; du prince Koslovski, pour la Russie, plein de connaissances et
d'esprit, mais tellement lťger et si mauvais sujet qu'il n'y avait
nulle ressource de sociťtť de ce cŰtť. Les autres lťgations ťtaient
encore inoccupťes, mais l'Autriche ťtait reprťsentťe par le comte
Bubna, gťnťral de l'armťe d'occupation laissťe en Piťmont. Sa position
ťtait ŗ la fois diplomatique et militaire. Il est difficile d'avoir
plus d'esprit, de conter d'une faÁon plus spirituelle et plus
intťressante. Il avait rťcemment ťpousť une jeune allemande,
d'origine juive, qui n'ťtait pas reÁue ŗ Vienne. Cette circonstance
lui faisait dťsirer de rester ŗ l'ťtranger. Madame Bubna, jolie et ne
manquant pas d'esprit, ťtait la meilleure enfant du monde. Elle
passait sa vie chez nous. Elle ne s'amusait guŤre ŗ Turin; cependant
elle ťtait pour lors trŤs ťprise de son mari qui la traitait comme un
enfant et la faisait danser une fois par semaine aux frais de la ville
de Turin; car, en sa qualitť de militaire, le diplomate ťtait dťfrayť
de tout, et ne se faisait faute de rien.
Il avait ťtť envoyť plusieurs fois auprŤs de l'empereur Napolťon, dans
les circonstances les plus critiques de la monarchie autrichienne, et
racontait les dťtails de ces nťgociations d'une maniŤre fort piquante.
Je suis bien f‚chťe de ne pas me les rappeler d'une faÁon assez exacte
pour oser les rapporter ici. Il parlait de l'Empereur avec une extrÍme
admiration et disait que les rapports avec lui ťtaient faciles d'homme
ŗ homme, quoiqu'ils fussent durs d'empire ŗ empire. ņ la vťritť,
Napolťon apprťciait Bubna, le vantait et lui avait donnť plusieurs
tťmoignages d'estime. Une approbation si prisťe ťtait un grand moyen
de sťduction. Tant il y a que je suis restťe bien souvent jusqu'ŗ une
heure du matin ŗ entendre Bubna raconter son Bonaparte.
Mon ami Bubna avait la rťputation d'Ítre un peu pillard. La maniŤre
dont il exploitait la ville de Turin, en pleine paix, n'ťloigne pas
cette idťe; aussi dťsirait-il maintenir l'occupation militaire le plus
longtemps possible. Mon pŤre, au contraire, prÍtait assistance aux
autoritťs sardes qui cherchaient ŗ s'en dťlivrer. Mais cette
opposition dans les affaires, qu'il avait trop de bon sens pour ne pas
admettre de situation, n'a jamais altťrť nos relations sociales. Elles
sont restťes toujours intimes et amicales. Les troupes autrichiennes
furent enfin retirťes et le comte Bubna demeura comme ministre, en
attendant l'arrivťe du prince de Stahrenberg qui devait le remplacer.
Je suis peut-Ítre injuste pour les piťmontais en dťclarant la ville de
Turin le sťjour le plus triste et le plus ennuyeux qui existe dans
tout l'univers. J'ai montrť les circonstances diverses qui militaient
ŗ le rendre dťsagrťable pour tout le monde et particuliŤrement pour
nous ŗ l'ťpoque oý je m'y suis trouvťe. Si on ajoute ŗ cela que
c'ťtait aprŤs les deux annťes si excitantes, si animťes, si
dramatiques de 1813 et 1814, passťes au centre mÍme du thť‚tre oý les
ťvťnements avaient le plus de retentissement, que je suis venue tomber
dans cette rťsidence si monotone et si triste pour y entendre
quotidiennement discuter sur l'affaire du lustre, on comprendra que je
puisse ressentir quelques prťventions injustes contre elle.
La ville de Turin est trŤs rťguliŤre; ses rues sont tirťes au cordeau,
mais les arcades, qui ornent les principales, leur donnent l'air
d'Ítre dťsertes, les ťquipages n'ťtant pas assez nombreux pour
remplacer l'absence des piťtons. Les maisons sont belles ŗ
l'extťrieur. Un vťnitien disait que, chez lui, les personnes portaient
des masques et qu'ici c'ťtait la ville. Cela est fort exact, car ces
faÁades ťlťgantes voilent en gťnťral des masures hideuses oý se
trouvent des dťdales de logements, aussi incommodťment distribuťs que
pauvrement habitťs. On est tout ťtonnť de trouver la misŤre installťe
sous le manteau de ces lignes architecturales. Au reste, il est
difficile d'apprťcier leur mťrite dans l'ťtat oý on les laisse. Sous
le prťtexte qu'elles peuvent un jour avoir besoin de rťparations et
que l'ťtablissement de nouveaux ťchafaudages nuirait ŗ la soliditť, on
conserve tous les trous qu'ils ont originairement occupťs dans la
premiŤre construction, de sorte que tous les murs, le palais du Roi
compris, sont criblťs de trous carrťs. Chacun de ces trous sert
d'habitation ŗ une famille de petites corneilles qui forment un nuage
noir dans chaque rue et font un bruit affreux dans toute la ville.
Pour qui n'y est pas accoutumť, rien n'est plus triste que l'aspect et
les cris de cette volatile.
Rentrť chez soi, les appartements qu'on peut se procurer ne compensent
pas les ennuis du dehors. Si peu d'ťtrangers s'arrÍtent ŗ Turin qu'on
trouve difficilement ŗ s'y loger. Les beaux palais sont occupťs par
les propriťtaires ou louťs ŗ long bail, et le corps diplomatique a
beaucoup de peine ŗ se procurer des rťsidences convenables. Quant au
confortable, il n'y faut pas songer.
Mon pŤre avait pris la maison du marquis Alfieri, alors ambassadeur ŗ
Paris, parce qu'on lui avait assurť qu'elle ťtait distribuťe et
arrangťe ŗ la franÁaise. Il est vrai qu'elle n'avait pas l'ťnorme
_salla_ des palais piťmontais et qu'il y avait des fenÍtres vitrťes
dans toutes les piŤces. Mais, par exemple, la chambre que j'habitais,
prťcťdťe d'une longue galerie stuquťe, sans aucun moyen d'y faire du
feu et meublťe en beau damas cramoisi, ťtait _pavťe_, non pas dallťe
comme une cuisine un peu soignťe, mais pavťe en pierres taillťes comme
les rues de Paris. ņ la tÍte de mon lit, une porte communiquait, par
un balcon ouvert, avec la chambre de ma femme de chambre. Ma mŤre
n'ťtait guŤre mieux et mon pŤre encore plus mal, car sa chambre ťtait
plus vaste et plus triste.
Le ministre d'Angleterre avait un superbe palais d'une architecture
trŤs remarquable et trŤs admirťe, le palais Morozzi; celui-lŗ ťtait en
pleine possession de la _salla_ dont les piťmontais font tant de cas.
Elle tenait le milieu de la maison du haut en bas, de faÁon qu'au
premier on ne communiquait que par des galeries extťrieures que
l'architecte avait eu bien soin de tenir ouvertes pour qu'elles
fussent suffisamment lťgŤres. Le pauvre monsieur Hill avait offert de
les faire vitrer ŗ ses frais, mais la ville entiŤre s'ťtait rťvoltťe
contre ce trait de barbarie britannique. Pour ťviter d'affronter ces
passages extra-muros, il avait fini par se cantonner dans trois
petites piŤces en entresol, les seules ťchauffables. Cela ťtait
d'autant plus nťcessaire que l'hiver est long et froid ŗ Turin. J'y ai
vu, pendant plusieurs semaines, le thermomŤtre entre dix et quinze
degrťs au-dessous de zťro, et les habitants ne paraissaient ni surpris
ni incommodťs de cette tempťrature, malgrť le peu de prťcaution qu'ils
prennent pour s'en garantir.
Le congrŤs de Vienne fit cadeau au roi de Sardaigne de l'…tat de
GÍnes. Malgrť la part que nous avions prise ŗ cet important
accroissement de son territoire, il n'en restait pas moins ulcťrť
contre la France de la dťtention de la Savoie. Ce qu'il y a de
singulier c'est que le roi Louis XVIII en ťtait aussi f‚chť que lui et
avait le plus sincŤre dťsir du monde de la lui rendre. Il semblait
qu'il se crŻt le recťleur d'un bien volť. Mon pŤre ne partageait pas
la dťlicatesse de son souverain et tenait fort ŗ ce que la France
conserv‚t la partie de la Savoie que les traitťs de 1814 lui avaient
laissťe.
Lorsque les dťputťs de GÍnes vinrent faire hommage de leur …tat au roi
de Sardaigne, il leur fit donner un dÓner par le comte de Valese,
ministre des affaires ťtrangŤres. Le corps diplomatique y fut invitť.
Ce dÓner fut pendant quinze jours un objet de sollicitude pour toute
la ville. On savait d'oý viendrait le poisson, le gibier, les
cuisiniers. Le matťriel fut rťuni avec des soins et des peines
infinis, en ayant recours ŗ l'obligeance des seigneurs de la Cour, et
surtout des ambassadeurs. L'accord qui se trouvait entre les
girandoles de celui-ci et le plateau de celui-lŗ fournit un intťrÍt
trŤs vif ŗ la discussion de plusieurs soirťes. Enfin arriva le jour du
festin; nous ťtions une vingtaine. Le dÓner ťtait bon, magnifique et
bien servi. Malgrť l'ťtalage qu'on avait fait et qui me faisait
prťvoir un rťsultat ridicule, il n'y eut rien de pareil. Monsieur de
Valese en fit les honneurs avec aisance et en grand seigneur. L'ennui
et la monotonie sous laquelle succombent les habitants de Turin leur
fait saisir avec aviditť tout ce qui ressemble ŗ un ťvťnement. C'est
l'unique occasion oý j'aie vu aucuns des membres du corps diplomatique
priťs ŗ dÓner dans une maison piťmontaise.
Les ťtrangers, comme je l'ai dťjŗ dit, s'arrÍtent peu ŗ Turin; il n'y
a rien ŗ y voir, la sociťtť n'y retient pas et les auberges sont
mauvaises.
Nous vÓmes Jules de Polignac passer rapidement, se rendant ŗ Rome. Il
y ťtait envoyť par Monsieur. Je crois qu'il s'agissait de statuer sur
l'existence des jťsuites et surtout de la Congrťgation qui, dťjŗ,
ťtendait son rťseau occulte sur la France, sous le nom de la petite
…glise. Elle ťtait en hostilitť avec le pape Pie VII, n'ayant jamais
voulu reconnaÓtre le Concordat, ni les ťvÍques nommťs ŗ la suite de ce
traitť. Elle espťrait que la persťcution qu'elle faisait souffrir aux
prťlats ŗ qui le Pape avait refusť l'investiture pendant ses
discussions avec l'Empereur compenserait sa premiŤre dťsobťissance. On
dťsirait que le Pape reconnŻt les ťvÍques titulaires des siŤges avant
le Concordat et non dťmissionnaires comme y ayant conservť leurs
droits. Jules allait nťgocier cette transaction. Le Pape fŻt
probablement trŤs sage car, ŗ son retour de Rome, il en ťtait fort
mťcontent; il avait pourtant obtenu d'Ítre crťť prince romain, cela ne
prťsentait pas de grandes difficultťs. Il prolongea son sťjour ŗ Turin
pendant assez de temps. Les jťsuites commenÁaient ŗ y Ítre puissants;
il les employa ŗ se faire nommer chevalier de Saint-Maurice. Je n'ai
jamais pu comprendre qu'un homme de son nom, et dans sa position, ait
eu la fantaisie de possťder ce petit bout de ruban.
L'ordre de l'_Annonciade_ est un des plus illustres et des plus
recherchťs de l'Europe; il n'a que des _grands colliers_. Ils sont
_excellences_. Le roi de Sardaigne fait des _excellences_, comme
ailleurs le souverain crťe des ducs ou des princes; seulement ce titre
n'est jamais hťrťditaire. Quelques places, aussi bien que le collier
de l'Annonciade, donnent droit ŗ le porter. Il entraÓne toutes les
distinctions et les privilŤges qu'on peut possťder dans le pays. Je
conÁois, ŗ la rigueur, quoique cela ne soit guŤre avantageux pour un
ťtranger, qu'on recherche un pareil ordre; mais la petite croix de
Saint-Maurice, dont les chevaliers pavent les rues, m'a semblť une
singuliŤre ambition pour Jules. Au reste, quand on a bien voulu,
s'appelant monsieur de Polignac, devenir _prince du Pape_, il n'y a
pas de puťrile vanitť qui puisse surprendre. Cela ne l'empÍchait pas
de concevoir de trŤs grandes ambitions.
Quelque accoutumťs que nous fussions ŗ ses absurditťs, il trouvait
encore le secret de nous ťtonner. Les jeunes gens de l'ambassade
restaient ťbahis des thŤses qu'il soutenait, il faut le dire, avec une
assez grande facilitť d'ťlocution; il n'y manquait que le sens commun.
Un jour, il nous racontait qu'il dťsirait fort que le Roi le nomme
ministre, non pas, ajoutait-il, qu'il se crŻt plus habile qu'un autre,
mais parce que rien n'ťtait plus facile que de gouverner la France. Il
ne ferait au Roi qu'une seule condition: il demanderait qu'il lui
assur‚t pendant dix ans les portefeuilles des affaires ťtrangŤres, de
la guerre, de l'intťrieur, des finances et surtout de la police. Ces
cinq ministŤres remis exclusivement entre ses mains, il rťpondait de
tout, et cela sans se donner la moindre peine. Une autre fois, il
disait que, puisque la France ťtait en appťtit de constitution, il
fallait lui en faire une bien large, bien satisfaisante pour les
opinions les plus libťrales, la lire en pleine Chambre, et puis, la
posant sur la tribune, ajouter:
ęVous avez entendu la lecture de cette constitution; elle doit vous
convenir; maintenant il faut vous en rendre dignes. Soyez sages
pendant dix ans, nous la promulguerons, mais chaque mouvement
rťvolutionnaire, quelque faible qu'il soit, retardera d'une annťe cet
instant que nous aussi, nous appelons de tous nos voeux.Ľ Et, en
attendant _Io el rey_, s'ťcriait-il en frappant sur un grand sabre
qu'il traÓnait aprŤs lui, car, en sa qualitť d'aide de camp de
Monsieur, quoiqu'il n'eŻt jamais vu brŻler une amorce ou commandť un
homme, il ťtait le plus souvent qu'il lui ťtait possible en uniforme.
On parlait un soir du mauvais esprit qui rťgnait en Dauphinť et on
l'attribuait au grand nombre d'acquťreurs de biens d'ťmigrťs:
ęC'est la faute du gouvernement, reprit Jules; j'ai proposť un moyen
bien simple de remťdier ŗ cet embarras. J'en garantissais
l'infaillibilitť; on ne veut pas l'employer.
--Quel est donc ce moyen? lui demandai-je.
--J'ai offert de prendre une colonne mobile de dix mille hommes,
d'aller m'ťtablir successivement dans chaque province, d'expulser les
nouveaux propriťtaires et de replacer partout les anciens avec une
force assez respectable pour qu'on ne pŻt rien espťrer de la
rťsistance. Cela se serait fait trŤs facilement, sans le moindre
bruit, et tout le monde aurait ťtť content.
--Mais, mon cher Jules, pas les acquťreurs que vous expropriez, au
moins?
--Mon Dieu! si, parce qu'ils seront toujours inquiets!Ľ
Ces niaiseries ne vaudraient pas la peine d'Ítre racontťes sans la
dťplorable cťlťbritť qu'a si chŤrement acquise le pauvre prince de
Polignac. Je pourrais en faire une bien longue collection, mais cela
suffit pour montrer la tendance de cet esprit si ťtroit.
CHAPITRE III
Rťvťlation des projets bonapartistes. -- Voyage ŗ GÍnes. --
Expťrience des fusťes ŗ la congrŤve. -- La princesse
Grassalcowics. -- L'empereur Napolťon quitte l'Óle d'Elbe. -- Il
dťbarque en France. -- Officier envoyť par le gťnťral Marchand.
-- Dťclaration du 13 mars. -- Mon frŤre la porte ŗ monsieur le
duc d'AngoulÍme. -- Le Pape. -- La duchesse de Lucques.
Mon pŤre avait ťtť chargť de veiller sur les actions des
bonapartistes, rťpandus en Italie, et sur leurs communications avec
l'Óle d'Elbe. Il avait employť ŗ ce service un mťdecin anglais, nommť
Marshall, que le prince rťgent d'Angleterre faisait voyager en Italie
pour recueillir des renseignements sur la conduite, plus que lťgŤre,
de la princesse sa femme.
Ce Marshall avait, en 1799, portť la vaccine en Italie; il s'ťtait
trouvť ŗ Naples lors des cruelles vengeances exercťes par la Cour
ramenťe de Palerme sur les vaisseaux de l'amiral Nelson. Il ťtait
jeune alors et, justement indignť du spectacle hideux de tant
d'horreurs, il avait profitť de son caractŤre d'anglais et de l'accŤs
que lui procurait sa position de mťdecin pour rendre beaucoup de
services aux victimes de cette rťaction royaliste. Il ťtait restť
depuis lors dans des rapports intimes avec le parti rťvolutionnaire et
fort ŗ mÍme de connaÓtre ses projets sans participer ŗ ses trames.
Une nuit du mois de janvier 1815, il arriva chez mon pŤre trŤs
secrŤtement et lui communiqua des documents qui prouvaient, de la
maniŤre la moins douteuse, qu'il se prťparait un mouvement en France
et que l'empereur Napolťon comptait prochainement quitter l'Óle d'Elbe
et l'appuyer de sa prťsence. Mon pŤre, persuadť de la gravitť des
circonstances, pressa Marshall de faire ses communications au
gouvernement franÁais. Il se refusa ŗ les donner ŗ aucun ministre. Les
cabinets de tous, selon lui, ťtaient envahis par des bonapartistes, et
il craignait pour sa propre sŻretť.
Monsieur de Jaucourt remplaÁait par intťrim monsieur de Talleyrand et
ne rťpondait ŗ aucune dťpÍche; la correspondance se faisait par les
bureaux, elle ťtait purement officielle. Mon pŤre n'aurait su ŗ quel
ministre adresser Marshall qui, d'ailleurs, ne consentait ŗ remettre
les piŤces qu'il s'ťtait procurťes qu'au Roi lui-mÍme. Il se vantait
d'Ítre en relations personnelles avec le prince rťgent; il semblait
que la grandeur de ses commettants relev‚t ŗ ses yeux le mťtier assez
peu honorable auquel il se livrait. L'importance des rťvťlations
justifiait ses exigences. Mon pŤre lui donna une lettre pour le duc de
Duras; il fut introduit par celui-ci dans le cabinet de Louis XVIII,
le 22 janvier. Le Roi fit remercier mon pŤre du zŤle qui avait procurť
des renseignements si prťcieux; mais ils ne donnŤrent lieu ŗ aucune
prťcaution, pas mÍme ŗ celle d'envoyer une corvette croiser autour de
l'Óle d'Elbe. L'incurie ŗ cette ťpoque a ťtť au delŗ de ce que la
crťdulitť de la postťritť pourra consentir ŗ se laisser persuader.
Je viens de dire que mon pŤre n'avait pas reÁu de dťpÍches du ministre
des affaires ťtrangŤres; j'ai tort. Il en reÁut une seule, pour lui
demander des truffes de Piťmont pour le Roi; elle ťtait de quatre
pages et entrait dans les dťtails les plus minutieux sur la maniŤre de
les expťdier et les faire promptement et sŻrement arriver. ņ la
vťritť, le prince de Talleyrand le faisait tenir suffisamment au
courant de ce qui se passait au CongrŤs; mais sa rťsidence ŗ Vienne
empÍchait qu'il pŻt donner, ni peut-Ítre savoir, des nouvelles de
France.
Vers la fin de fťvrier, la Cour se rendit ŗ GÍnes pour y recevoir la
Reine qu'on attendait de Sardaigne. Le corps diplomatique l'y suivit.
Nous laiss‚mes la vallťe de Turin et celle d'Alexandrie sous la neige
qui les recouvrait depuis le mois de novembre, et nous arriv‚mes au
haut de la Bocchetta. On ne passe plus par cette route. La montagne de
la Bocchetta a cela de remarquable qu'elle ne prťsente aucun plateau
et la voiture n'a pas encore achevť son ascension que les chevaux qui
la traÓnent ont dťjŗ commencť ŗ descendre. Au moment de l'annťe oý
nous nous trouvions, cette localitť est d'autant plus frappante qu'on
passe immťdiatement du plein hiver ŗ un printemps trŤs avancť. D'un
cŰtť, la montagne est couverte de neige, les ruisseaux sont gelťs, les
cascades prťsentent des stalactites de glace; de l'autre, les arbres
sont en fleur, beaucoup ont des feuilles, l'herbe est verte, les
ruisseaux murmurent, les oiseaux gazouillent, la nature entiŤre semble
en liesse et disposťe ŗ vous faire oublier les tristesses dont le
coeur ťtait froissť un quart de minute avant. Je n'ai guŤre ťprouvť
d'impression plus agrťable.
AprŤs quelques heures d'une course rapide ŗ travers un pays enchantť,
nous arriv‚mes ŗ GÍnes le 26 fťvrier. Les rues ťtaient tapissťes de
fleurs; nulle part je n'en ai vu cette abondance; il faisait un temps
dťlicieux: j'oubliai la fatigue d'un voyage dont le commencement avait
ťtť pťnible.
En descendant de voiture, je voulus me promener dans ces rues
embaumťes, si propres, si bien dallťes, et dont le marcher ťtait bien
autrement doux que celui de ma chambre pavťe de Turin. Je les trouvai
remplies d'une population gaie, animťe, affairťe, qui faisait
contraste avec le peuple sale et ennuyť que je venais de quitter. Les
femmes, chaussťes de souliers de soie, coiffťes de l'ťlťgant
_mezzaro_, me charmŤrent et les enfants me parurent ravissants. Tout
le beau monde de GÍnes se trouvait aussi dans la rue; au bout de cinq
minutes nous ťtions entourťs de quarante personnes de connaissance. Je
sentis subitement soulever de dessus mes ťpaules le manteau de plomb
que le sťjour de Turin y fixait depuis six mois. Ma joie fut un peu
calmťe par les cent cinquante marches qu'il fallut gravir pour arriver
ŗ un beau logement, dans un grand palais qu'on avait retenu pour
l'ambassadeur de France.
Pendant le sťjour que j'ai fait ŗ GÍnes, la hauteur des appartements
et l'importunitť, sans exemple partout ailleurs, des mendiants sont
les seules choses qui m'aient dťplu. Je ne rťpťterai pas ce que tout
le monde sait de la magnificence et de l'ťlťgance des palais. Je ne
parlerai pas davantage des moeurs du pays que je n'ai pas eu occasion
d'observer, car, peu de jours aprŤs notre arrivťe, les ťvťnements
politiques nous condamnŤrent ŗ la retraite, et j'ai ŗ peine entrevu la
sociťtť.
Les gťnois ne prenaient guŤre le soin de dissimuler leur affliction de
la rťunion au Piťmont et la rťpugnance qu'ils avaient pour le Roi. Peu
d'entre eux allaient ŗ la Cour, et ceux-lŗ ťtaient mal vus par leurs
compatriotes. Leur chagrin ťtait d'autant plus sensible qu'ils avaient
cru un moment ŗ l'ťmancipation.
Lord William Bentinck, sťduit par les deux beaux yeux de la _Louise
Durazzo_ (comme on dit ŗ GÍnes), avait autorisť par son silence, si ce
n'est par ses paroles, le rťtablissement de l'ancien gouvernement
pendant son occupation de la ville. Les actes par lesquels le congrŤs
de Vienne disposa du sort des gťnois leur en parurent plus cruels ŗ
subir. MaÓtre pour maÓtre, ils prťfťraient un grand homme au bon roi
Victor; et, s'il fallait cesser d'Ítre gťnois, ils aimaient encore
mieux Ítre franÁais que piťmontais. La sentence de Vienne les avait
rendus bonapartistes enragťs, et c'est surtout des riviŤres de GÍnes
que partaient les correspondances pour l'Óle d'Elbe.
L'armťe anglaise, avant de remettre la ville aux autoritťs sardes,
avait dťpouillť les ťtablissements publics et tout enlevť du port,
jusqu'aux chaÓnes des galťriens. Cette avanie avait fort exaspťrť le
sentiment de nationalitť des gťnois.
Le lendemain de notre arrivťe, nous fŻmes conviťs ŗ aller assister ŗ
une reprťsentation qu'un commodore anglais donnait au Roi. Il
s'agissait de lui montrer l'effet des fusťes ŗ la congrŤve, invention
nouvelle ŗ cette ťpoque. Nous nous rendÓmes tous ŗ pied, par un temps
admirable, ŗ un petit plateau situť sur un rocher ŗ quelques toises de
la ville et d'oý l'on jouissait d'une vue magnifique. Une mauvaise
barque, amarrťe si loin qu'ŗ peine on pouvait l'apercevoir ŗ l'oeil
nu, servait de but. La brise venait de mer et nuisait ŗ l'effet des
fusťes, mais elle rafraÓchissait l'air et le rendait dťlicieux. Le
spectacle ťtait animť sur la cŰte et brillant dans le port qu'on
apercevait sur la droite, rempli de vaisseaux pavoisťs.
Le tir fut interrompu par la crainte que deux petits bricks, affalťs
par le vent, pussent Ítre atteints. …videmment ils ne voulaient pas
aborder; ils manoeuvraient pour s'ťlever en mer, y rťussirent, et on
recommenÁa ŗ tirer. D'aprŤs toutes les circonstances qui sont venues
depuis ŗ notre connaissance, il est indubitable que ces deux bricks
transportaient Bonaparte et sa fortune aux rivages de Cannes. Combien
le hasard d'une de ces fusťes, en dťsemparant ces b‚timents, aurait pu
changer le destin du monde!
Le commodore donna un ťlťgant dťjeuner sous une tente, et on se sťpara
trŤs satisfaits de la matinťe.
Je me rappelle que la princesse Krassalkolwitz vint achever la journťe
chez nous. J'ťtais liťe avec elle depuis longtemps; elle s'embarquait
le lendemain pour Livourne. Nous causions le soir de la fadeur des
ťvťnements, de l'ennui des gazettes: valait-il la peine de vivre pour
attendre quinze jours un misťrable protocole du congrŤs de Vienne?
Moitiť sťrieusement, moitiť en plaisanterie, nous regrettions les
derniŤres annťes si agitťes mais si animťes; l'existence nous
paraissait monotone, privťe de ces grands spectacles. Ma mŤre reprit:
ęVoilŗ bien des propos de jeunes femmes; oh! mesdames, ne tentez pas
la Providence! Quand vous serez aussi vieille que moi, vous saurez que
les moments de calme, que vous avez l'enfantillage d'appeler d'ennui,
ne durent jamais longtemps.Ľ
Aussi lorsque, trois jours aprŤs, la princesse revint ŗ GÍnes, n'ayant
pu dťbarquer ŗ Livourne et retournant en toute h‚te ŗ Vienne, elle
arriva chez nous se cachant le visage, et disant:
ęAh! chŤre ambassadrice, que vous aviez raison; je vous demande pardon
de mes folies, j'en suis bien honteuse.Ľ
J'aurais pu partager ses remords, car j'avais pris part ŗ la faute.
Nous assistions ŗ un concert lorsqu'on vint chercher mon pŤre; un
courrier l'attendait; il ťtait expťdiť par le consul franÁais ŗ
Livourne et annonÁait le dťpart de Bonaparte de Porto-Ferrajo. Mon
pŤre s'occupa tout de suite d'en donner avis. Il expťdia une estafette
ŗ Vienne ŗ monsieur de Talleyrand, une autre ŗ Paris, et fit partir
un secrťtaire de lťgation pour porter cette nouvelle ŗ Massťna, et,
chemin faisant, prťvenir toutes les autoritťs de la cŰte. Cette
prťcaution fut dťjouťe par la cťlťritť de l'Empereur. Peu d'heures
aprŤs son dťpart de GÍnes, monsieur de Ch‚teau traversait le bivouac
de Cannes dťjŗ abandonnť, quoique les feux brŻlassent encore. Nous
avions passť la nuit ŗ copier les lettres et les dťpÍches qui furent
confiťes ŗ ces diffťrents courriers; il n'y avait qu'une partie de la
chancellerie ŗ GÍnes oý on ne s'attendait pas ŗ de telles affaires.
L'ťmoi fut grand le lendemain matin. On ne doutait pas que l'Empereur
ne dŻt dťbarquer sur quelque point de l'Italie et se joindre aux
troupes de Murat qui armait depuis quelque temps. Les autrichiens
n'ťtaient pas en mesure de s'y opposer, et le gťnťral Bubna, fort
inquiet, reprochait aux piťmontais l'empressement qu'ils avaient eu de
faire abandonner leur territoire par les allemands avant d'avoir eu le
temps de crťer une armťe nationale. Le comte de Valese, de son cŰtť,
prťtendait que, les frais de l'occupation absorbant tous les revenus
de l'…tat, on ne pouvait rien instituer tant qu'elle durait.
Lord William Bentinck arriva ŗ tire d'aile. Chacun se regardait,
s'inquiťtait, s'agitait; on s'accusait mutuellement, mais
l'incertitude du lieu oý dťbarquerait l'Empereur ne permettait de
prendre aucun parti, ni de donner aucun ordre. Le gťnťral Bubna fut le
premier instruit de sa marche; dŤs lors, autrichiens, anglais et
piťmontais, tout se rassura et crut avoir du temps devant soi.
Bubna demanda ŗ faire entrer ses troupes en Piťmont. Monsieur de
Valese s'y refusant obstinťment, il fut rťduit ŗ les faire cantonner
sur les frontiŤres de Lombardie; aussi dťclara-t-il formellement que,
si l'armťe napolitaine s'avanÁait, il resterait derriŤre le PŰ, en
laissant le Piťmont dťcouvert. Le cabinet sarde tint bon; il ne tarda
mÍme pas ŗ admettre l'ťtrange pensťe de pouvoir s'ťtablir dans un ťtat
de neutralitť vis-ŗ-vis de Napolťon et de Murat. Les rapports avec mon
pŤre se ressentirent plus tard de cette illusion. L'ambassadeur sarde
fut le seul qui ne rejoignit pas le roi Louis XVIII ŗ Gand.
Monsieur de Ch‚teau revint porteur des plus belles promesses de
Massťna. Il avait vu arrÍter madame Bertrand, arrivant de l'Óle
d'Elbe, et il avait trouvť partout autant d'enthousiasme pour monsieur
le duc d'AngoulÍme que d'indignation contre l'Empereur. Cela ťtait
vrai en Provence et dans ce moment. Des nouvelles bien diffťrentes
ťtaient portťes sur l'aile des vents. On apprenait avec une rapiditť
inouÔe, et par des voies inconnues, les succŤs et la marche rapide de
Bonaparte.
Un matin, un officier franÁais, portant la cocarde blanche, se
prťsenta chez mon pŤre et lui remit une dťpÍche du gťnťral Marchand,
tellement insignifiante qu'elle ne pouvait pas avoir motivť son envoi.
Il ťtait fort agitť et demandait une rťponse immťdiate, son gťnťral
ayant fixť le moment du retour. Mon pŤre l'engagea ŗ s'aller reposer
quelques heures. Tandis qu'il cherchait le mot de cette ťnigme,
d'autant moins facile ŗ deviner que le bruit s'ťtait rťpandu que le
gťnťral Marchand avait reconnu l'Empereur, le gťnťral Bubna entra chez
lui en lui disant:
ęMon cher ambassadeur, je viens vous remercier du soin que vous prenez
de payer le port de mes lettres. Je sais qu'on vous demande cinquante
louis pour celle que voici. Elle est du gťnťral Bertrand qui m'ťcrit,
par ordre de Napolťon, pour me charger d'expťdier sur-le-champ par
estafette ces autres dťpÍches ŗ Vienne pour l'Empereur et pour
Marie-Louise. Moi, qui ne suis jamais trŤs pressť, j'attendrai
tranquillement une bonne occasion; qu'allez-vous faire de votre jeune
homme?Ľ
Mon pŤre rťflťchit un moment, puis il pensa que, s'il le faisait
arrÍter, ce serait trop grave. Il l'envoya chercher ŗ son auberge, lui
intima l'ordre de partir sur-le-champ, en le prťvenant que, s'il
laissait au gouvernement sarde le temps d'apprendre la maniŤre dont il
avait franchi la frontiŤre, il serait arrÍtť comme espion, et qu'il ne
pourrait pas le rťclamer.
L'officier eut l'imprudence de dire qu'il lui faudrait s'arrÍter ŗ
Turin oý il avait des lettres ŗ remettre. Mon pŤre lui conseilla de
les brŻler et lui donna un passeport qui indiquait une route qui
l'ťloignait de Turin. Je n'ai plus entendu parler de ce monsieur qui
eut l'audace, aprŤs cette explication, de rťclamer de mon pŤre les
cinquante louis que le gťnťral Marchand, dans sa lettre ostensible,
l'avait priť de lui remettre pour les frais de son voyage. Bubna garda
le secret suffisamment longtemps pour assurer la sťcuritť du courrier.
Elle aurait ťtť fort hasardťe en ce moment; car les vellťitťs
pacifiques du cabinet sarde n'existaient pas alors, et ses terreurs
sur les dispositions bonapartistes des piťmontais ťtaient en revanche
trŤs exaltťes.
La dťclaration du 13 mars fut expťdiťe ŗ mon pŤre par monsieur de
Talleyrand, aussitŰt qu'elle eut ťtť signťe par les souverains rťunis
ŗ Vienne. Il la fit imprimer en toute h‚te, et, trois heures aprŤs son
arrivťe, mon frŤre se mit en route pour la porter ŗ monsieur le duc
d'AngoulÍme. Il le trouva ŗ NÓmes. La rapiditť avait ťtť si grande
qu'elle nuisit presque ŗ l'effet et fit douter de l'authenticitť de la
piŤce. Monsieur le duc d'AngoulÍme garda mon frŤre auprŤs de lui, le
nomma son aide de camp, et bientŰt aprŤs l'envoya en Espagne pour
demander des secours qu'il n'obtint pas. Au surplus, si on les avait
accordťs, ils seraient arrivťs trop tard.
Dans le plan que je me suis fait de noter les plus petites
circonstances qui, ŗ mon sens, dessinent les caractŤres, je ne puis
m'empÍcher d'en rapporter une qui peut sembler puťrile.
Mon frŤre avait donc apportť ŗ monsieur le duc d'AngoulÍme un document
d'une importance extrÍme. Il avait fait une diligence qui prouvait
bien du zŤle. Sur sa route, il avait semť partout des exemplaires de
la dťclaration sans s'informer de la couleur des personnes auxquelles
il les remettait, ce qui n'ťtait pas tout ŗ fait sans danger. Monsieur
le duc d'AngoulÍme le savait et semblait fort content de lui. Il
l'engagea ŗ dťjeuner. Rainulphe, ayant fait l'espŤce de toilette que
comportait la position d'un homme qui vient de faire cent lieues ŗ
franc ťtrier, s'y rendit. ņ peine ŗ table, les premiers mots de
monsieur le duc d'AngoulÍme furent:
ęQuel uniforme portez-vous lŗ?
--D'officier d'ťtat-major, monseigneur.
--De qui Ítes-vous aide de camp?
--De mon pŤre, monseigneur.
--Votre pŤre n'est que lieutenant gťnťral; pourquoi avez-vous des
aiguillettes? Il n'y a que la maison du Roi et celle des princes qui y
aient droit...; on les tolŤre pour les marťchaux...; vous avez tort
d'en porter.
--Je ne savais pas, monseigneur.
--ņ prťsent vous le savez, il faut les Űter tout de suite. En bonne
justice, cela mťriterait les arrÍts, mais je vous excuse; que je ne
vous en voie plus.Ľ
On comprend combien un jeune homme comme ťtait alors Rainulphe se
trouva dťconcertť par une pareille sortie faite en public. Dans les
moments oý s'il s'animait sur les petites questions militaires jusqu'ŗ
se monter ŗ la colŤre, monsieur le duc d'AngoulÍme se faisait
l'illusion d'Ítre un grand capitaine.
Le roi de Sardaigne annonÁa qu'il allait faire une course ŗ Turin; ses
ministres et le gťnťral Bubna l'accompagnŤrent. Le ministre
d'Angleterre resta ŗ GÍnes ainsi que mon pŤre qui s'y tenait plus
facilement en communication avec monsieur le duc d'AngoulÍme et le
midi de la France.
BientŰt nous vÓmes arriver toutes les notabilitťs que les mouvements
de l'armťe napolitaine repoussaient du sud de l'Italie. Le Pape fut le
premier; on le logea dans le palais du Roi. Je ne l'avais pas vu
depuis le temps oý il ťtait venu sacrer l'empereur Napolťon; nous
all‚mes plusieurs fois lui faire notre cour. Il causait volontiers et
familiŤrement de tout. Je fus surtout touchťe de la maniŤre digne et
calme dont il parlait de ses annťes de proscription, sans avoir l'air
d'y attacher ni gloire ni mťrite, mais comme d'une circonstance qui
s'ťtait trouvťe malheureusement inťvitable, s'affligeant que son
devoir l'eŻt forcť ŗ imposer ŗ Napolťon les torts de sa persťcution.
Il y avait dans tous ses discours une noble et paternelle modťration
qui devait lui Ítre inspirťe d'en haut, car, sur tout autre sujet, il
n'ťtait pas ŗ beaucoup prŤs aussi distinguť. On sentait que c'ťtait un
homme qui recommencerait une carriŤre de tribulation, sans qu'elle pŻt
l'amener ŗ l'amertume ni ŗ l'exaltation. Le mot _sťrťnitť_ semblait
inventť pour lui. Il m'a inspirť une bien sincŤre vťnťration.
BientŰt aprŤs, il fut suivi par l'infante Marie-Louise, duchesse de
Lucques, plus connue sous le titre de reine d'…trurie. GÍnes ťtant
comblťe de monde et ne pouvant trouver un logement convenable, elle
s'installa dans une grande chambre d'auberge dont, ŗ l'aide de
quelques paravents, on fit un dortoir pour toute la famille. Elle
paraissait faite pour habiter ce taudis; je n'ai jamais rien vu de
plus ignoble que la tournure de cette princesse, si ce n'est ses
discours. Elle ťtait Bourbon: il nous fallait bien lui rendre des
hommages, mais c'ťtait avec dťgoŻt et rťpugnance.
Elle traÓnait ŗ sa suite une fille, aussi disgracieuse qu'elle, et un
fils si singuliŤrement ťlevť qu'il pleurait pour monter sur un cheval,
se trouvait mal ŗ l'aspect d'un fusil, et qu'ayant dŻ un jour entrer
dans un bateau pour passer un bac il en eut des attaques de nerfs. La
duchesse de Lucques assurait que les princes espagnols avaient tous
ťtť ťlevťs prťcisťment comme son fils. Mon pŤre t‚cha de la raisonner
ŗ ce sujet, mais ce fut sans autre rťsultat que de se faire prendre en
grippe par elle.
CHAPITRE IV
La princesse de Galles. -- FÍte donnťe au roi Murat. -- Audience
de la princesse. -- Notre situation est pťnible. -- Message de
monsieur le duc d'AngoulÍme. -- Inquiťtudes pour mon frŤre. --
Marche de Murat. -- Il est battu ŗ Occhiobello. -- L'abbť de
Janson. -- Henri de Chastellux.
Monsieur Hill nous arriva un matin avec une figure encore plus triste
que de coutume; sa princesse de Galles ťtait en rade. Sous prťtexte de
lui cťder son appartement, il l'abandonna aux soins de lady William
Bentinck, se jeta dans sa voiture et partit pour Turin. Lady William
en aurait bien fait autant s'il lui avait ťtť possible. La princesse
Caroline s'ťtablit chez monsieur Hill.
Le lendemain, nous vÓmes apparaÓtre dans les rues de GÍnes un
spectacle que je n'oublierai jamais. Dans une sorte de phaťton, fait
en conque marine, dorť, nacrť, enluminť extťrieurement, doublť en
velours bleu, garni de crťpines d'argent, traÓnť par deux trŤs petits
chevaux pies, menťs par un enfant vÍtu en amour d'opťra, avec des
paillettes et des tricots couleur de chair, s'ťtalait une grosse femme
d'une cinquantaine d'annťes, courte, ronde et haute en couleur. Elle
portait un chapeau rose avec sept ou huit plumes roses flottant au
vent, un corsage rose fort dťcolletť, une courte jupe blanche qui ne
dťpassait guŤre les genoux, laissait apercevoir de grosses jambes
couvertes de brodequins roses; une ťcharpe rose, qu'elle ťtait
constamment occupťe ŗ draper, complťtait le costume.
La voiture ťtait prťcťdťe par un grand bel homme montť sur un petit
cheval pareil ŗ l'attelage, vÍtu prťcisťment comme le roi Murat auquel
il cherchait ŗ ressembler de geste et d'attitude, et suivie par deux
palefreniers ŗ la livrťe d'Angleterre, sur des chevaux de la mÍme
espŤce. Cet attelage napolitain ťtait un don de Murat ŗ la princesse
de Galles qui s'exhibait sous ce costume ridicule et dans ce bizarre
ťquipage. Elle se montra dans les rues de GÍnes pendant cette matinťe
et celles qui suivirent.
La princesse ťtait dans tout le feu de sa passion pour Murat; elle
aurait voulu l'accompagner dans les camps. Il avait dŻ user d'autoritť
pour la faire partir. Elle n'y avait consenti qu'avec l'espťrance de
dťcider lord William Bentinck ŗ joindre les forces anglaises aux armes
napolitaines. Elle ne s'ťpargnait pas dans les demandes, les
supplications, les menaces ŗ ce sujet. On peut juger de quel poids
tout cela ťtait auprŤs de lord William qui, au reste, partit le
surlendemain de son arrivťe.
Elle ťtait aussi fort zťlťe bonapartiste. Cependant elle tťmoignait
bien quelque crainte que l'Empereur ne compromit le _Roi_, comme elle
appelait exclusivement Murat. Elle s'entoura bien vite de tout ce qui
ťtait dans l'opposition ŗ GÍnes et en fit tant, qu'au bout de quelques
jours, le gouvernement sarde la fit prier de chercher un autre asile.
Pendant le dernier carnaval, qu'elle venait de passer ŗ Naples, elle
avait inventť de faire donner un bal de souscription ŗ Murat par les
anglais qui s'y trouvaient. La scŤne se passait dans une salle
publique. Au moment oý Murat arriva, un groupe, formť des plus jolies
anglaises costumťes en dťesses de l'Olympe, alla le recevoir. Minerve
et Thťmis s'emparŤrent de lui et le conduisirent sur une estrade dont
les rideaux s'ouvrirent et montrŤrent aux spectateurs un groupe de
gťnies, parmi lesquels figurait une Renommťe sous les traits d'une des
jolies ladys Harley. Elle tenait un grand tableau. La Gloire,
reprťsentťe par la princesse, plus ridiculement vÍtue encore que les
autres, s'avanÁa lťgŤrement, enleva une plume de l'aile de la Renommťe
et inscrivit, en grandes lettres d'or, sur le tableau qu'elle
soutenait, le nom des diverses batailles oý Murat s'ťtait signalť. Le
public applaudissait en p‚mant de rire; la reine de Naples haussa les
ťpaules. Murat avait assez de bon sens pour Ítre impatientť, mais la
princesse prenait cette mascarade au sťrieux comme une ovation
glorieuse pour l'objet de sa passion et pour elle qui savait si
dignement l'honorer. J'ai entendu faire la relation de cette soirťe ŗ
lady Charlotte Campbell, celle des dames de la princesse qui l'a
abandonnťe la derniŤre. Elle pleurait de dťpit en en parlant, mais son
rťcit n'en ťtait que plus comique. Il fallait avoir l'hťroÔne sous les
yeux pour en apprťcier pleinement le ridicule.
C'ťtait pour tromper le chagrin que lui causait sa sťparation d'avec
Murat que la princesse de Galles avait inventť de faire habiller un de
ses gens, qui le rappelait un peu, prťcisťment comme lui. Ce portrait
animť ťtait Bergami, devenu cťlŤbre depuis, et qui dťjŗ (assurait le
capitaine du b‚timent qui l'avait amenť de Livourne) usurpait auprŤs
de sa royale maÓtresse tous les droits de Murat, aussi bien que son
costume; mais cela ne passait encore que pour un mauvais propos de
marin.
Il fallut bien aller rendre les hommages, dus ŗ son rang dans
l'almanach, ŗ cette princesse baladine. Elle nous dťtestait dans
l'idťe que nous ťtions hostiles au _Roi_; elle se donna la petite joie
d'Ítre fort impertinente. Nous y all‚mes avec lady William Bentinck,
le jour et l'heure fixťs par elle. Elle nous fit attendre longtemps;
enfin nous fŻmes admises sous un berceau de verdure oý elle dťjeunait
vÍtue d'un peignoir tout ouvert et servie par Bergami. AprŤs quelques
mots dits ŗ ma mŤre, elle affecta de ne parler qu'anglais ŗ lady
William. Elle fut un peu dťconcertťe de nous voir prendre part ŗ cette
conversation, dont elle pensait nous exclure, et se rabattit ŗ ne
parler que des vertus, des talents royaux et militaires de Murat.
BientŰt aprŤs, elle donna audience ŗ mon pŤre et entama un grand
discours sur les succŤs infaillibles de Murat, sa prochaine jonction
avec l'armťe de l'empereur Napolťon et les triomphes qui les
attendaient. Mon pŤre se prit ŗ rire.
ęVous vous moquez de moi, monsieur l'ambassadeur?
--Du tout, madame, c'est Votre Altesse Royale qui veut me faire
prendre le change par son sťrieux. De tels discours, tenus par la
princesse de Galles ŗ l'ambassadeur de France, sont trop plaisants
pour qu'elle exige que je les ťcoute avec gravitť.Ľ
Elle prit l'air trŤs offensť et abrťgea l'entrevue. Nous n'ťtions
aucuns tentťs de la renouveler. Elle prťtendit que mon pŤre avait
contribuť ŗ lui faire donner l'ordre de partir; rien n'ťtait plus
faux. Si le gouvernement avait ťtť stimulť par quelqu'un c'ťtait
plutŰt par lady William Bentinck qui en ťtait fort importunťe. Lord
William et monsieur Hill s'ťtaient soustraits ŗ cet ennui.
Nous ťtions dans un ťtat cruel. Rien n'est plus pťnible que de se
trouver ŗ l'ťtranger, avec une position officielle, au milieu d'une
pareille catastrophe, lorsqu'il faut montrer une sťrťnitť qu'on
n'ťprouve pas. Personne n'entrait dans nos sentiments de maniŤre ŗ
nous satisfaire. Les uns proclamaient les succŤs assurťs de Bonaparte,
les autres sa chute rapide devant les alliťs et l'humiliation des
armes franÁaises. Il ťtait bien rare que les termes fussent assez bien
choisis pour ne pas nous froisser. Aussi, dŤs que les ťvťnements, par
leur gravitť irrťcusable, nous eurent dťlivrťs du tourment de jouer la
comťdie d'une sťcuritť que nous n'avions pas conservťe un seul
instant, nous nous renferm‚mes dans notre intťrieur, d'oý nous ne
sortÓmes plus.
Le marquis de Lur-Saluces, aide de camp de monsieur le duc
d'AngoulÍme, arriva porteur de ses dťpÍches. Le prince chargeait mon
pŤre de demander au roi de Sardaigne le secours d'un corps de troupes
qui serait entrť par Antibes pour le rejoindre en Provence. Il venait
d'obtenir un succŤs assez marquť au pont de la DrŰme oý, surtout, il
avait dťployť aux yeux des deux armťes une valeur personnelle qui
l'avait trŤs relevť dans les esprits. Il sentait le besoin et la
volontť d'agir vigoureusement. Quand une fois monsieur le duc
d'AngoulÍme ťtait tirť de sa funeste prťoccupation d'obťissance
passive, il ne manquait pas d'ťnergie. Il ťtait moins nul que
certaines niaiseries, dont on ferait un volume, donneraient lieu de le
croire. C'ťtait un homme trŤs incomplet, mais non pas incapable.
Mon pŤre fit prťparer une voiture et partit avec monsieur de Saluces
pour Turin. Nous avions appris par celui-ci l'envoi de mon frŤre en
Espagne. Peu de jours aprŤs, le _Moniteur_ contenait des lettres
interceptťes de monsieur le duc d'AngoulÍme ŗ madame la duchesse
d'AngoulÍme; elles disaient que le jeune d'Osmond en ťtait porteur.
Nous eŻmes tout lieu de craindre qu'il eŻt ťtť arrÍtť; cette vive
inquiťtude dura vingt-sept jours.
Les communications avec le Midi furent interrompues; nous ne savions
ce qui s'y passait que par les gazettes de Paris qui parvenaient
irrťguliŤrement. C'est de cette faÁon que nous apprÓmes la dťfaite de
monsieur le duc d'AngoulÍme, la convention faite avec lui et enfin son
dťpart de Cette. Le nom de mon frŤre ne se trouvait nulle part; nous
finÓmes par recevoir des lettres de lui, ťcrites de Madrid. Il allait
le quitter pour rejoindre son prince qu'il croyait en France et
qu'aprŤs un long circuit il retrouva ŗ Barcelone.
Monsieur le duc d'AngoulÍme avait eu le projet d'envoyer mon frŤre
auprŤs de Madame, ainsi qu'il le lui disait dans sa lettre, puis il
avait changť d'idťe et l'avait expťdiť au duc de Laval, ambassadeur ŗ
Madrid. C'ťtait lŗ ce qui nous avait occasionnť une inquiťtude si
grande et si justifiťe dans ce premier moment de guerre civile oý il
ťtait impossible de prťvoir quel serait le sort des prisonniers et la
nature des vengeances exercťes de part et d'autre. La suite a prouvť
que les colŤres ťtaient ťpuisťes aussi bien que les passions et qu'il
ne restait des premiers temps de la Rťvolution que la valeur et les
intťrÍts personnels.
Murat avanÁait en Italie si rapidement que, dťjŗ, on emballait ŗ
Turin. Nous avions bien le dťsir, ma mŤre et moi, d'aller y rejoindre
mon pŤre; il s'y refusait de jour en jour. La question d'ťconomie
devenait importante et se joignait ŗ celle de sťcuritť pour ne pas
faire un double voyage dans ce moment d'incertitude.
Les demandes de monsieur de Saluces avaient ťtť plus que froidement
accueillies par le gouvernement sarde. Elles n'auraient pu avoir de
succŤs effectif, puisque la nouvelle de la catastrophe et de
l'embarquement du prince arrivŤrent promptement aprŤs. Mais, dŤs lors,
mon pŤre remarqua l'accueil embarrassť que lui fit le ministre et
aperÁut une disposition ŗ ťcarter l'ambassadeur des affaires, tout en
comblant le marquis d'Osmond de politesses.
Comme, dans le mÍme temps, on repoussait tout secours autrichien ou
anglais, il restait ťvident qu'on espťrait nťgocier sťparťment et se
maintenir en position de faire valoir sa neutralitť ŗ l'Empereur, s'il
rťussissait ŗ s'ťtablir. Bubna riait beaucoup de cette politique; il
appelait le roi Victor l'_Auguste alliť de l'empereur Napolťon_. Mon
pŤre n'ťtait pas en situation d'en rire, mais lui aussi croyait ŗ
cette prťoccupation du cabinet sarde.
Murat, ayant ťtť battu ŗ Occhiobello par les armťes autrichiennes,
cessa d'avancer, et nos arrÍts furent levťs. On annonÁa officiellement
que l'arrivťe de la reine de Sardaigne ťtait remise indťfiniment; nous
retourn‚mes ŗ Turin.
Avant de quitter GÍnes, je veux parler de deux individus que nous y
vÓmes passer. Le premier ťtait l'abbť de Janson. Ayant appris le
dťpart de l'Óle d'Elbe sur la cŰte de Syrie, oý il se trouvait pŤlerin
de Jťrusalem, il avait ťtť si bien servi par les vents et par son
activitť qu'il ťtait arrivť ŗ GÍnes dans un temps presque incroyable.
Il n'y resta que deux heures pour s'informer des ťvťnements, retroussa
sa soutane, enfourcha un bidet de poste et courut joindre monsieur le
duc d'AngoulÍme.
Cet abbť, en costume ecclťsiastique, parut fort ridicule aux soldats;
mais lorsque, au combat du pont de la DrŰme, on le vit allant jusque
sous la mitraille relever les blessťs sur ses ťpaules, leur porter des
consolations et des secours de toute espŤce, avec autant de sang-froid
qu'un grenadier de la vieille garde, _le curť_ (comme ils
l'appelaient) excita leur enthousiasme au plus haut degrť. L'abbť de
Janson a depuis mis ce zŤle au service de l'intrigue; on ne peut que
le regretter. Devenu ťvÍque de Nancy et un des membres le plus actif
de la Congrťgation si fatale ŗ la Restauration, il s'est fait
tellement dťtester qu'ŗ la Rťvolution de 1830 il a ťtť expulsť de sa
ville ťpiscopale.
L'autre personne dont je veux noter le passage ŗ GÍnes est Henri de
Chastellux. ¬gť de 24 ou 25 ans, maÓtre d'une fortune considťrable, il
ťtait attachť ŗ l'ambassade de Rome. Ce fut lŗ qu'il apprit la
trahison de son beau-frŤre, le colonel de La BťdoyŤre. Il en fut
d'autant plus consternť qu'il aimait tendrement sa soeur et qu'il
comprenait combien elle devait avoir besoin de consolation et de
soutien, dans une pareille position, au milieu d'une famille aussi
exaltťe en royalisme que la sienne. Il obtint immťdiatement un congť
de son ambassadeur et, aprŤs avoir rangť ses papiers, fait ses malles,
emballť ses livres et ses effets, il se jeta dans la carriole d'un
voiturin avec lequel il avait fait marchť pour le mener en vingt-sept
jours ŗ Lyon.
Les rťvolutions ne s'accommodent guŤre de cette allure. En arrivant ŗ
Turin, monsieur de Chastellux fut informť qu'il ne pouvait continuer
sa route. Il vint ŗ GÍnes consulter mon pŤre sur ce qu'il lui restait
ŗ faire. Il fut dťcidť qu'il irait rejoindre monsieur le duc
d'AngoulÍme; mon pŤre lui dit qu'il le chargerait de dťpÍches. En
effet, deux heures aprŤs, un secrťtaire alla les lui porter; il le
trouva couchť sur un lit, lisant Horace.
ęQuand partez-vous?
--Je ne sais pas encore. Je n'ai pas pu m'arranger avec les patrons
qu'on m'a amenťs, j'en attends d'autres.
--Vous n'allez pas par la Corniche?
--Non, je compte louer une felouque.Ľ
Le secrťtaire rapporta les dťpÍches qu'on expťdia par estafette.
Henri de Chastellux s'embarqua le lendemain matin; mais, ayant fait
son arrangement pour coucher ŗ terre toutes les nuits, il n'arriva ŗ
Nice que le cinquiŤme jour. Il y recueillit des bruits inquiťtants sur
la position de monsieur le duc d'AngoulÍme, attendit patiemment leur
confirmation et, au bout de dix ŗ douze jours, nous le vÓmes
reparaÓtre ŗ GÍnes, n'ayant pas poussť sa reconnaissance au delŗ de
Nice.
Cette singuliŤre apathie dans un jeune homme qui ne manque pas
d'esprit et que sa situation sociale et ses relations de famille
auraient dŻ stimuler si vivement dans cette circonstance, comparťe ŗ
la prodigieuse activitť d'un homme dont la robe aurait semblť l'en
dispenser, nous parut un si singulier contraste que nous en fŻmes trŤs
frappťs et que j'en ai conservť la mťmoire.
Mon pŤre s'ťtait mis en correspondance plus active avec le duc de
Narbonne, ambassadeur ŗ Naples, le duc de Laval, ambassadeur ŗ Madrid,
et le marquis de RiviŤre qui commandait ŗ Marseille. Il leur faisait
passer les nouvelles qui lui arrivaient de l'Allemagne et du nord de
la France. La lťgation de Turin se trouvait fort dťgarnie de
secrťtaires et d'attachťs; mon pŤre, en partant de GÍnes, me chargea
de ces correspondances. Cela se bornait ŗ expťdier le bulletin des
nouvelles qui nous parvenaient, en distinguant celles qui ťtaient
officielles des simples bruits dont nous ťtions inondťs. Plusieurs de
ces lettres furent interceptťes et quelques-unes, je crois, imprimťes
dans le _Moniteur_.
La malveillance s'est saisie de cette puťrile circonstance pour
ťtablir que je _faisais l'ambassade_. L'impatience que j'ai conÁue de
cette sottise m'a tenue volontairement dans l'ignorance des affaires
diplomatiques que mon pŤre a dŻ traiter depuis lors, et probablement
plus que je ne l'aurais ťtť sans cette ridicule invention. Car, je
crois l'avoir dťjŗ dit, la politique m'amuse; j'en fais volontiers _en
amateur_, pour occuper mon loisir; et, comme je n'ai jamais eu le
besoin de parler des affaires qu'on me confie, mon pŤre me les aurait
communiquťes si je l'avais souhaitť.
CHAPITRE V
Retour de Turin. -- Monsieur de La BťdoyŤre. -- Marche de Cannes.
-- L'empereur Napolťon. -- Exposition du Saint-Suaire. -- Retour
de Jules de Polignac. -- Il est fait prisonnier ŗ Montmťlian. --
Prise d'un rťgiment ŗ Aiguebelle. -- Conduite du gťnťral Bubna.
-- Haine des piťmontais contre les autrichiens. -- Espťrances du
roi de Sardaigne.
Nous continu‚mes ŗ mener en Piťmont la vie retirťe que nous avions
adoptťe ŗ GÍnes. Mon pŤre ne voulait rien changer ŗ l'ťtat ostensible
de sa maison, mais les circonstances permettaient de rťformer toutes
les dťpenses extraordinaires et la prudence l'exigeait. Notre seule
distraction ťtait de faire chaque jour de charmantes promenades dans
la dťlicieuse colline qui borde le PŰ, au delŗ de Turin, et s'ťtend
jusqu'ŗ Moncalieri.
Ce serait une vťritable ressource si les chemins ťtaient moins
dťsagrťables; mÍme ŗ pied, il est difficile et trŤs fatigant d'y
pťnťtrer. Les sentiers qui servent de lit aux torrents, dans la saison
pluvieuse, sont ŗ pic et remplis de cailloux roulants. Le marcher en
est pťnible jusqu'ŗ Ítre douloureux, aussi les dames du pays ne s'y
exposent-elles guŤre. On est dťdommagť de ses peines par des points de
vue admirables sans cesse variťs et une campagne enchantťe.
Nous apprÓmes successivement les dťtails circonstanciťs de ce qui
s'ťtait passť ŗ Chambťry et ŗ Grenoble. Tous les rťcits s'accordaient
ŗ montrer monsieur de La BťdoyŤre comme le plus coupable. Je prÍtais
d'autant plus de foi ŗ la prťmťditation dont on l'accusait que je
l'avais entendu, avant mon dťpart de Paris, tenir hautement les propos
les plus bonapartistes et les plus hostiles ŗ la Restauration.
La famille de sa femme (mademoiselle de Chastellux) avait commis la
faute de le faire entrer presque de force au service du Roi; il avait
eu la faiblesse d'accepter. Je ne voudrais pas prťciser ŗ quelle
ťpoque cette faiblesse ťtait devenue de la trahison, mais il est
certain que, lorsque ŗ la tÍte de son rťgiment oý il ťtait arrivť
depuis peu de jours, il se rendait de Chambťry ŗ Grenoble, il dit ŗ
madame de Bellegarde, chez laquelle il s'arrÍta pour dťjeuner, qu'il
ne formait aucun doute des succŤs de l'empereur Napolťon et qu'il les
dťsirait passionnťment. Au moment oý il montait ŗ cheval, il lui cria:
ęAdieu, madame, dans huit jours je serai fusillť ou marťchal
d'Empire.Ľ
Il paraissait avoir entraÓnť le mouvement des troupes qui se rťunirent
ŗ l'Empereur et abusť de la faiblesse du gťnťral Marchand, entiŤrement
dominť par lui. La reconnaissance de l'Empereur pour le service rendu
ne fut pas portťe ŗ si haut prix qu'il l'avait espťrť, mais ses
prťvisions ne furent que trop tristement accomplies dans l'autre
alternative.
Il ťtait impossible de n'Ítre pas frappť de la grandeur, de la
dťcision, de l'audace dans la marche et de l'habiletť prodigieuse
dťployťes par l'Empereur, de Cannes jusqu'ŗ Paris. Il est peu ťtonnant
que ses partisans en aient ťtť ťlectrisťs et aient retrempť leur zŤle
ŗ ce foyer du gťnie. C'est peut-Ítre le plus grand fait personnel
accompli par le plus grand homme des temps modernes; et ce n'ťtait
pas, j'en suis persuadťe, un plan combinť d'avance. Personne n'en
avait le secret complet en France; peut-Ítre ťtait-on un peu plus
instruit en Italie. Mais l'Empereur avait beaucoup livrť au hasard ou
plutŰt ŗ son gťnie. La preuve en est que le commandant d'Antibes,
sommť le premier, avait refusť d'admettre les aigles impťriales. Leur
vol ťtait donc tout ŗ fait soumis ŗ la conduite des hommes qu'elles
rencontreraient sur leur route, et la belle expression du vol de
_clocher en clocher_, quoique justifiťe par le succŤs, ťtait bien
hasardťe. L'Empereur s'ťtait encore une fois confiť ŗ son ťtoile et
elle lui avait ťtť fidŤle, comme pour servir de flambeau ŗ de plus
immenses funťrailles.
En arrivant ŗ Paris, il apprit la dťclaration de Vienne du 13 mars; il
subit en mÍme temps les froideurs et les rťticences de la plupart des
personnes qui, dans l'ordre civil, lui avaient ťtť le plus dťvouťes.
Son instinct gouvernemental comprit tout de suite que ces gens-lŗ
reprťsentaient le pays beaucoup plus que les militaires. Peut-Ítre
aurait-il ťtť tentť de le gouverner par le sabre, si ce sabre n'avait
pas dŻ trouver un emploi plus que suffisant dans la rťsistance ŗ
l'ťtranger. Il ne pouvait donc ťcraser les idťes constitutionnelles,
si rapidement ťcloses en France, qu'en l‚chant le frein aux passions
populaires qui, sous le nom de libertť ou de nationalitť, amŤnent
promptement la plus hideuse tyrannie.
Rendons justice ŗ l'Empereur; jamais homme au monde n'a eu plus
l'horreur de pareils moyens. Il voulait un gouvernement absolu, mais
rťglť et propre ŗ assurer l'ordre public, la tranquillitť et l'honneur
du pays. DŤs que sa position lui fut complŤtement dťvoilťe, il
dťsespťra de son succŤs, et le dťgoŻt qu'il en conÁut exerÁa peut-Ítre
quelque influence sur le dťcouragement montrť par lui lors de la
catastrophe de Waterloo.
J'ai lieu de croire que, bien peu de jours aprŤs son arrivťe aux
Tuileries, il cessa de dťployer l'ťnergie qui l'avait accompagnť
depuis l'Óle d'Elbe. Peut-Ítre, s'il avait retrouvť dans ses anciens
serviteurs civils le mÍme enthousiasme que dans les militaires, il
aurait mieux accompli la t‚che gigantesque qu'il s'ťtait assignťe;
peut-Ítre aussi ťtait-elle impossible.
Je retournai ŗ Turin. Le Pape nous y avait prťcťdťs; sa prťsence donna
lieu ŗ une cťrťmonie assez curieuse, ŗ laquelle nous assist‚mes.
Le Piťmont possŤde le Saint-Suaire. La chrťtientť attache un tel prix
ŗ cette relique que le Pape en a seul la disposition. Elle est
enfermťe dans une boÓte en or, renfermťe dans une de cuivre,
renfermťe..., enfin il y en a sept, et les sept clefs qui leur
appartiennent sont entre les mains de sept personnes diffťrentes. Le
Pape conserve la clef d'or. Le coffre est placť dans une magnifique
chapelle d'une superbe ťglise, appelťe du Saint-Suaire. Des chanoines,
qui prennent le mÍme nom, la desservent. La relique n'est exposťe aux
regards des fidŤles que dans les circonstances graves et avec des
cťrťmonies trŤs imposantes. Le Pape envoie un lťgat tout exprŤs,
chargť d'ouvrir le coffre et de lui rapporter la clef.
La prťsence du Saint-PŤre ŗ Turin et l'importance des ťvťnements
inspirŤrent le dťsir de donner aux soldats, ŗ la population et au Roi
la satisfaction d'envisager cette prťcieuse relique.
Malgrť les espťrances que le gouvernement sarde conservait, _in
petto_, d'obtenir de tous les cŰtťs la reconnaissance de sa
neutralitť, il avait levť rapidement des troupes considťrables et trŤs
belles sous le rapport des hommes. On rťunit les nouveaux corps sur la
_place du ch‚teau_, et, aprŤs que le Pape eut bťni leurs jeunes
drapeaux, on procťda au dťploiement du Saint-Suaire.
Le Roi et sa petite Cour, les catholiques du corps diplomatique, les
chevaliers de l'Annonciade, les autres excellences, les cardinaux et
les ťvÍques ťtaient seuls admis dans la piŤce oý se prťparait la
cťrťmonie. Nous n'ťtions pas plus de trente, ma mŤre, madame Bubna et
moi seules de femmes; aussi ťtions-nous parfaitement bien placťes.
Le coffre fut apportť par le chapitre qui en a la garde. Chaque boÓte
fut ouverte successivement, le grand personnage qui en conserve la
clef la remettant ŗ son tour, et un procŤs-verbal constatant l'ťtat
des serrures longuement et minutieusement rťdigť. Ceci se passait
comme une levťe de scellť, et sans aucune forme religieuse, seulement
le cardinal qui ouvrait les serrures rťcitait une priŤre ŗ chaque
fois.
Lorsqu'on fut arrivť ŗ la derniŤre cassette, qui est assez grande et
paraÓt toute brillante d'or, les oraisons et les gťnuflexions
commencŤrent. Le Pape s'approcha d'une table oý elle fut dťposťe par
deux des cardinaux; tout le monde se mit ŗ genoux, et il y eut
beaucoup de formes employťes pour l'ouvrir. Elles auraient ťtť mieux
placťes dans une ťglise que dans un salon oý cette pantomime, vue de
trop prŤs, manquait de dignitť.
Enfin le Pape, aprŤs avoir approchť et retirť ses mains plusieurs
fois, comme s'il craignait d'y toucher, tira de la boÓte un grand
morceau de grosse toile maculťe. Il la porta, accompagnť du Roi qui le
suivait immťdiatement et entourť des cardinaux, sur le balcon oý il la
dťploya. Les troupes se mirent ŗ genoux aussi bien que la population
qui remplissait les rues derriŤre elles. Toutes les fenÍtres ťtaient
combles de monde; le coup d'oeil ťtait beau et imposant.
On m'a dit qu'on voyait assez distinctement les marques ensanglantťes
de la figure, des pieds, des mains et mÍme de la blessure sur le
saint Linceul. Je n'ai pu en juger, me trouvant placťe ŗ une fenÍtre
voisine de celle oý ťtait le Pape. Il l'exposa en face, ŗ droite et ŗ
gauche; le silence le plus solennel dura pendant ce temps. Au moment
oý il se retira, la foule agenouillťe se releva en poussant de grandes
acclamations; le canon, les tambours, les vivats annoncŤrent que la
cťrťmonie ťtait finie. Rentrť dans le salon, on commenÁa les oraisons.
Le Saint-PŤre eut la bontť de nous faire demander, par le cardinal
Pacca, si nous voulions faire bťnir quelque objet et le faire toucher
au Saint-Suaire. N'ayant pas prťvu cette faveur, nous n'ťtions munies
d'aucun meuble convenable. Cependant nous donn‚mes nos bagues et de
petites chaÓnes que nous portions au col. Le Pape n'y fit aucune
objection et nous jeta un coup d'oeil plein d'amťnitť et de bontť
paternelle. Nous venions de le voir souvent ŗ GÍnes. Lui seul et le
cardinal, qu'il avait dŻ nommer lťgat exprŤs pour l'occasion, avaient
le droit de toucher au Saint-Suaire mÍme. Ils eurent assez de peine ŗ
le replier, mais personne ne pouvait leur offrir assistance.
La premiŤre boÓte fermťe, le Pape en prit la clef, puis les cardinaux
la placŤrent dans la seconde enveloppe. Cette cťrťmonie faite, le
Pape, le Roi et les personnes invitťes passŤrent dans une piŤce oý on
avait prťparť un dťjeuner ou plutŰt des rafraÓchissements, car il n'y
avait pas de table mise. Les deux souverains y distribuŤrent leurs
politesses. On attendit que la clŰture de tous les coffres fŻt
terminťe et que les chanoines eussent repris processionnellement le
chemin de l'ťglise, puis chacun se retira.
Je ne me rappelle pas si Jules de Polignac assistait ŗ cette
cťrťmonie, mais, vers ce temps, il arriva porteur de pleins pouvoirs
de Monsieur, nommť par le roi Louis XVIII lieutenant gťnťral du
royaume. Il prťtendait Ítre en mesure de lever une lťgion franÁaise, ŗ
cocarde blanche, sur le territoire sarde, mais le gouvernement ne
voulut du tout y consentir. Il obtint ŗ grand'peine la permission de
s'ťtablir sur la frontiŤre pour surveiller de plus prŤs les relations
qu'il conservait dans le Midi. Il s'installa chez un curť des Bauges.
Il ťtait en correspondance presque journaliŤre avec mon pŤre et lui
racontait toutes les pauvretťs imaginables.
Les renseignements que mon pŤre recevait d'ailleurs lui faisaient
prťvoir des hostilitťs prochaines. Il avertit Jules de prendre garde ŗ
sa sŻretť; celui-ci rťpondit, en date du 15 juin, qu'il ťtait sŻr
d'Ítre averti au moins dix jours avant l'ouverture de la campagne qui
ne pouvait pas commencer avant quatre ou cinq semaines. En le
remerciant de sa sollicitude, il le priait d'Ítre en pleine sťcuritť,
car il ťtait sŻr d'Ítre informť plus tŰt et mieux que personne.
Le mÍme courrier apportait une lettre du curť (car c'ťtaient toujours
des curťs!) de Montmťlian qui avertissait mon pŤre qu'aprŤs avoir
portť sa lettre ŗ la poste, Jules ťtait revenu au presbytŤre pour
prendre son cheval, qu'au moment oý il mettait le pied ŗ l'ťtrier la
maison avait ťtť investie par une compagnie de soldats franÁais,
entrťs dans la ville sans coup fťrir, et que Jules avait ťtť fait
prisonnier. Le curť en ťtait d'autant plus inquiet que la selle
portait des sacoches remplies d'une correspondance qui compromettait
Jules et tous ses affiliťs.
Le curť avait fait porter sa lettre, ŗ travers les montagnes, ŗ un
bureau non encore occupť; cependant celle de Jules, timbrťe de
Montmťlian, arriva ťgalement. C'est encore une occasion oý
l'imprťvoyance dont ce pauvre monsieur de Polignac paraÓt si
ťminemment douť lui a ťtť fatale. Elle est toujours accompagnťe d'une
confiance en lui-mÍme poussťe ŗ un degrť fabuleux. Comme il joint ŗ
cette outrecuidance une grande tťmťritť, un courage trŤs remarquable,
souvent ťprouvť, rien ne l'avertit du danger; il s'y prťcipite en
aveugle. Mais il faut lui rendre cette justice, qu'une fois arrivť, il
le considŤre sans faiblesse et subit les consťquences de ses fautes
avec une force d'‚me peu commune.
Nous fŻmes consternťs en le sachant prisonnier. La douceur de ses
moeurs, l'urbanitť de son langage le rendent fort attachant dans la
vie privťe. J'oubliai alors que je l'accusais toujours d'Ítre conduit
par l'ambition et de faire du prie-Dieu un marchepied pour ne plus me
rappeler que l'homme facile et obligeant avec lequel j'ťtais liťe
depuis notre mutuelle enfance, et je pleurai amŤrement sur son sort.
Il ťtait impossible de prťvoir comment la politique de l'Empereur
l'engagerait ŗ traiter les prisonniers dans la catťgorie de Jules, et
lui surtout, que la Restauration avait arrachť ŗ la captivitť du
rťgime impťrial, se trouvait dans un prťdicament tout ŗ part et
pťrilleux.
Mon pŤre se mit fort en mouvement pour se procurer de ses nouvelles;
il fut longtemps sans pouvoir y rťussir. Toutefois, il obtint une
dťclaration de tous les ministres, rťsidant ŗ Turin, qui annonÁait des
reprťsailles de la part de leurs souverains si monsieur de Polignac
ťtait traitť autrement qu'en prisonnier de guerre. Le cabinet sarde
fut le plus rťcalcitrant, mais consentit enfin ŗ signer le dernier.
Ces dťmarches se trouvŤrent inutiles. Le marťchal Suchet se souciait
peu de s'illustrer par cette conquÍte. Il fit mettre monsieur de
Polignac au fort Barraux, lui conseilla de se tenir parfaitement
tranquille et eut l'air de l'y oublier, tout en l'y faisant trŤs bien
traiter. On lui manda de l'envoyer ŗ Paris; il n'en tint compte. Je
ne sais s'il aurait pu prolonger longtemps cette bienveillante
indiffťrence, mais les ťvťnements marchŤrent vite.
Le gouvernement piťmontais avait si complŤtement partagť la sťcuritť
de Jules qu'au mÍme moment oý les franÁais s'emparaient de Montmťlian,
un autre corps, traversant la montagne, enlevait ŗ Aiguebelle un beau
rťgiment piťmontais qui faisait tranquillement l'exercice avec des
pierres de bois ŗ ses fusils. Ce qu'il y a de plus piquant dans cette
aventure c'est que la mÍme chose ťtait arrivťe, au mÍme lieu et de la
mÍme faÁon, au dťbut de la guerre prťcťdente.
L'ťmoi fut grand ŗ Turin. On nomma vite monsieur de Saint-Marsan
ministre de la guerre, quoiqu'il eŻt servi sous le rťgime franÁais. On
rťclama les secours autrichiens avec autant de zŤle qu'on en avait mis
ŗ les refuser jusque-lŗ. Mais le gťnťral Bubna dťclara ŗ monsieur de
Valese qu'il fallait porter la peine de son obstination; il
l'avertissait depuis longtemps que les hostilitťs ťtaient prÍtes ŗ
ťclater et que les nťgociations occultes et personnelles avec le
gouvernement franÁais, pour ťtablir sa neutralitť, seraient sans
succŤs. Il n'avait pas voulu le croire; maintenant il le prťvenait
formellement que, si les franÁais s'ťtaient emparťs du Mont-Cenis
avant qu'il pŻt l'occuper, ce qui lui paraissait fort probable, il
retirerait ses troupes en Lombardie et abandonnerait le Piťmont.
ņ la suite de cette menace, il dťploya une activitť prodigieuse pour
la rendre vaine. C'ťtait un singulier homme que ce Bubna. Grand, gros,
boiteux par une blessure, paresseux lorsqu'il n'avait rien ŗ faire, il
passait les trois quarts des journťes, couchť sur un lit ou sur la
paille dans son ťcurie, ŗ fumer le plus mauvais tabac du plus mauvais
estaminet. Quand il lui plaisait de venir dans le salon, il y ťtait,
sauf l'odeur de pipe, homme de la meilleure compagnie, conteur
spirituel, fin, caustique, comprenant et employant toutes les
dťlicatesses du langage. Les affaires civiles ou militaires le
rťclamaient-elles? Il ne prenait plus un moment de repos; et ce mÍme
Bubna qui avait passť six mois sans quitter, ŗ peine, la position
horizontale, serait restť soixante-douze heures ŗ cheval sans en
paraÓtre fatiguť.
Il me fit la confidence qu'il exagťrait un peu ses inquiťtudes et la
rigueur de ses projets pour se venger de monsieur de Valese et de ses
hťsitations. Comme j'ťtais trŤs indignťe contre celui-ci de la faÁon
dont il s'ťloignait de l'ambassadeur de France, je goŻtais fort cette
espiŤglerie. Mon pŤre, avec son ťminente sagesse, ne partageait pas
cette joie; il approuvait monsieur de Valese d'avoir rťussi ŗ ťviter ŗ
son pays quelques semaines de l'occupation autrichienne. Il
compatissait au dťsir d'un petit royaume de chercher ŗ obtenir un ťtat
de neutralitť, tout en croyant ce rťsultat impossible.
Il est certain que la rťsistance apportťe par le cabinet ŗ la rentrťe
des autrichiens sur le territoire piťmontais compensa, aux yeux des
habitants, beaucoup des torts qu'on reprochait au gouvernement. La
population les avait pris en haine et ils lui avaient enseignť ŗ
regretter les troupes franÁaises: ęLes franÁais disait-elle, nous
pressuraient beaucoup, mais ils mangeaient chez nous et avec nous ce
qu'ils prenaient, au lieu que les allemands prennent plus encore et
emportent tout.Ľ
Cela ťtait vrai de l'administration aussi bien que des chefs et des
soldats. Elle faisait venir d'Autriche jusqu'aux fers des chevaux,
n'achetait rien dans les pays occupťs; mais, en revanche, emportait
tout, mÍme les gonds et les verrous des portes et fenÍtres dans les
casernes que les troupes abandonnaient. Les fourgons qui suivent un
corps autrichien ťvacuant un pays _alliť_ sont curieux ŗ voir par leur
nombre fabuleux et par la multitude d'objets de toute espŤce qu'ils
contiennent pÍle-mÍle. Ces convois excitaient la colŤre des peuples
italiens, victimes de ce systŤme de spoliation gťnťrale.
La nouvelle de l'entrťe en campagne sur la frontiŤre de Belgique et de
la bataille de Ligny livrťe le 16 nous parvint avec une grande
rapiditť ŗ travers la France et ŗ l'aide du tťlťgraphe qui l'avait
apportťe ŗ Chambťry. Mais il fallut attendre l'arrivťe d'un courrier
rťgulier pour nous conter celle de Waterloo. AprŤs celle-lŗ, celles
que nous ťtions contraints ŗ appeler les bonnes nouvelles se
succťdŤrent aussi rapidement que les mauvaises trois mois avant. Il
fallait bien s'en rťjouir, mais ce n'ťtait pas sans saignement de
coeur.
Le roi de Sardaigne avait la tÍte tournťe de voir le corps piťmontais
entrer en France avec l'armťe autrichienne, et se croyait dťjŗ un
conquťrant. Sa magnanimitť se contentait du RhŰne pour frontiŤre. Il
donnait bien quelques soupirs ŗ Lyon, mais il se consolait par l'idťe
que c'ťtait une ville _mal pensante_.
J'ai dťjŗ dit qu'il ťtait trŤs accessible; il recevait tout le monde,
ťtait fort parlant, surtout dans ce moment d'exaltation. Il n'y avait
pas un moine, ni un paysan qu'il ne retÓnt pour leur raconter ses
projets militaires.
…tant duc d'Aoste, il avait fait une campagne dans la vallťe de
Barcelonnette et avait conservť une grande admiration pour l'agilitť
et le courage de ses habitants: aussi voulait-il aller prendre
BrianÁon, par escalade, ŗ la tÍte de ses _Barbets_, comme il les
appelait. Il dťveloppa ce plan au gťnťral Frimont lorsqu'il passa pour
prendre le commandement en chef de l'armťe autrichienne. Bubna,
prťsent ŗ cette entrevue, racontait ŗ faire mourir de rire
l'ťtonnement calme de l'alsacien Frimont cherchant vainement ses yeux
pour dťcouvrir ce qu'il pensait de ces extravagances et obligť par sa
malice ŗ y rťpondre seul. Heureusement le Roi se laissa choir d'une
chaise sur laquelle il ťtait grimpť pour prendre d'assaut une jarre ŗ
tabac placťe sur une armoire. Il se fit assez de mal, se dťmit le
poignet, et BrianÁon fut sauvť.
Le physique de ce pauvre prince rendait ses rodomontades encore plus
ridicules. Il ressemblait en laid ŗ monsieur le duc d'AngoulÍme. Il
ťtait encore plus petit, encore plus chťtif; ses bras ťtaient plus
longs, ses jambes plus grÍles, ses pieds plus plats, sa figure plus
grimaÁante; enfin il atteignait davantage le type du singe auquel tous
deux aspiraient. Il souffrit horriblement de son poignet qui fut mal
remis par une espŤce de carabin ramenť de Sardaigne. Rossi, un des
plus habiles chirurgiens de l'Europe, ťtait consignť au seuil du
ch‚teau pour l'avoir franchi sous le gouvernement franÁais. Toutefois,
la douleur se fit sentir; au bout de dix ŗ douze jours, Rossi fut
appelť, le poignet bien remis et le Roi soulagť.
CHAPITRE VI
Rťponse de mon pŤre au premier chambellan du duc de ModŤne. --
Conduite du marťchal Suchet ŗ Lyon. -- Conduite du marťchal Brune
ŗ Toulon. -- Catastrophe d'Avignon. -- Expulsion des franÁais
rťsidant en Piťmont. -- Je quitte Turin. -- …tat de la Savoie. --
Passage de Monsieur ŗ Chambťry. -- FÍte de la Saint-Louis ŗ Lyon.
-- Pťnible aveu. -- Gendarmes rťcompensťs par l'Empereur. -- Les
soldats de l'armťe de la Loire. -- Leur belle attitude.
Les forfanteries du Roi et des siens, tout absurdes qu'elles ťtaient,
portaient pour nous un son fort dťsagrťable. Quelques semaines plus
tard, mon pŤre eut occasion d'en relever une d'une maniŤre trŤs
heureuse. Le duc de ModŤne vint voir son beau-pŤre; il y eut ŗ cette
occasion rťception ŗ la Cour. Mon pŤre s'y trouva auprŤs d'un groupe
oý le premier chambellan de ModŤne professait hautement la nťcessitť
et la facilitť de partager la France pour assurer le repos de
l'Europe. Il prit la parole et du ton le plus poli:
ęOserai-je vous prier, monsieur le comte, de m'indiquer les documents
historiques oý vous avez puisť qu'on peut disposer de la France comme
s'il s'agissait du duchť de ModŤne?Ľ
On peut croire que le premier chambellan resta trŤs dťcontenancť.
Cette boutade, qui contrastait si fort avec l'urbanitť habituelle de
mon pŤre, eut grand succŤs ŗ Turin oý on dťtestait les prťtentions de
l'allemand, duc de ModŤne.
Les ťvťnements de Belgique arrÍtŤrent la marche des armťes franÁaises
en Savoie, et laissŤrent le temps aux autrichiens de rťunir ŗ Chambťry
des forces trop considťrables pour pouvoir leur rťsister. L'occupation
de Grenoble, oý on ne laissa que des troupes piťmontaises, acheva
d'enorgueillir ces conquťrants improvisťs, et je ne sais si le chagrin
l'emportait sur la colŤre en pensant ŗ nos canons tombťs entre les
pattes des _Barbets_ du Roi. Quoique le fort Barraux tÓnt toujours, on
avait eu soin d'en laisser ťvader Jules de Polignac qui rejoignit le
quartier gťnťral de Bubna et assista ŗ l'attaque de Grenoble.
Ces souvenirs sont trŤs pťnibles pour y revenir volontiers; j'aime
mieux raconter deux faits qui, selon moi, honorent plus nos vieux
capitaines qu'un de ces succŤs militaires qui leur ťtaient si
familiers. Ils prouvent leur patriotisme.
Les Alliťs admettaient que, partout oý ils trouveraient le
gouvernement du roi Louis XVIII reconnu avant leur arrivťe, ils
n'exerceraient aucune spoliation. Mais aussi toutes les places oý ils
entreraient par force ou par capitulation devaient Ítre traitťes comme
pays conquis et le matťriel enlevť: Dieu sait s'ils ťtaient experts ŗ
tels dťmťnagements; Grenoble en faisait foi.
L'avant-garde, sous les ordres du gťnťral Bubna, s'approchait de Lyon.
Monsieur de Corcelles, commandant la garde nationale, se rendit auprŤs
du gťnťral, lui offrit de faire prendre ŗ la ville la cocarde
autrichienne ou la cocarde sarde, toutes enfin plutŰt que la cocarde
blanche. Mon ami Bubna, qui, tout aimable qu'il ťtait, n'avait pas une
bien sainte horreur pour le bien d'autrui, ťtait trop habile pour
autoriser les _patriotiques_ intentions de monsieur de Corcelles, mais
il ne les repoussa pas tout ŗ fait. Il lui dit que de si grandes
dťcisions ne s'improvisaient pas; il n'avait point d'instructions ŗ ce
sujet, mais il en demanderait. Sans doute, il ne serait pas
impossible que la maison de Savoie port‚t le siŤge de son royaume ŗ
Lyon, tandis que le Piťmont pourrait se rťunir ŗ la Lombardie. C'ťtait
matiŤre ŗ rťflexion; en attendant il ne fallait rien brusquer, et il
conseillait _tout simplement_ de garder la cocarde tricolore. L'armťe
autrichienne ferait son entrťe le lendemain matin, et il serait temps
de discuter ensuite les intťrÍts rťciproques.
Monsieur de Corcelles retourna ŗ Lyon et courut rendre compte de sa
dťmarche et de sa conversation au marťchal Suchet. Celui-ci le traita
comme le dernier des hommes, lui dit qu'il ťtait un misťrable, un
mauvais citoyen, que, quant ŗ lui, il aimerait mieux voir la France
rťunie sous une main quelconque que perdant un seul village. Il le
chassa de sa prťsence, lui Űta le commandement de la garde nationale,
fit chercher de tout cŰtť Jules de Polignac, monsieur de Chabrol,
monsieur de Sainneville (l'un prťfet, l'autre directeur de la police
avant les Cent-Jours), les installa lui-mÍme dans leurs fonctions et
ne s'ťloigna qu'aprŤs avoir fait arborer les couleurs royales. Bubna
les trouva dťployťes le lendemain ŗ son grand dťsappointement, mais il
n'osa pas s'en plaindre.
Au mÍme temps, les mÍmes rťsultats s'opťrŤrent ŗ Toulon avec des
circonstances un peu diffťrentes. Le marťchal Brune y commandait. La
garnison ťtait exaltťe jusqu'ŗ la passion pour le systŤme impťrial et
la ville partageait ses sentiments. Un matin, ŗ l'ouverture des
portes, le marquis de RiviŤre, l'amiral Ganteaume et un vieil ťmigrť,
le comte de Lardenoy, qui ťtait commandant de Toulon pour le Roi,
suivis d'un seul gendarme et portant tous quatre la cocarde blanche,
forcŤrent la consigne, entrŤrent au grand trot dans la place et
allŤrent descendre chez le marťchal avant que l'ťtonnement qu'avait
causť leur brusque apparition eŻt laissť le temps de les arrÍter. Ils
parvinrent jusque dans le cabinet oý le marťchal ťtait occupť ŗ
ťcrire. Surpris d'abord, il se remit immťdiatement, tendit la main ŗ
monsieur de RiviŤre qu'il connaissait, et lui dit:
ęJe vous remercie de cette preuve de confiance, monsieur le marquis,
elle ne sera pas trompťe.Ľ
Les nouveaux arrivťs lui montrŤrent la dťclaration des Alliťs, lui
apprirent qu'un corps austro-sarde s'avanÁait du cŰtť de Nice et
qu'une flotte anglaise se dirigeait sur Toulon. Dans l'impossibilitť
de le dťfendre d'une maniŤre efficace, puisque toute la France ťtait
envahie et le Roi dťjŗ ŗ Paris, le marťchal, en s'obstinant ŗ
conserver ses couleurs, coŻterait ŗ son pays l'immense matťriel de
terre et de mer contenu dans la place; les Alliťs n'ťpargneraient
rien; ils se h‚taient pour arriver avant qu'il eŻt reconnu le
gouvernement du Roi. Ces messieurs, se fiant ŗ son patriotisme
ťclairť, ťtaient venus lui raconter la situation telle qu'elle ťtait
et lui juraient sur l'honneur l'exactitude des faits.
Le marťchal lut attentivement les piŤces qui les confirmaient, puis il
ajouta:
ęEffectivement, messieurs, il n'y a pas un moment ŗ perdre. Je rťponds
de la garnison; je ne sais pas ce que je pourrai obtenir de la ville.
En tout cas, nous y pťrirons ensemble, mais je ne serai pas complice
d'une vaine obstination qui livrerait le port aux spoliations des
anglais.Ľ
Il s'occupa aussitŰt de rťunir les officiers des troupes, les
autoritťs de la ville et les meneurs les plus influents du parti
bonapartiste. Il les chapitra si bien que, peu d'heures aprŤs, la
cocarde blanche ťtait reprise et le vieux Lardenoy reconnu commandant.
Le marquis de RiviŤre ťtait homme ŗ apprťcier la loyautť du marťchal
et ŗ en Ítre fort touchť. Il l'engagea ŗ rester avec eux dans le
premier moment d'effervescence du peuple passionnť du Midi. Le
marťchal Brune persista ŗ vouloir s'ťloigner; peut-Ítre craignait-il
d'Ítre accusť de trahison par son parti. Quel que fŻt son motif, il
partit accompagnť d'un aide de camp de monsieur de RiviŤre; il le
renvoya se croyant hors des lieux oý il pouvait Ítre reconnu et
recourir quelque danger. On sait l'horrible catastrophe d'Avignon et
comment un peuple furieux et atroce punit la belle action que
l'histoire, au moins, devra consigner dans une noble page. On voudrait
pouvoir dire que la lie de la populace fut seule coupable; mais,
hťlas! il y avait parmi les acteurs de cette horrible scŤne des gens
que l'esprit de parti a tellement protťgťs que la justice des lois n'a
pu les atteindre. C'est une des vilaines taches de la Restauration.
La conduite des marťchaux Suchet et Brune m'a toujours inspirť
d'autant plus de respect que je n'ai pu me dissimuler qu'elle n'aurait
pas ťtť imitťe par des chefs royalistes. Il y en a bien peu d'entre
eux qui n'eussent prťfťrť remettre leur commandement, au risque de
pertes immenses pour la patrie, entre les mains de l'ťtranger, ŗ faire
replacer eux-mÍmes le drapeau tricolore, et, s'il s'en ťtait trouvť,
notre parti les aurait qualifiťs de traÓtres.
Dans les premiers jours de mars, le roi de Sardaigne avait publiť
l'ordre de chasser tous les franÁais de ses …tats. Les rapides succŤs
de l'Empereur lui imposŤrent trop pour qu'il os‚t l'exťcuter; mais,
dŤs que sa peur fut un peu calmťe par le gain de la bataille de
Waterloo, il donna des ordres pťremptoires et trouva des agents
impitoyables. Des franÁais, domiciliťs depuis trente ans,
propriťtaires, mariťs ŗ des piťmontaises, furent expulsťs de chez eux
par les carabiniers royaux, conduits aux frontiŤres comme des
malfaiteurs, sans qu'on invent‚t seulement d'articuler contre eux le
moindre reproche. Les femmes et les enfants vinrent porter leurs
larmes ŗ l'ambassade; nous en ťtions assaillis. Nous ne pouvions que
pleurer avec eux et partager leur profonde indignation.
Mon pŤre faisait officieusement toutes les rťclamations possibles. Ses
collŤgues du corps diplomatique se prÍtaient ŗ les appuyer et
tťmoignaient leur affliction et leur dťsapprobation de ces cruelles
mesures, mais rien ne les arrÍtait. Enfin, mon pŤre reÁut un courrier
du prince de Talleyrand pour lui annoncer que le gouvernement du roi
Louis XVIII ťtait reconstituť. Il se rendit aussitŰt chez le comte de
Valese et lui dťclara que, si ces persťcutions injustifiables
continuaient contre les sujets de S. M. T. C., il demanderait
immťdiatement ses passeports, qu'il en prťviendrait sa Cour et ťtait
sŻr d'Ítre approuvť.
Cette dťmarche sauva quelques malheureux qui avaient obtenu un sursis,
mais la plupart ťtaient dťjŗ partis ou au moins ruinťs par cette
manifestation intempestive de la peur et d'une puťrile vengeance
exercťe contre des innocents.
Cette circonstance acheva de m'indisposer contre les gouvernements
absolus et arbitraires. La maladie du pays m'avait gagnťe ŗ tel point
que je ne respirais plus dans ce triste Turin. J'ťprouvais un
vťritable besoin de m'en ťloigner, au moins pour un temps. Je me
dťcidai ŗ venir passer quelques semaines ŗ Paris oý j'ťtais appelťe
par des affaires personnelles.
Mon pŤre consentit d'autant plus facilement ŗ mon dťpart qu'il
dťsirait lui-mÍme avoir, sur ce qui se passait en France, des
renseignements plus exacts que ceux donnťs par les gazettes. Les
dťpÍches ťtaient rares et toujours peu explicites; ma correspondance
serait dťtaillťe et quotidienne. J'ťtais faite ŗ me servir de sa
lunette; il ne pouvait avoir un observateur qui lui fŻt plus commode.
J'ai dit que mon frŤre avait rejoint son prince ŗ Barcelone; il y
sťjourna et l'accompagna ŗ Bourg-Madame. Monsieur le duc d'AngoulÍme
l'envoya porter ses dťpÍches au Roi dŤs qu'il le sut ŗ Paris. Le Roi
le renvoya ŗ son neveu; il lui fallut traverser deux fois l'armťe de
la Loire, ce qui ne fut pas sans quelque danger, ŗ ce premier moment.
Toutefois, il remplit heureusement sa double mission et obtint pour
rťcompense la permission de venir embrasser ses parents. J'attendis
son arrivťe et, aprŤs avoir passť quelques jours avec lui, je le
prťcťdai sur la route de Paris oý il devait venir me rejoindre
promptement.
Je quittai Turin, le 18 aoŻt, jour de la Sainte-HťlŤne, aprŤs avoir
souhaitť la fÍte ŗ ma mŤre pour laquelle mon absence n'avait pas de
compensation et qui en ťtait dťsolťe. Elle devait, le lendemain,
accompagner mon pŤre ŗ GÍnes oý, pour cette fois, la Reine arriva sans
obstacles. Elle dťbarqua de Sardaigne avec un costume et des faÁons
qui ne rappelaient guŤre l'ťlťgante et charmante duchesse d'Aoste dont
le Piťmont conservait le souvenir. Elle s'y est fait dťtester, je ne
sais si c'est avec justice; je n'ai plus eu de rapports personnels
avec ce pays et on ne peut s'en faire une idťe un peu juste qu'en
l'habitant. Il y a toujours une extrÍme rťticence dans les rťcits
qu'en font les piťmontais.
Je m'arrÍtai quelques jours ŗ Chambťry. J'y appris les circonstances
exactes de la trahison des troupes et surtout celle de monsieur de La
BťdoyŤre. Il ťtait ťvident qu'il travaillait d'avance son rťgiment et
que les ťvťnements de Grenoble avaient ťtť rien moins que spontanťs.
Les esprits ťtaient fort ťchauffťs en Savoie. L'ancienne noblesse
dťsirait ardemment rentrer sous le sceptre de la maison de Savoie. La
bourgeoisie aisťe ou commerÁante, tous les industriels voulaient
rester franÁais. Les paysans ťtaient prÍts ŗ crier: ęVive le Roi
sarde!Ľ dŤs que leurs curťs le leur ordonneraient. Jusqu'alors les
voeux, les craintes et les rťpugnances s'exprimaient encore tout bas;
on se bornait ŗ se dťtester cordialement de part et d'autre.
Peu avant les Cent-Jours, Monsieur avait fait un voyage dans le Midi;
sa gr‚ce et son obligeance lui avaient procurť de grands succŤs. ņ
Chambťry, il logea chez monsieur de Boigne et le traita avec bontť. Le
lendemain, avant de partir, le duc de Maillť lui remit de la part du
prince six croix d'honneur, ŗ distribuer dans la ville. Monsieur de
Boigne n'avait pas fait de mauvais choix; mais, cela dťpendait de lui.
Les diplŰmes avaient ťtť remplis des noms qu'il indiquait, sans autre
renseignement.
Il paraÓt que, dans tout ce voyage, Monsieur payait ainsi son ťcot ŗ
ses hŰtes. On a cru que la prodigalitť avec laquelle on a semť la
croix d'honneur en 1814 avait un but politique et qu'on voulait la
discrťditer. Je ne le pense pas; seulement elle n'avait aucun prix aux
yeux de nos princes et ils la donnaient comme peu de valeur. On
conÁoit ŗ quel point cela devait irriter les gens qui avaient versť
leur sang pour l'obtenir.
C'est par cette ignorance du pays, plus que par propos dťlibťrť, que
les princes de la maison de Bourbon choquaient souvent, sans s'en
douter, les intťrÍts et les prťjugťs nationaux nťs pendant leur longue
absence. Ils ne se donnaient pas la peine de les apprendre ni de s'en
informer, bien persuadťs qu'ils se tenaient d'Ítre rentrťs dans leur
patrimoine. Jamais ils n'ont pu comprendre qu'ils occupaient une
place, ŗ charge d'‚mes, qui imposait du travail et des devoirs.
J'arrivai ŗ Lyon le 25 aoŻt. Avec l'assistance de la garnison
autrichienne, on y cťlťbrait bruyamment la fÍte de la Saint-Louis. La
ville ťtait illuminťe; on tirait un feu d'artifice; la population
entiŤre semblait y prendre part. On se demandait ce qu'ťtait devenue
cette autre foule qui, naguŤre, avait accueilli Bonaparte avec de si
grands transports. J'ai assistť ŗ tant de pťripťties dans les
acclamations populaires que je me suis souvent adressť cette question.
Je crois que ce sont les mÍmes masses, mais diversement ťlectrisťes
par un petit noyau de personnes exaltťes, qui changent et sont
entraÓnťes dans des sens diffťrents; mais la mÍme foule est ťgalement
de bonne foi dans ses diverses palinodies.
Me voici arrivťe ŗ une confession bien pťnible. Je pourrais
l'ťpargner, puisqu'elle ne regarde que moi et qu'un sentiment intime;
mais je me suis promis de dire la vťritť sur tout le monde; je la
cherche aussi en moi. Il faut qu'on sache jusqu'oý la passion de
l'esprit de parti peut dťnaturer le coeur.
En arrivant ŗ l'hŰtel de l'Europe, je demandai les gazettes; j'y lus
la condamnation de monsieur de La BťdoyŤre et j'ťprouvai un mouvement
d'horrible joie. ęEnfin, me dis-je, voilŗ un de ces misťrables
traÓtres puni!Ľ Ce mouvement ne fut que passager; je me fis
promptement horreur ŗ moi-mÍme; mais, enfin, il a ťtť assez positif
pour avoir pesť sur ma conscience. C'est depuis ce moment, depuis le
dťgoŻt et le remords qu'il m'inspire, que j'ai abjurť, autant qu'il
dťpend de moi, les passions de l'esprit de parti et surtout ses
vengeances.
Je pourrais, ŗ la rigueur, me chercher une excuse dans tout ce que je
venais d'apprendre ŗ Chambťry sur la conduite de monsieur de La
BťdoyŤre, dans les tristes rťsultats que sa coupable trahison avait
attirťs, dans l'aspect de la patrie dťchirťe et envahie par un million
d'ťtrangers; mais rien n'excuse, dans un coeur fťminin, la pensťe
d'une sanglante vengeance, et il faut en renvoyer l'horreur ŗ qui il
appartient, ŗ l'esprit de parti, monstre dont on ne peut trop
repousser les approches quand on vit dans un temps de rťvolution et
qu'on veut conserver quelque chose d'humain.
Je passai deux jours ŗ Lyon oý se trouvaient rťunies plusieurs
personnes avec lesquelles j'ťtais liťe parmi les franÁais et les
ťtrangers. On me donna les dťtails des ťvťnements de Paris. Les avis
ťtaient divers sur le rŰle qu'y avait jouť Fouchť, mais tout le monde
s'accordait ŗ dire qu'il ťtait entrť dans le conseil de Louis XVIII ŗ
la sollicitation de Monsieur, excitť par les plus exaltťs du parti
ťmigrť. C'est ŗ Lyon que me furent racontťs les faits que j'ai
rapportťs sur la conduite du marťchal Suchet. J'appris aussi une
circonstance qui me frappa.
Lorsque Monsieur fit cette triste expťdition, au moment du retour de
l'Óle d'Elbe, il fut obligť de quitter la ville par la route de Paris,
tandis que toute la garnison et les habitants se prťcipitaient sur
celle de Grenoble au-devant de Napolťon. Deux gendarmes, seuls de
l'escorte commandťe, se prťsentŤrent pour accompagner sa voiture. Le
lendemain, ils furent dťnoncťs ŗ l'Empereur. Il les fit rechercher et
leur donna de l'avancement. On ne peut nier que cet homme n'eŻt
l'instinct gouvernemental.
Mon sťjour ŗ Lyon avait ťtť forcť; il fallait attendre que la route
fŻt _libre_, c'est-ŗ-dire complŤtement occupťe par des garnisons
ťtrangŤres. Je conserve encore le passeport ŗ l'aide duquel j'ai
traversť notre triste patrie dans ces jours de dťtresse. Il est
curieux par la quantitť de _visas_, en toutes langues, dont il est
couvert.
Si ces formalitťs ťtaient pťnibles, les routes offraient un spectacle
consolant pour un coeur franÁais, malgrť son amertume. C'ťtait la
magnifique attitude de nos soldats licenciťs. Rťunis par bandes de
douze ou quinze, vÍtus de leur uniforme, propres et soignťs comme en
jour de parade, le b‚ton blanc ŗ la main, ils regagnaient leurs
foyers, tristes mais non accablťs et conservant une dignitť dans les
revers qui les montrait dignes de leurs anciens succŤs.
J'avais laissť l'Italie infestťe de brigands crťťs par la petite
campagne de Murat. Le premier groupe de soldats de la Loire que je
rencontrai, en me rappelant ce souvenir, m'inspira un peu de crainte;
mais, dŤs que je les eus envisagťs, je ne ressentis plus que l'ťmotion
de la sympathie. Eux-mÍmes semblaient la comprendre. Les plus en avant
des bandes que je dťpassais me regardaient fixement comme pour
chercher ŗ deviner ŗ quoi j'appartenais, mais les derniers me
saluaient toujours. Ils m'inspiraient ce genre de pitiť que le poŤte a
qualifiťe de _charmante_ et que la magnanimitť commande forcťment
quand on n'a pas perdu tout sentiment gťnťreux.
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus beau dans l'histoire
que la conduite gťnťrale de l'armťe et l'attitude personnelle des
soldats ŗ cette ťpoque. La France a droit de s'en enorgueillir. Je
n'attendis pas le jour de la justice pour en Ítre enthousiasmťe et,
dŤs lors, je les considťrais avec respect et vťnťration. Il est bien
remarquable en effet, que, dans un moment oý plus de cent cinquante
mille hommes furent renvoyťs de leurs drapeaux et rejetťs, sans ťtat,
dans le pays, il n'y eut pas un excŤs, pas un crime commis dans toute
la France qui pŻt leur Ítre imputť. Les routes restŤrent ťgalement
sŻres; les ch‚teaux conservŤrent leur tranquillitť; les villes, les
bourgs et les villages acquirent des citoyens utiles, des ouvriers
intelligents, des chroniqueurs intťressants.
Rien ne fait plus l'ťloge de la conscription que cette noble conduite
des soldats qu'elle a produits; je la crois unique dans les siŤcles.
J'ťtais ennemie des soldats de Waterloo. Je les qualifiais, ŗ juste
titre, de traÓtres depuis trois mois, mais je n'eus pas fait une
journťe de route sans Ítre fiŤre de mes glorieux compatriotes.
CHAPITRE VII
Madame de La BťdoyŤre. -- Son courage. -- Son dťsespoir. -- Sa
rťsignation. -- La comtesse de KrŁdener. -- Elle me fait une
singuliŤre rťception. -- Rťcit de son arrivťe ŗ Heidelberg. --
Son influence sur l'empereur Alexandre. -- Elle l'exerce en
faveur de monsieur de La BťdoyŤre. -- Saillie de monsieur de
Sabran. -- Pacte de la Sainte-Alliance. -- Soumission de Benjamin
Constant ŗ madame de KrŁdener. -- Son amour pour madame Rťcamier.
-- Sa conduite au 20 mars. -- Sa lettre au roi Louis XVIII.
Comme pour me faire mieux sentir l'horreur du cruel sentiment que
j'avais ťprouvť au sujet de monsieur de La BťdoyŤre, je trouvai Paris
encore tout ťmu de ses derniers moments.
Lorsqu'en 1791, le comte et la comtesse de Chastellux avaient suivi
madame Victoire ŗ Rome, deux de leurs cinq enfants (Henri et Georgine)
ťtaient restťs en France oý leur grand'mŤre les avait ťlevťs dans la
retraite absolue d'un petit ch‚teau de Normandie. ņ sa mort, Georgine
alla rejoindre, en Italie, ses parents qui bientŰt revinrent ŗ Paris.
Elle ne put jamais vaincre l'extrÍme timiditť nťe de la solitude oý
elle avait vťcu jusqu'ŗ dix-huit ans. Elle y avait connu Charles de La
BťdoyŤre; les terres de leurs mŤres se trouvaient situťes dans le mÍme
canton. La petite voisine inspira dŤs l'enfance une affection qu'elle
partagea. Elle devint trŤs jolie et monsieur de La BťdoyŤre trŤs
amoureux. Henry de Chastellux, dont il avait ťtť le camarade de
collŤge, encouragea ce sentiment. Les La BťdoyŤre, dans l'espoir de
fixer leur fils, s'en rťjouirent; les Chastellux y consentirent et,
peu de temps avant la Restauration, le mariage eut lieu.
Charles de La BťdoyŤre faisait des dettes, aimait le jeu, les femmes,
et surtout la guerre. Du reste, il ťtait bon enfant, spirituel, gai,
loyal, franc, gťnťreux, promettait de se corriger de tous ses travers
et comptait de bonne foi y rťussir. Tel qu'il ťtait, Georgine
l'adorait; mais c'ťtait ŗ si petit bruit, elle ťtait si craintive de
paraÓtre et de se montrer qu'on pouvait vivre avec elle des mois
entiers sans dťcouvrir ses sentiments. C'est sans comparaison la
personne la plus modestement retirťe en elle-mÍme que j'aie jamais
rencontrťe.
Au retour de Bonaparte, elle se dťsola du rŰle que son mari avait
jouť. Quoique ŗ peine relevťe de couches, elle quitta sa maison, se
rťfugia chez ses parents et, lorsqu'il arriva ŗ la suite de
l'Empereur, elle refusa de le voir. Les ťvťnements ayant amenť une
prompte rťaction, elle reprit ses relations avec lui dŤs qu'il fut
malheureux et chercha ŗ dťnaturer sa fortune pour lui procurer des
moyens d'ťvasion. Elle comptait le rejoindre avec leur enfant. Je
crois que c'est pour complťter ces arrangements qu'il revint ŗ Paris
oý il fut arrÍtť.
AussitŰt, cette femme si timide devint une hťroÔne. Les visites, les
priŤres, les supplications, les importunitťs, rien ne lui coŻtait.
Elle alla solliciter sa famille d'employer son crťdit, de lui prÍter
son assistance; personne ne voulut l'accompagner ni faire aucune
dťmarche. Privťe de tout secours, elle ne s'abandonna pas elle-mÍme.
Elle heurta ŗ toutes les portes, forÁa celles qu'on refusait de lui
ouvrir, parvint jusqu'ŗ madame la duchesse d'AngoulÍme sans pouvoir
l'attendrir, et dťploya partout un courage de lion.
Ayant tout ťpuisť, elle eut recours ŗ madame de KrŁdener. Cette
derniŤre visite lui ayant offert un faible rayon d'espoir, la pauvre
jeune mŤre, portant son enfant dans ses bras, courut ŗ l'abbaye pour
le communiquer ŗ son mari. Elle trouva la place encombrťe de monde: un
fiacre environnť de troupes ťtait arrÍtť devant la porte de la prison;
un homme y montait. Un cri affreux se fit entendre; elle avait reconnu
monsieur de La BťdoyŤre. La scŤne n'ťtait que trop expliquťe. L'enfant
tomba de ses mains; elle se prťcipita dans la fatale voiture, et
perdit connaissance. Charles la reÁut dans ses bras, l'embrassa
tendrement, la remit aux soins d'un serviteur fidŤle qui, dťjŗ,
s'ťtait emparť de l'enfant et, profitant de son ťvanouissement, fit
fermer la portiŤre de la voiture. Sa fin ne dťmentit pas le courage
qu'il avait souvent montrť sur les champs de bataille. Madame de La
BťdoyŤre fut ramenťe chez elle sans avoir repris le sentiment de sa
misŤre.
ņ dater de ce moment, elle est rentrťe dans sa timiditť native.
Pendant longtemps elle a refusť de voir sa famille. Elle ne lui
pardonnait pas son cruel stoÔcisme.
Vingt annťes se sont ťcoulťes au moment oý j'ťcris, et sa tristesse ne
s'est pas dťmentie un seul jour. En revanche, ses sentiments
royalistes se sont exaltťs jusqu'ŗ la passion. Le sang de la victime
sacrifiťe ŗ la Restauration lui a semblť un holocauste qui devait en
assurer la durťe et la gloire. Elle a ťlevť son fils dans ces idťes;
pour elle, la lťgitimitť est une religion.
J'ai dťjŗ dit avec quelle pacifique lenteur son frŤre Henry avait
habitude de voyager. Je ne sais oý il se trouvait lors de la
catastrophe. Mais son absence ayant permis ŗ Georgine d'espťrer qu'il
l'aurait assistťe dans ces affreux moments, s'il avait ťtť ŗ Paris,
elle avait reportť sur lui toute la tendresse qui n'ťtait pas absorbťe
par son fils et sa douleur. Ce n'est qu'au mariage d'Henry avec
mademoiselle de Duras (ŗ l'occasion duquel il prit le nom de duc de
Rauzan) qu'elle consentit ŗ revoir sa famille. Elle a toujours vťcu
dans la retraite la plus austŤre.
Le nom de madame de KrŁdener s'est trouvť tout ŗ l'heure sous ma
plume; mes rapports avec elle ne sont venus qu'un peu plus tard, mais
je puis aussi bien les rapporter ici.
Je fus menťe chez elle par madame Rťcamier. Je trouvai une femme d'une
cinquantaine d'annťes qui avait dŻ Ítre extrÍmement jolie. Elle ťtait
maigre, p‚le; sa figure portait la trace des passions; ses yeux
ťtaient caves mais trŤs beaux, son regard plein d'expression. Elle
avait cette voix sonore, douce, flexible, timbrťe, un des plus grands
charmes des femmes du Nord. Ses cheveux gris, sans aucune frisure et
partagťs sur le front, ťtaient peignťs avec une extrÍme propretť. Sa
robe noire, sans ornement, n'excluait cependant pas l'idťe d'une
certaine recherche. Elle habitait un grand et bel appartement dans un
hŰtel de la rue du Faubourg-Saint-Honorť. Les glaces, les dťcorations,
les ornements de toute espŤce, les meubles, tout ťtait recouvert de
toile grise; les pendules elles-mÍmes ťtaient enveloppťes de housses
qui ne laissaient voir que le cadran. Le jardin s'ťtendait jusqu'aux
Champs-…lysťes; c'ťtait par lŗ que l'empereur Alexandre, logť ŗ
l'…lysťe-Bourbon, se rendait chez madame de KrŁdener ŗ toutes les
heures du jour et de la nuit.
Notre arrivťe avait interrompu une espŤce de leÁon qu'elle faisait ŗ
cinq ou six personnes. AprŤs les politesses d'usage qu'elle nous
adressa avec aisance et toutes les formes usitťes dans le grand monde,
elle la continua. Elle parlait sur la foi. L'expression de ses yeux et
le son de sa voix changŤrent seuls lorsqu'elle reprit son discours. Je
fus ťmerveillťe de l'abondance, de la facilitť, de l'ťlťgance de son
improvisation. Son regard avait tout ŗ la fois l'air vague et inspirť.
Au bout d'une heure et demie, elle cessa de parler, ses yeux se
fermŤrent, elle sembla tomber dans une sorte d'anťantissement; les
adeptes m'avertirent que c'ťtait le signal de la retraite. J'avais ťtť
assez intťressťe. Cependant je ne comptais pas assister ŗ une seconde
reprťsentation. Elles ťtaient ŗ jour fixe. Je crus convenable d'en
choisir un autre pour laisser mon nom ŗ la porte de madame de
KrŁdener. ņ ma surprise, je fus admise, elle ťtait seule.
ęJe vous attendais, me dit-elle, _la voix_ m'avait annoncť votre
visite; j'espŤre de vous, mais pourtant ... j'ai ťtť trompťe si
souvent!!Ľ
Elle tomba dans un silence que je ne cherchai pas ŗ rompre, ne sachant
pas quel ton adopter. Elle reprit enfin et me dit que _la voix_
l'avait prťvenue qu'elle aurait dans la ligne des _prophťtesses_ une
successeur qu'elle formerait et qui ťtait destinťe ŗ aller plus prŤs
qu'elle de la divinitť; car elle ne faisait qu'_entendre_, et celle-lŗ
_verrait_!
_La voix_ lui avait annoncť que cette prťdestinťe devait Ítre une
femme ayant conservť dans le grand monde des moeurs pures. Madame de
KrŁdener la rencontrerait au moment oý elle s'y attendrait le moins et
sans qu'aucun prťcťdent eŻt prťparť leur liaison. Ses rÍves, qu'elle
n'osait appeler des visions (car, hťlas! elle n'ťtait pas appelťe ŗ
_voir_) la lui avaient reprťsentťe sous quelques-uns de mes traits. Je
me dťfendis avec une modestie trŤs sincŤre d'Ítre appelťe ŗ tant de
gloire. Elle plaida ma cause vis-ŗ-vis de moi-mÍme avec la chaleur la
plus entraÓnante et de maniŤre ŗ me toucher au point que mes yeux se
remplirent de larmes. Elle crut avoir acquis un disciple, si ce n'est
un successeur, et m'engagea fort ŗ revenir souvent la voir. Pendant
cette matinťe, car sa fascination me retint plusieurs heures, elle me
raconta comment elle se trouvait ŗ Paris.
Dans le courant de mai 1815, elle se rendait au sud de l'Italie oý son
fils l'attendait. Entre Bologne et Sienne, les souffrances qu'elle
ressentit l'avertirent qu'elle s'ťloignait de la route qu'il lui
appartenait de suivre. AprŤs s'Ítre dťbattue toute une nuit contre
cette vive contrariťtť, elle se rťsigna et revint sur ses pas. Le
bien-Ítre immťdiat qu'elle ťprouva lui indiqua qu'elle ťtait dans la
bonne voie. Il continua jusqu'ŗ ModŤne, mais quelques lieues faites
sur la route de Turin lui rendirent ses anxiťtťs; elles cťdŤrent dŤs
qu'elle se dirigea sur Milan.
En arrivant dans cette ville, elle apprit qu'un cousin, son camarade
d'enfance, aide de camp de l'empereur Alexandre, ťtait tombť
dangereusement malade en Allemagne. Voilŗ la volontť de _la voix_
expliquťe; sans doute elle est destinťe ŗ porter la lumiŤre dans cette
‚me, ŗ consoler cet ami souffrant. Elle franchit le Tyrol, encouragťe
par les sensations les plus douces. Elle se rend ŗ Heidelberg oý se
trouvaient les souverains alliťs; son cousin ťtait restť malade dans
une autre ville. Elle s'informe du lieu et partie lendemain matin
n'ayant vu personne.
Mais ŗ peine a-t-elle quittť Heidelberg que son malaise se renouvelle
et plus violemment que jamais. Elle cŤde enfin et, au bout de quelques
postes, elle reprend la route de Heidelberg. La tranquillitť renaÓt en
elle; il lui devient impossible de douter que sa mission ne soit pour
ce lieu; elle ne la devine pas encore. L'empereur Alexandre va faire
une course de quelques jours et le tourment qu'elle ťprouve pendant
son absence lui indique ŗ qui elle est appelťe ŗ faire voir la
lumiŤre. Elle se dťbat vainement contre la volontť de _la voix_; elle
prie, elle jeŻne, elle implore que ce calice s'ťloigne d'elle: _la
voix_ est impitoyable, il faut obťir.
La comtesse de KrŁdener ne me raconta pas par quel moyen elle ťtait
arrivťe dans l'intimitť de l'Empereur, mais elle y ťtait parvenue.
Elle avait inventť pour lui une nouvelle forme d'adulation. Il ťtait
blasť sur celles qui le reprťsentaient comme le premier potentat de la
terre, l'Agamemnon des rois, etc., aussi ne lui parla-t-elle pas de sa
puissance mondaine, mais de la puissance mystique de ses priŤres. La
puretť de son ‚me leur prÍtait une force qu'aucun autre mortel ne
pouvait atteindre, car aucun n'avait ŗ rťsister ŗ tant de sťductions.
En les surmontant, il se montrait l'homme le plus vertueux et
consťquemment le plus puissant auprŤs de Dieu. C'est ŗ l'aide de cette
habile flatterie qu'elle le conduisait ŗ sa volontť. Elle le faisait
prier pour elle, pour lui, pour la Russie, pour la France. Elle le
faisait jeŻner, donner des aumŰnes, s'imposer des privations, renoncer
ŗ tous ses goŻts. Elle obtenait tout de lui dans l'espoir d'accroÓtre
son crťdit dans le ciel. Elle indiquait plutŰt qu'elle n'exprimait,
que _la voix_ ťtait Jťsus-Christ. Elle ne l'appelait jamais que _la
voix_ et avec des torrents de larmes elle avouait que les erreurs de
sa jeunesse lui interdisaient ŗ jamais l'espoir de _voir_. Il est
impossible de dire avec quelle onction elle peignait le sort de celle
appelťe ŗ _voir_!
Sans doute, en lisant cette froide rťdaction, on dira: c'ťtait une
folle ou bien une intrigante. Peut-Ítre la personne qui portera ce
jugement aurait-elle ťtť sous le charme de cette brillante
enthousiaste. Quant ŗ moi, peu disposťe ŗ me passionner, je me mťfiai
assez de l'empire qu'elle pouvait exercer pour n'y plus retourner que
de loin en loin et ses jours de rťception; elle y ťtait moins
sťduisante que dans le tÍte-ŗ-tÍte.
J'ai quelquefois pensť que monsieur de Talleyrand, se sentant trop
brouillť avec l'empereur Alexandre pour espťrer reprendre une
influence personnelle sur lui, avait trouvť ce moyen d'en exercer. Il
est certain que la comtesse de KrŁdener ťtait trŤs favorable ŗ la
France pendent cette triste ťpoque de 1815; et, quand elle avait fait
passer plusieurs heures en priŤres ŗ l'empereur Alexandre pour qu'un
nuage dťcouvert par elle sur l'ťtoile de la France s'en ťloign‚t,
quand elle lui avait demandť d'employer ŗ cette oeuvre la force de sa
mťdiation dans le ciel, quand elle lui avait assurť que _la voix_
l'annonÁait exaucť, il ťtait bien probable que si, ŗ la confťrence du
lendemain, quelque article bien dťsastreux pour la France ťtait
rťclamť par les autres puissances, l'Empereur, venant au secours du
suppliant, appuierait ses priŤres mystiques du poids de sa grandeur
terrestre.
Ce n'ťtait pas exclusivement pour les affaires publiques que madame de
KrŁdener employait Alexandre. Voici ce qui arriva au sujet de monsieur
de La BťdoyŤre. Sa jeune femme, comme je l'ai dit, vint supplier la
comtesse de faire demander sa gr‚ce par l'empereur Alexandre. Elle
l'accueillit avec autant de bienveillance que d'ťmotion et promit tout
ce qui lui serait _permis_. En consťquence, elle s'enferma dans son
oratoire. L'heure se passait; l'Empereur la trouva en larmes et dans
un ťtat affreux. Elle venait de livrer un long combat ŗ _la voix_ sans
en obtenir la permission de prťsenter la requÍte ŗ l'Empereur. Il ne
devait prendre aucun parti dans cette affaire, hťlas! Et la sentence
ťtait d'autant plus rigoureuse que l'‚me de monsieur de La BťdoyŤre
n'ťtait pas en ťtat de gr‚ce. L'exťcution eut lieu.
Alors, madame de KrŁdener persuada ŗ l'Empereur qu'il lui restait un
grand devoir ŗ remplir. Il fallait employer en faveur de ce
malheureux, qu'il avait fait le sacrifice d'abandonner aux vengeances
humaines, l'influence de sa puissante protection prŤs de Dieu. Elle le
retint huit heures d'horloge dans son oratoire, priant, agenouillť sur
le marbre. Elle le congťdia ŗ deux heures du matin; ŗ huit, un billet
d'elle lui apprenait que _la voix_ lui avait annoncť que les voeux de
l'Empereur ťtaient exaucťs. Elle ťcrivit en mÍme temps ŗ la dťsolťe
madame de La BťdoyŤre, qu'aprŤs avoir passť quelques heures en
purgatoire, son mari devait ŗ l'intercession des priŤres de l'Empereur
une excellente place en paradis, qu'elle avait la satisfaction de
pouvoir le lui affirmer, bien persuadťe que c'ťtait le meilleur
soulagement ŗ sa douleur.
J'avais eu connaissance de cette lettre et du transport de douleur,
poussť presque jusqu'ŗ la fureur, qu'elle avait causť ŗ Georgine.
J'interrogeai avec rťticence madame de KrŁdener ŗ ce sujet; elle
l'aborda franchement et me raconta tout ce que je viens de rťpťter.
Je me rappelle une scŤne assez comique dont je fus tťmoin chez elle.
Nous nous y trouv‚mes sept ou huit personnes rťunies un matin. Elle
nous parlait, de son ton inspirť, des vertus surnaturelles de
l'empereur Alexandre et elle vantait beaucoup le courage avec lequel
il renonÁait ŗ son intimitť avec madame de Narishkine, sacrifiant
ainsi ŗ ses devoirs ses sentiments les plus chers et une liaison de
seize annťes.
ęHťlas! s'ťcria Elzťar de Sabran (avec une expression de componction
inimitable), hťlas! quelquefois, en ce genre, on renonce plus
facilement ŗ une liaison de seize annťes qu'ŗ une de seize journťes!Ľ
Nous partÓmes tous d'un ťclat de rire, et madame de KrŁdener nous en
donna l'exemple; mais bientŰt, reprenant son rŰle, elle se retira au
bout de la chambre comme pour faire excuse ŗ _la voix_ de cette
incongruitť.
Quel que fŻt le motif qui dirige‚t madame de KrŁdener (et pour moi je
la crois enthousiaste de bonne foi) elle ťtait parvenue ŗ jouer un
rŰle trŤs important. AprŤs avoir protťgť la France dans tout le cours
des nťgociations pour la paix, elle a ťtť la vťritable promotrice de
la Sainte-Alliance. Elle a accompagnť l'Empereur au fameux camp de
Vertus, et la dťclaration que les souverains y ont signťe, appelťe dŤs
lors le pacte de la Sainte-Alliance, a ťtť rťdigťe par Bergasse, autre
illuminť dans le mÍme genre, sous ses yeux et par ses ordres. Les
russes et les entours de l'Empereur ťtaient fort contrariťs du
ridicule qui s'attachait ŗ ses rapports avec madame de KrŁdener, et le
comte de Nesselrode me reprocha, avec une sorte d'impatience, d'avoir
ťtť chez cette intrigante, comme il la qualifiait.
Au nombre de ses adeptes les plus ardents semblait Ítre Benjamin
Constant. Je dis _semblait_, parce qu'il a toujours ťtť fort difficile
de dťcouvrir les vťritables motifs des actions de monsieur Constant.
Elle le faisait jeŻner, prier, l'accablait d'austťritťs, au point que
sa santť s'en ressentit et qu'il ťtait horriblement changť. Sur la
remarquť qui lui en fut faite, madame de KrŁdener rťpondit qu'il lui
ťtait bon de souffrir, car il avait beaucoup ŗ expier, mais que le
temps de sa probation avanÁait. Je ne sais si c'est prťcisťment _la
voix_ que Benjamin cherchait ŗ se concilier, ou s'il voulait s'assurer
la protection spťciale de l'Empereur, car ŗ cette ťpoque sa position
en France ťtait si fausse qu'il pensait ŗ s'expatrier.
Madame Rťcamier avait trouvť dans son exil la fontaine de Jouvence.
Elle ťtait revenue d'Italie, en 1814, presque aussi belle et beaucoup
plus aimable que dans sa premiŤre jeunesse. Benjamin Constant la
voyait familiŤrement depuis nombre d'annťes, mais tout ŗ coup il
s'enflamma pour elle d'une passion extravagante. J'ai dťjŗ dit
qu'elle avait toujours un peu de sympathie et beaucoup de
reconnaissance pour tous les hommes amoureux d'elle. Benjamin puisa
amplement dans ce fonds gťnťral. Elle l'ťcoutait, le plaignait,
s'affligeait avec lui de ne pouvoir partager un sentiment si
ťloquemment exprimť.
Il ťtait ŗ l'apogťe de cette frťnťsie au moment du retour de Napolťon.
Madame Rťcamier en fut accablťe; elle craignait de nouvelles
persťcutions. Benjamin, trop enthousiaste pour ne pas adopter
l'impression de la femme dont il ťtait ťpris, ťcrivit, sous cette
influence, une diatribe pleine de verve et de talent contre
l'Empereur. Il y annonÁait son hostilitť ťternelle. Elle fut imprimťe
dans le _Moniteur_ du 19 mars. Louis XVIII abandonna la capitale dans
la nuit.
Quand le pauvre Benjamin apprit cette nouvelle, la terreur s'empara de
son coeur qui n'ťtait pas si haut placť que son esprit. Il courut ŗ la
poste: point de chevaux; les diligences, les malles-postes, tout ťtait
plein; aucun moyen de s'ťloigner de Paris. Il alla se cacher dans un
rťduit qu'il espťrait introuvable. Qu'on juge de son effroi lorsque,
le lendemain, on vint le chercher de la part de Fouchť. Il se laisse
conduire plus mort que vif. Fouchť le reÁoit trŤs poliment et lui dit
que l'Empereur veut le voir sur-le-champ. Cela lui paraÓt ťtrange;
cependant il se sent un peu rassurť. Il arrive aux Tuileries, toutes
les portes tombent devant lui.
L'Empereur l'accoste de la mine la plus gracieuse, le fait asseoir et
entame la conversation en lui assurant que l'expťrience n'a pas ťtť
chose vaine pour lui. Pendant les longues veilles de l'Óle d'Elbe, il
a beaucoup rťflťchi ŗ sa situation et aux besoins de l'ťpoque;
ťvidemment les hommes rťclament des institutions libťrales. Le tort de
son administration a ťtť de trop nťgliger les publicistes comme
monsieur Constant. Il faut ŗ l'Empire une constitution et il
s'adresse ŗ ses hautes lumiŤres pour la rťdiger.
Benjamin, passant en une demi-heure de la crainte d'un cachot ŗ la
joie d'Ítre appelť ŗ faire le petit Solon et ŗ voir ainsi s'accomplir
le rÍve de toute sa vie, pensa se trouver mal d'ťmotion. La peur et la
vanitť s'ťtaient partagť son coeur; la vanitť y demeura souveraine. Il
fut transportť d'admiration pour le grand Empereur qui rendait si
ample justice au mťrite de Benjamin Constant; et l'auteur de l'article
du _Moniteur_ du 19 ťtait, le 22, conseiller d'…tat et prŰneur en
titre de Bonaparte.
Il se prťsenta, un peu honteux, chez madame Rťcamier; elle n'ťtait pas
femme ŗ lui tťmoigner du mťcontentement. Peut-Ítre mÍme fut-elle bien
aise de se trouver dťlivrťe de la responsabilitť qui aurait pesť sur
elle s'il avait ťtť persťcutť pour des opinions qui ťtaient
d'entraÓnement plus que de conviction. Les partis furent moins
charitables. Les libťraux ne pardonnŤrent pas ŗ Benjamin son hymne
pour les Bourbons et la lťgitimitť, les impťrialistes ses sarcasmes
contre Napolťon, les royalistes sa prompte palinodie du 19 au 21 mars
et le rŰle qu'il joua ŗ la fin des Cent-Jours lorsqu'il alla
solliciter des souverains ťtrangers un maÓtre quelconque pourvu que ce
ne fŻt pas Louis XVIII.
Toutes ces variations l'avaient fait tomber dans un mťpris universel.
Il le sentait et s'en dťsolait. C'ťtait dans cette disposition qu'il
s'ťtait remis entre les mains de madame de KrŁdener. …tait-ce avec un
but mondain ou seulement pour donner le change ŗ son imagination
malade? c'est ce que je n'oserais dťcider. Il allait encore chercher
des consolations auprŤs de madame Rťcamier; elle le traitait avec
douceur et bontť. Mais, au fond, il lui savait mauvais grť de
l'article inspirť par elle et cette circonstance avait ťtť la crise de
sa grande passion.
Je n'ai jamais connu personne qui sŻt, autant que madame Rťcamier,
compatir ŗ tous les maux et tenir compte de ceux qui naissent, des
faiblesses humaines sans en ťprouver d'irritation. Elle ne sait pas
plus mauvais grť ŗ un homme vaniteux de se laisser aller ŗ un acte
inconsťquent, pas plus ŗ un homme peureux de faire une l‚chetť qu'ŗ un
goutteux d'avoir la goutte, ou ŗ un boiteux de ne pouvoir marcher
droit. Les infirmitťs morales lui inspirent autant et peut-Ítre plus
de pitiť que les infirmitťs physiques. Elle les soigne d'une main
lťgŤre et habile qui lui a conciliť la vive et tendre reconnaissance
de bien des malheureux. On la ressent d'autant plus vivement que son
‚me, aussi pure qu'ťlevťe, ne puise cette indulgence que par la source
abondante de compassion placťe par le ciel dans ce sein si noblement
fťminin.
Quelques semaines plus tard, Benjamin Constant conÁut l'idťe d'ťcrire
ŗ Louis XVIII une lettre explicative de sa conduite; la t‚che ťtait
malaisťe. Il arriva plein de cette pensťe chez madame Rťcamier et l'en
entretint longuement: Le lendemain, il y avait du monde chez elle;
elle lui demanda trŤs bas:
ęVotre lettre est-elle faite?
--Oui.
--En Ítes-vous content?
--TrŤs content, je me suis presque persuadť moi-mÍme.Ľ
Le Roi fut moins facile ŗ convaincre. Je crois, sans en Ítre sŻre, que
cette lettre a ťtť imprimťe. Il n'y a que le parti royaliste, assez
bÍte pour tenir longtemps rigueur ŗ un homme de talent. Au bout de peu
de mois, Benjamin Constant ťtait un des chefs de l'opposition.
CHAPITRE VIII
Exigences des ťtrangers en 1815. -- Dispositions de l'empereur
Alexandre au commencement de la campagne. -- Jolie rťponse du
gťnťral Pozzo ŗ Bernadotte. -- Conduite du duc de Wellington et
du gťnťral Pozzo. -- …tonnement de l'empereur Alexandre. --
Sťjour du Roi et des princes en Belgique. -- …nergie d'un soldat.
-- Obligeance du prince de Talleyrand. -- Le duc de Wellington
dťpouille le musťe. -- Le salon de la duchesse de Duras. -- Mort
d'Hombert de la Tour du Pin. -- Chambre dite introuvable. --
Dťmission de monsieur de Talleyrand. -- Mon pŤre est nommť
ambassadeur ŗ Londres. -- Le duc de Richelieu. -- Rťvťlation du
docteur Marshall. -- Visite au duc de Richelieu. -- Dťsobligeante
rťception. -- Son excuse.
Je reviens ŗ mon arrivťe ŗ Paris. Quelque disposťe que je fusse ŗ
partager la joie que causait le retour du Roi, elle ťtait empoisonnťe
par la prťsence des ťtrangers. Leur attitude y ťtait bien plus hostile
que l'annťe prťcťdente: vainqueurs de Napolťon en 1814, ils s'ťtaient
montrťs gťnťreux; alliťs de Louis XVIII en 1815, ils poussŤrent les
exigences jusqu'ŗ l'insulte.
La force et la prospťritť de la France avaient excitť leur surprise et
leur jalousie. Ils la croyaient ťpuisťe par nos longues guerres. Ils
la virent, avec ťtonnement, surgir de ses calamitťs si belle et encore
si puissante qu'au congrŤs de Vienne monsieur de Talleyrand avait pu
lui faire jouer un rŰle prťpondťrant. Les cabinets et les peuples s'en
ťtaient ťgalement ťmus et, l'occasion d'une nouvelle croisade contre
nous s'ťtant reprťsentťe, ils prťtendaient bien en profiter. Mais
leur haine fut aveugle, car, s'ils voulaient abaisser la France, ils
voulaient en mÍme temps consolider la Restauration. Or, les
humiliations de cette ťpoque infligŤrent au nouveau gouvernement une
flťtrissure dont il ne s'est point relevť et qui a ťtť un des motifs
de sa chute. La nation n'a jamais complŤtement pardonnť ŗ la famille
royale les souffrances imposťes par ceux qu'elle appelait ses
_alliťs_. Si on les avait qualifiťs d'ennemis la rancune aurait ťtť
moins vive et moins longue.
Ce sentiment, fort excusable, ťtait pourtant trŤs injuste. Assurťment
Louis XVIII ne trouvait aucune satisfaction ŗ voir des canons
prussiens braquťs sur le ch‚teau des Tuileries. L'aspect des manteaux
blancs autrichiens, fermant l'entrťe du Carrousel pendant qu'on
dťpouillait l'Arc de Triomphe de ses ornements, ne lui souriait point.
Il ne lui ťtait pas agrťable qu'on vint, jusque dans ses appartements,
enlever les tableaux qui dťcoraient son palais. Mais il ťtait forcť de
supporter ces avanies et de les dťvorer en silence. D'autre part,
c'est ŗ sa fermetť personnelle qu'on doit la conservation du pont
d'Iťna que BlŁcher voulait faire sauter, et celle de la colonne de la
place VendŰme que les Alliťs voulaient abattre et se partager. Il fut
assistť dans cette derniŤre occurrence par l'empereur Alexandre. Ce
souverain toujours gťnťreux, malgrť son peu de goŻt pour la famille
royale et la vellťitť qu'il avait conÁue au commencement de la
campagne de ne point l'assister ŗ remonter sur le trŰne, employa
cependant son influence dans la coalition ŗ adoucir les sacrifices
qu'on voulait nous imposer.
Je n'ai jamais bien su quel avait ťtť son projet lors de la bataille
de Waterloo. Peut-Ítre n'en avait-il pas d'arrÍtť et se trouvait-il
dans ce vague dont Pozzo avait montrť les inconvťnients d'une maniŤre
si piquante au prince royal de SuŤde en 1813. Quoique par lŗ je
revienne sur mes pas, je veux rappeler cette circonstance.
Pendant la campagne de Saxe, Pozzo et sir Charles Stewart avaient ťtť
envoyťs en qualitť de commissaires russe et anglais ŗ l'armťe
suťdoise. Les Alliťs craignaient toujours un retour de Bernadotte en
faveur de l'Empereur Napolťon. Il se dťcida enfin ŗ entrer en ligne et
prit part ŗ la bataille de Leipsig; la dťroute de l'armťe franÁaise
fut complŤte. AussitŰt l'esprit gascon de Bernadotte se mit ŗ battre
les buissons et ŗ rÍver le trŰne de France pour lui-mÍme. Il entama
une conversation avec Pozzo sur ce sujet: n'osant pas l'aborder de
front, il dťbuta par une longue thťorie dont le rťsultat arrivait ŗ
prouver que le trŰne devait appartenir au plus digne et la France
choisir son roi.
ęJe vous remercie, monseigneur, s'ťcria Pozzo.
--Pourquoi, gťnťral?
--Parce que ce sera moi!
--Vous?
--Sans doute; je me crois le plus digne. Et comment me prouvera-t-on
le contraire? En me tuant? D'autres se prťsenteront.... Laissez-nous
tranquilles avec votre _plus digne_! Le plus digne d'un trŰne est,
pour la paix du monde, celui qui y a le plus de droits.Ľ
Bernadotte n'osa pas pousser plus loin la conversation mais ne l'a
jamais pardonnťe ŗ Pozzo.
Sous une autre forme, celui-ci donna la mÍme leÁon ŗ son impťrial
maÓtre en 1815. En apprenant la victoire de Waterloo, l'empereur
Alexandre enjoignit au gťnťral Pozzo, qui se trouvait auprŤs du duc de
Wellington, de s'opposer ŗ la marche de l'armťe et de chercher ŗ
gagner du temps afin que les anglais n'entrassent pas en France avant
que les armťes austro-russe et prussienne se trouvassent en ligne.
Selon lui, Louis XVIII devait attendre en Belgique la dťcision de son
sort.
ņ la rťception de cette dťpÍche, Pozzo ťprouva le plus cruel embarras.
Il savait la malveillance de l'Empereur pour la maison de Bourbon.
Elle se trouvait encore accrue par la dťcouverte d'un projet
d'alliance, entre la France, l'Angleterre et l'Autriche, conclu
pendant le congrŤs de Vienne par monsieur de Talleyrand dans des vues
hostiles ŗ la Russie.
La copie de ce traitť, oubliťe dans le cabinet du Roi, avait ťtť
envoyťe par monsieur de Caulaincourt ŗ l'empereur Alexandre pendant
les Cent-Jours. Il n'y avait pas attachť grande importance, croyant
que c'ťtait une invention de Napolťon pour le dťtacher de l'alliance;
mais une seconde copie du traitť ayant ťtť trouvťe dans les papiers
enlevťs ŗ monsieur de Reinhard, il ne put conserver de doutes, et
cette nouvelle cause de mťcontentement s'ťtant jointe ŗ tout ce qu'il
reprochait dŤs l'annťe prťcťdente au Roi, il ťtait peu enclin ŗ
souhaiter son rťtablissement. Aussi n'avait-il pas tťmoignť de
rťpugnance ŗ ťcouter les nťgociateurs envoyťs de Paris, et il ťtait
difficile de prťvoir ce qui pourrait en rťsulter.
Pozzo n'ťtait _brin Russe_ et avait grand envie de s'arranger en
France une patrie ŗ son goŻt, en y conservant un souverain qui lui
avait des obligations personnelles. Il hťsita quelque peu, puis alla
trouver le duc de Wellington:
ęJe viens vous confier le soin de ma tÍte, lui dit-il; voilŗ la
dťpÍche que j'ai reÁue, voici la rťponse que vous y avez faite.Ľ
Il lui lut ce qu'il mandait ŗ l'Empereur des dispositions du duc de
Wellington qui persistait ŗ avancer immťdiatement sur Paris et ŗ
conduire Louis XVIII avec lui.
ęVoulez-vous, ajouta-t-il, avoir fait cette rťponse et tenir cette
conduite, malgrť les objections que je suis censť vous adresser?Ľ
Le duc lui tendit la main.
ęComptez sur moi; la confťrence a eu lieu prťcisťment comme vous la
rapportez.
--Alors, reprit Pozzo, il n'y a pas un moment ŗ perdre, il faut agir
en consťquence.Ľ
Personne ne fut mis dans la confidence. Les petites intrigues
s'agitŤrent autour du Roi. Monsieur de Talleyrand bouda. Il avait un
autre plan qui avait des cŰtťs spťcieux, mais dont le but principal
ťtait de se tenir personnellement ťloignť de l'empereur Alexandre. Il
ne savait pas la prise des papiers de monsieur Reinhard, mais il
craignait toujours quelque indiscrťtion. Pozzo ne se fiait pas assez ŗ
lui pour lui raconter la vťritable situation des affaires. Le duc le
dťcida ŗ rejoindre le Roi qui, de son cŰtť, consentit ŗ se sťparer de
monsieur de Blacas.
On arriva ŗ Paris ŗ tire d'aile et le Roi fut bombardť ŗ l'improviste
dans le palais des Tuileries, selon l'expression pittoresque de Pozzo
quand il fait ce rťcit.
ņ peine ce but atteint, il se jette dans une calŤche et court
au-devant de l'Empereur. Ses logements ťtaient faits ŗ Bondy; Pozzo
brŻle l'ťtape et continue sa route. Il trouve l'Empereur ŗ quelques
lieues au delŗ: il est venu lui apprendre que Paris est soumis et le
palais de l'…lysťe prÍt ŗ le recevoir. L'Empereur le fait monter dans
sa voiture. Pozzo lui fait un tableau animť de la bataille de
Waterloo, donne une grande importance ŗ la manoeuvre de BlŁcher,
raconte l'entrťe en France, la facilitť de la marche, la cordialitť de
la rťception, l'impossibilitť de s'arrÍter quand il n'y a pas
d'obstacles, et enfin le parti pris par le duc d'occuper Paris.
L'Empereur ťcoutait avec intťrÍt.
ęMaintenant, dit-il, il s'agit de prendre un parti sur la situation
politique. Oý avez-vous laissť le Roi?
--Aux Tuileries, Sire, oý il a ťtť accueilli avec des transports
universels.
--Comment Louis XVIII est ŗ Paris! Apparemment que Dieu en a ainsi
ordonnť. Ce qui est fait est fait, il n'y a plus ŗ s'en prťoccuper;
peut-Ítre est-ce pour le mieux.Ľ
On comprend combien cette rťsignation mystique soulagea l'ambassadeur.
Malgrť la confiance absolue qu'il avait dans la loyautť du duc de
Wellington, il ne laissait pas que d'Ítre fort tourmentť de la faÁon
dont l'Empereur prendrait les ťvťnements; car, tout libťral qu'ťtait
l'autocrate, il n'oubliait pas toujours ses possessions de Sibťrie
lorsqu'il se croyait mal servi.
L'Empereur continua sa route et vint coucher ŗ l'…lysťe. Il ne
conserva de mťcontentement que contre monsieur de Talleyrand et
monsieur de Metternich. L'autrichien est parvenu ŗ en triompher; le
franÁais y succomba peu aprŤs.
Mon oncle …douard Dillon avait accompagnť le Roi en Belgique. Il me
raconta toutes les misŤres du dťpart, du voyage et du sťjour ŗ
l'ťtranger. Monsieur et son fils, le duc de Berry, avaient laissť dans
les boues d'Artois le peu de considťration militaire que la pieuse
discrťtion des ťmigrťs aurait voulu leur conserver. La maison du Roi
avait ťtť congťdiťe ŗ Bťthune avec une incurie et une duretť inouÔes;
plusieurs de ses membres cependant avaient trouvť le moyen de franchir
la frontiŤre. Ils ťtaient venus ŗ leurs frais et volontairement ŗ Gand
former une garde au Roi qui recevait leurs services avec aussi peu
d'attention qu'aux Tuileries.
Monsieur de Bartillat, officier des gardes du corps, m'a dit qu'il
avait ťtť ŗ Gand, qu'il y avait commandť un assez grand nombre des
gardes de sa compagnie, rťunis de pur zŤle, sans que jamais ni lui ni
eux eussent obtenu une parole du Roi, ni pu deviner qu'ils ťtaient
remarquťs. Je crois que les princes craignaient de se compromettre,
vis-ŗ-vis de leurs partisans et de prendre des engagements, dans le
cas oý la nouvelle ťmigration se prolongerait.
Parlerai-je de ce camp d'Alost, commandť par monsieur le duc de Berry,
et si dťplorablement levť au moment oý la bataille de Waterloo ťtait
engagťe? Le duc de Wellington s'en expliqua cruellement et
publiquement vis-ŗ-vis du prince auquel il reprochait la rupture d'un
pont.
Monsieur le duc de Berry s'excusa sur des rapports erronťs qui lui
faisaient croire la bataille perdue.
ęRaison de plus, monseigneur; quand on se sauve il ne faut pas rendre
impossible la marche de braves gens qui peuvent Ítre obligťs de faire
une retraite honorable!Ľ
J'aime mieux raconter la farouche ťnergie d'un soldat. …douard Dillon
avait ťtť chargť par le Roi, aprŤs la bataille de Waterloo, de porter
des secours aux blessťs franÁais recueillis dans les hŰpitaux de
Bruxelles. Il arriva prŤs d'un lit oý on venait de faire l'amputation
du bras ŗ un sous-officier de la garde impťriale. Pour rťponse ŗ ses
offres, il lui jeta le membre sanglant qu'on venait de couper.
ęVa dire ŗ celui qui t'envoie que j'en ai encore un au service de
l'Empereur.Ľ
L'un de mes premiers soins, en arrivant ŗ Paris, avait ťtť d'aller
chez monsieur de Talleyrand. J'ťtais chargťe par mon pŤre de lui
expliquer trŤs en dťtail la situation pťnible oý se trouvaient les
franÁais en Piťmont. Je m'en acquittai assez mal; je n'ai jamais ťtť ŗ
mon aise avec monsieur de Talleyrand. Il m'accueillit pourtant trŤs
gracieusement et, lorsque je lui annonÁai que, vers la fin du mois, je
prendrais ses ordres pour Turin, il m'engagea ŗ ne pas presser mes
paquets. Je compris qu'il s'agissait d'une nouvelle destination pour
mon pŤre, mais je n'osai pas m'en informer.
J'ai toujours eu une extrÍme timiditť vis-ŗ-vis des gens en place, et
je ne puis les supporter que lorsque j'ai la certitude morale de
n'avoir jamais rien ŗ leur demander. Tant que mon pŤre ťtait employť,
je me trouvais dans une sorte de dťpendance qui m'ťtait pťnible
vis-ŗ-vis d'eux, malgrť la bienveillance qu'ils me tťmoignaient.
Notre hťros, le duc de Wellington, se fit l'exťcuteur des spoliations
matťrielles imposťes par les Alliťs. Sous prťtexte que les anglais
n'avaient rien ŗ rťclamer en ce genre, il trouva gťnťreux d'aller de
ses mains triomphantes dťcrocher les tableaux de nos musťes. Ceci ne
doit pas Ítre pris comme une forme de rhťtorique, c'est le rťcit d'un
fait. On l'a vu sur une ťchelle, donnant lui-mÍme l'exemple. Le jour
oý l'on descendit les chevaux de Venise de dessus l'arc du Carrousel,
il passa la matinťe perchť sur le monument, vis-ŗ-vis les fenÍtres du
Roi, ŗ surveiller ce travail. Le soir il assista ŗ une petite fÍte
donnťe par madame de Duras au roi de Prusse. Nous ne pouvions cacher
notre indignation; il s'en moquait et en faisait des plaisanteries. Il
avait tort pourtant; notre ressentiment ťtait lťgitime et plus
politique que sa conduite. Les ťtrangers ťtaient prťsentťs comme
alliťs; ils avaient ťtť accueillis comme tels; leurs procťdťs
retombaient sur la famille rťgnante.
La conduite du duc donnait le signal aux impertinences des
sous-ordres. Le sang bout encore dans mes veines au propos que
j'entendis tenir ŗ un certain vulgaire animal du nom de Mackenzie,
intendant ou, comme cela s'appelle en anglais, _payeur_ de l'armťe. On
parlait sťrieusement et tristement de la difficultť qu'ťprouverait la
France ŗ acquitter les ťnormes charges imposťes par les ťtrangers.
ęAh bah, reprit-il avec un gros rire, on crie un peu puis cela
s'arrange. Je viens de Strasbourg; j'y ai passť le jour mÍme oý le
gťnťral prussien avait frappť une contribution qu'on disait ťnorme, on
avait payť. Eh bien! tout le monde dÓnait.Ľ
Je l'aurais tuť d'un regard.
Le duc de Duras, premier gentilhomme de la chambre, se trouvait
d'annťe (de toutes les places de la Cour, c'ťtait la seule dont le
service ne se fit pas par trimestre); madame de Duras logeait aux
Tuileries. Liťe avec elle d'ancienne date et n'ayant pas
d'ťtablissement en ce moment, je passais ma vie chez elle. Sa
situation la forÁait ŗ recevoir de temps en temps beaucoup de monde,
mais journellement son salon n'ťtait ouvert qu'ŗ quelques habituťs. On
y causait librement et plus raisonnablement qu'ailleurs. Probablement
les discours que nous tenions nous ťtonneraient maintenant. S'ils nous
ťtaient rťpťtťs, nous les trouverions extravagants, mais c'ťtaient les
plus sages du parti royaliste.
Madame de Duras avait beaucoup plus de libťralisme que sa position ne
semblait en comporter. Elle admettait toutes les opinions et ne les
jugeait pas du haut de l'esprit de parti. Elle ťtait mÍme accessible ŗ
celles des idťes gťnťreuses qui ne compromettaient pas trop sa
position de grande dame dont elle jouissait d'autant plus vivement
qu'elle l'avait attendue plus longtemps.
Elle ne se consolait pas de l'exclusion donnťe ŗ monsieur de
Chateaubriand au retour de Gand. Son crťdit l'y avait fait ministre de
l'intťrieur du Roi fugitif, et elle ne comprenait pas comment le Roi
rťtabli ne confirmait pas cette nomination. Il en rťsultait un vernis
d'opposition dans son langage dont je m'accommodais trŤs bien. Sa
fille, la princesse de Talmont, ne partageait pas sa modťration; son
exaltation ťtait extrÍme, mais elle ťtait si jeune et si jolie que ses
folies mÍme avaient de la gr‚ce. Elle avait ťpousť ŗ quinze ans en
1813, le seul hťritier de la maison de La TrťmoÔlle. Aussi Adrien de
Montmorency disait-il que c'ťtaient des noces historiques et que sa
grossesse serait un ťvťnement national. Les fastes du pays n'ont pas
eu ŗ le recorder; monsieur de Talmont est mort en 1815 sans laisser
d'enfant. Le duc de Duras s'ťcriait le jour de l'enterrement:
ęIl est bien affreux de se trouver veuve ŗ dix-sept ans quand on est
condamnťe ŗ ne pouvoir plus ťpouser qu'un prince souverain.Ľ La
princesse de Talmont a dťrogť ŗ cette nťcessitť, mais c'est contre la
volontť de son pŤre et mÍme de sa mŤre.
La mort du prince de Talmont n'avait ťtť un chagrin pour personne,
mais notre coterie fut profondťment affectťe par la catastrophe
arrivťe dans la famille La Tour du Pin.
Hombert de La Tour du Pin-Gouvernet avait atteint l'‚ge de vingt-deux
ans. Il ťtait fort bon enfant et assez distinguť, quoique une
charmante figure et un peu de g‚terie de ses parents lui donnassent
l'extťrieur de quelque fatuitť. Dans ce temps de dťsordre oý on
_s'enrŰlait dans les colonels_, suivant l'expression chagrine des
vieux militaires, Hombert avait ťtť nommť, officier d'emblťe et le
marťchal duc de Bellune l'avait pris pour aide de camp. On ne peut
nier que ces existences de faveur ne donnassent beaucoup d'humeur aux
camarades dont les grades avaient ťtť acquis ŗ la pointe de l'ťpťe.
Hombert eut une discussion sur l'ordre de service avec un de ceux-ci;
le jeune homme y mit un ton lťger, l'autre fut un peu grognon; cela
n'alla pas trŤs loin. Toutefois, par rťflexion, Hombert conÁut quelque
scrupule. Le lendemain matin, il entra chez son pŤre et lui raconta
exactement ce qui s'ťtait passť; seulement il eut soin, dans le rťcit,
de faire jouer son propre rŰle par Donatien de Sesmaisons, un autre de
ses camarades. Il ajouta qu'il ťtait chargť par lui de consulter son
pŤre sur la convenance de donner suite ŗ cette affaire. Monsieur de La
Tour du Pin l'ťcouta attentivement et lui rťpondit:
ęMa foi, ce sont de ces choses qu'on ne se soucie guŤre de conseiller.
--Vous pensez donc, mon pŤre, qu'ils doivent se battre?
--Cela n'est pas indispensable et, si Donatien avait servi, cela se
terminerait tout aussi bien par une poignťe de main; mais il est tout
nouvellement dans l'armťe, le capitaine a beaucoup fait la guerre;
vous savez la jalousie qui existe contre vous autres. ņ la place de
Donatien, je me battrais.Ľ
Hombert quitta la chambre de son pŤre pour aller ťcrire un cartel. La
rťponse ne se fit pas attendre. L'engagement ťtait pris de se trouver
ŗ midi au bois de Boulogne.
Avant que la famille se rťunit au dťjeuner, Hombert annonÁa ŗ son pŤre
qu'il ťtait tťmoin de Donatien. Son trouble ťtait visible. Il combla
sa mŤre de caresses. Il insista pour qu'elle lui arrange‚t elle-mÍme
sa tasse de thť. Elle s'y prÍta, en riant de cette exigence. Sa soeur
Cťcile ťtait dans l'habitude de le plaisanter sur l'importance qu'il
attachait ŗ une certaine boucle de cheveux retombant sur son front;
elle entama cette taquinerie de famille:
ęHť bien, Cťcile, pour te prouver que ce n'est pas ce ŗ quoi je tiens
le plus au monde, comme tu prťtends, j'y renonce, je te la donne,
prends-la.Ľ
Cťcile fit semblant de s'approcher avec des ciseaux. Hombert ne
sourcilla pas. Elle se contenta de lui baiser le front.
ęVa, mon bon Hombert, cela me ferait autant de peine qu'ŗ toi.Ľ
Hombert se leva, la serra contre son coeur et s'ťloigna pour cacher
son trouble. Madame de La Tour du Pin lui reprocha sa sensiblerie qui
les jetait tous dans la mťlancolie. Monsieur de La Tour du Pin,
croyant Ítre dans le secret d'Hombert, l'aidait ŗ cacher son
agitation. Hombert sorti, Cťcile trouva sur son panier ŗ ouvrage la
boucle de cheveux, elle s'ťcria:
ęAh! maman, dťcidťment Hombert renonce ŗ la fatuitť, voyez quel beau
sacrifice! Au fond, j'en suis bien f‚chťe.Ľ
La mŤre et la fille ťchangŤrent leurs regrets, mais sans concevoir
d'alarmes. Monsieur de La Tour du Pin, inquiet pour Donatien, alla se
promener dans les Champs-…lysťes. BientŰt il aperÁut ce mÍme Donatien
dont les regards sinistres lui rťvťlŤrent un malheur. Hťlas! c'ťtait
lui qui ťtait le tťmoin. Hombert avait reÁu une balle au milieu du
front, ŗ l'endroit mÍme rťcemment ombragť par cette mŤche de cheveux
devenue une si prťcieuse relique. Il ťtait mort. Monsieur de La Tour
du Pin avait condamnť son fils le matin.
Le premier aide de camp du marťchal, homme de poids, avait voulu
arranger cette affaire sur le terrain; Hombert avait ťtť rťcalcitrant.
Cependant les motifs de la querelle ťtaient si lťgers que
l'accommodement allait se faire, presque malgrť lui, lorsqu'il se
servit malheureusement d'une expression de coterie en disant que
l'humeur de son adversaire lui avait paru _insensťe_, tant il avait
peu l'intention d'offenser. Entendant, par le mot _insensťe_, peu
rationnelle, l'antagoniste s'ťcria:
ęQuoi? vous m'appelez un insensť!Ľ
Hombert haussa les ťpaules. Deux minutes aprŤs, il avait cessť de
vivre. Monsieur de La Tour du Pin ne s'est jamais relevť d'un coup si
affreux. On peut mÍme dire que sa raison en a ťtť altťrťe.
Je ne chercherai pas ŗ peindre le dťsespoir de cette famille dťsolťe;
nous partage‚mes son chagrin, et le salon de madame de Duras, oý elle
ťtait dans la grande intimitť, en fut longuement assombri.
Les ťlections de 1815 se firent dans un sens purement royaliste; la
noblesse y siťgeait en immense majoritť. C'est la meilleure chance
qu'elle ait eue, depuis quarante ans, de reprendre quelque supťrioritť
en France. Si elle s'ťtait montrťe calme, raisonnable, gťnťreuse,
ťclairťe, occupťe des affaires du pays, protectrice de ses libertťs,
en un mot, si elle avait jouť le rŰle qui appartenait ŗ l'aristocratie
d'un gouvernement reprťsentatif, dans ce moment oý elle ťtait
toute-puissante, on lui en aurait tenu compte et le trŰne aurait
trouvť un appui rťel dans l'influence qu'elle pouvait exercer. Mais
cette Chambre, que dans les premiers temps le Roi qualifia
d'_introuvable_, se montra folle, exagťrťe, ignorante, passionnťe,
rťactionnaire, dominťe par des intťrÍts de caste. On la vit hurlant
des vengeances et applaudissant les scŤnes sanglantes du Midi. La
gentilhommerie rťussit ŗ se faire dťtester ŗ cette occasion, comme dix
ans plus tard elle a achevť sa dťconsidťration dans la honteuse
discussion sur l'indemnitť des ťmigrťs.
Les dťputťs, en arrivant, n'ťtaient pas encore montťs au point
d'exagťration oý ils parvinrent depuis. Toutefois, Fouchť tomba devant
leurs inimitiťs, mÍme avant l'ouverture de la session. Ils montrŤrent
aussi de grandes rťpugnances pour monsieur de Talleyrand. Peut-Ítre
aurait-il osť les affronter s'il avait ťtť soutenu par la Cour. Mais
Monsieur se laissait dire tout haut par le duc de Fitzjames: ęHť bien,
monseigneur, le vilain boiteux va donc la danser?Ľ et approuvait du
sourire ce langage contre un homme qui, deux fois en douze mois, avait
remis la maison de Bourbon sur le trŰne.
De son cŰtť, le roi Louis XVIII trouvait de si grands services bien
pesants et ressentait le sacrifice qu'il avait dŻ faire en ťloignant
le comte de Blacas. Par-dessus tout, l'empereur Alexandre, de
protecteur zťlť qu'il ťtait de monsieur de Talleyrand en 1814, ťtait
devenu son ennemi capital. Il cťda devant tant d'obstacles rťunis; il
offrit une dťmission qui fut acceptťe avec plus d'empressement
peut-Ítre qu'il n'avait comptť.
Le soir, j'allai chez lui; il s'approcha de moi, et me dit que le
dernier acte de son ministŤre avait ťtť de nommer mon pŤre ŗ
l'ambassade de Londres.
En effet, la nomination, quoique signťe Richelieu, avait ťtť faite par
monsieur de Talleyrand. Il la demandait au Roi dŤs 1814, mais le comte
de La Ch‚tre avait ťtť premier gentilhomme de Monsieur, comte de
Provence; il avait promesse de conserver cette place chez le Roi et,
comme il l'ennuyait ŗ mourir, Sa Majestť TrŤs Chrťtienne aimait mieux
avoir un mauvais ambassadeur ŗ Londres qu'un serviteur incommode aux
Tuileries. Il finit pourtant par cťder. Malgrť les immenses avantages
faits ŗ monsieur de La Ch‚tre nommť pair, duc, premier gentilhomme de
la chambre, avec une forte pension sur la Chambre des pairs et une
autre sur la liste civile, il conÁut beaucoup d'humeur de ce rappel.
Mon pŤre reÁut, avec sa nomination, une lettre du duc de Richelieu qui
le mandait ŗ Paris. Il ne voulait cependant pas quitter Turin avant
que le sort de nos compatriotes ne fŻt dťfinitivement fixť. Cette
affaire l'y retint quelques semaines. Ce fut dans cet intervalle que
je me trouvai dans des rapports fort dťsagrťables avec monsieur de
Richelieu.
DŤs la premiŤre soirťe que j'avais passťe chez madame de Duras, j'y
vis entrer un grand homme d'une belle figure; ses cheveux gris
contrastaient avec un visage encore assez jeune. Il avait la vue trŤs
basse et clignait les yeux avec une grimace qui rendait sa physionomie
peu obligeante. Il ťtait en bottes et mal tenu avec une sorte
d'affectation, mais, sous ce costume, conservait l'air trŤs grand
seigneur. Il se jeta sur un sopha, parla haut, d'une voix aigre et
glapissante. Un lťger accent, des locutions et des formes un peu
ťtrangŤres me persuadŤrent qu'il n'ťtait pas franÁais. Cependant son
langage et surtout les sentiments qu'il exprimait repoussaient cette
idťe. Je le voyais familier avec tous mes amis. Je me perdais en
conjectures sur cet inconnu si intime: c'ťtait le duc de Richelieu,
rentrť en France depuis mon dťpart.
L'impression qu'il m'a faite ŗ cette premiŤre rencontre n'a jamais
variť. Ses formes m'ont toujours paru les plus dťsagrťables, les plus
dťsobligeantes possibles. Son beau et noble caractŤre, sa capacitť
rťelle pour les affaires, son patriotisme ťclairť lui ont acquis mon
suffrage, je dirais presque mon dťvouement, mais c'ťtait un succŤs
d'estime plus que de goŻt.
Le docteur Marshall, dont j'ai dťjŗ fait mention, arriva un matin chez
moi. Il m'apportait une lettre. Elle ťtait destinťe ŗ Fouchť, alors en
Belgique, et contenait, disait-il, non seulement des dťtails sur une
trame qui s'ourdissait contre le gouvernement du Roi, mais encore le
chiffre devant servir aux correspondances. Il ne voulait confier une
piŤce si importante qu'ŗ mon pŤre et, en son absence, ŗ moi. Ses pas
ťtaient suivis et, s'il s'approchait des Tuileries ou d'un ministŤre,
il aurait tout ŗ craindre.
Malgrť le peu de succŤs de ses rťvťlations (qui, pourtant, je crois,
lui avaient ťtť bien payťes) il voulait encore rendre ce service au
Roi, d'autant qu'il connaissait l'attachement que le prince rťgent lui
portait. Je le pressai en vain de s'adresser au duc de Duras; comme la
premiŤre fois, il s'y refusa formellement. ęLa lettre, me dit-il,
ťtait cachetťe de faÁon ŗ rťclamer l'adresse des plus habiles pour
l'ouvrir. J'en ferais ce que je voudrais, rien s'il me plaisait mieux;
il viendrait la reprendre le lendemain matin.Ľ Il sortit, la laissant
sur ma table.
Je me trouvai fort embarrassťe avec cette piŤce toute brŻlante entre
les mains. Je la vois encore d'ici. Elle ťtait assez grosse, sans
enveloppe quoiqu'elle contÓnt ťvidemment plus d'une feuille. Cachetťe
d'un pain blanc sortant ŗ moitiť en dehors du papier sur lequel
ťtaient tracťs ŗ la plume trois J de cette faÁon:
[Illustration.]
Je savais l'importance attachťe par mon pŤre aux documents procurťs
naguŤre par Marshall. Il n'y avait pas de conseil ŗ demander dans une
occasion qui, avant tout, prescrivait le secret. AprŤs mŻre rťflexion,
je pris mon parti. J'allai aux Tuileries; je fis prier le duc de Duras
de venir me parler; il descendit et monta dans ma voiture. Je lui
racontai ce qui ťtait arrivť et lui donnai la lettre pour le Roi.
Le Roi ťtait ŗ la promenade et ne rentrerait pas de plusieurs heures.
Il trouva plus simple que nous allassions la porter au duc de
Richelieu. J'y consentis. Le duc de Richelieu nous reÁut plus que
froidement et me dit qu'il n'avait personne dans ses bureaux qui eŻt
l'habitude ni le talent d'ouvrir les lettres. Je me sentis courroucťe.
Je lui rťpondis qu'apparemment ce talent-lŗ ne se trouvait pas plus
facilement dans ma chambre, que ma responsabilitť ťtait ŗ couvert, que
je n'avais pas cru pouvoir me dispenser de remettre ce document en
mains compťtentes. Ce but ťtait rempli et, lorsque l'homme qui n'avait
pas voulu Ítre nommť viendrait le lendemain, je lui dirais qu'elle
ťtait restťe chez un ministre du Roi. Monsieur de Richelieu voulut me
la rendre; je me refusai ŗ la reprendre et nous nous sťpar‚mes
ťgalement mťcontents l'un de l'autre.
Deux heures aprŤs, monsieur d'Herbouville (directeur des postes ŗ
cette ťpoque) me rapporta cette lettre avec des hymnes de
reconnaissance; elle avait ťtť ouverte et son importance reconnue.
Monsieur Decazes, ministre de la police, vint deux fois dans la soirťe
sans me trouver.
Le lendemain matin, ma femme de chambre, en entrant chez moi, me dit
que monsieur d'Herbouville attendait mon rťveil; c'ťtait pour me dire
combien les renseignements de la veille avaient fait naÓtre le dťsir
de se mettre en rapport direct avec l'homme qui les avait procurťs.
Monsieur Decazes me priait d'y employer tous les moyens.
Marshall arriva ŗ l'heure annoncťe; je m'acquittai du message dont
j'ťtais chargťe. Il fit de nombreuses difficultťs et finit cependant
par indiquer un lieu oý on pourrait le rencontrer _par hasard_. Je
crois que, par toutes ces prťcautions, il voulait augmenter le prix
soldť de ses rťvťlations. Je ne l'ai jamais revu, mais je sais qu'il
a ťtť longtemps aux gages de la police.
Il avait une superbe figure, une ťlocution facile et tout ŗ fait l'air
d'un _gentleman_. C'ťtait, du reste, une vťritable espŤce. Je me
rappelle un trait de caractŤre qui me frappa. Il m'avait annoncť que
le cachet de la lettre serait fort examinť par la personne ŗ laquelle
il devait la remettre. Lorsque je la lui rendis, il me fit remarquer
que la queue des J tracťs sur le pain ŗ cacheter en dehors du papier
avait ťtť maculťe par l'opťration de l'ouverture.
ęIl me faudra, ajouta-t-il, avoir recourt aux grands moyens.Ľ
Je lui demandai quels ils ťtaient.
ęJe remettrai la lettre au grand jour, prŤs d'une fenÍtre, et je ne
quitterai pas la personne des yeux, tout en lui parlant d'autre chose,
que la lettre ne soit pas dťcachetťe. Elle n'osera pas l'examiner
pendant que je la tiendrai de cette sorte en arrÍt. Cela m'a toujours
rťussi.Ľ
Ce honteux aveu d'une telle expťrience me fit chair de poule et me
rťconcilia presque avec la maussade brusquerie dont monsieur de
Richelieu m'avait accueillie la veille. Elle trouvait aussi son excuse
dans les abominables intrigues qui l'entouraient. Les noms ne
pouvaient avertir sa confiance, car, malheureusement, les dťlations
d'amateurs ne manquaient pas dans la classe supťrieure; et, par excŤs
de zŤle, on se faisait espion, parfois au service de ses passions,
parfois ŗ celui de ses intťrÍts.
Monsieur de Richelieu ťprouvait pour ces viles actions ces haines
vigoureuses de l'homme de bien. …tranger ŗ la sociťtť, il ne pouvait
apprťcier les caractŤres. Il m'avait fait l'injustice de me ranger
dans la catťgorie des femmes ŗ trigauderies. J'en fus excessivement
froissťe et me tins ŗ distance de lui. De son cŰtť, il fut ťclairť et
f‚chť, je crois, de son injustice, mais il ťtait trop timide et
n'avait pas assez d'usage du monde pour s'en expliquer franchement.
Nos relations se sont toujours senties de ce mauvais dťbut. J'ťtais de
son parti ŗ bride abattue, mais peu de ses amies et point de sa
coterie. Nous nous rencontrions tous les jours sans jamais nous
adresser la parole.
Les formes acerbes du duc de Richelieu lui ont souvent valu des
ennemis politiques parmi les personnes, qu'on me passe cette fatuitť,
moins raisonnables que moi.
CHAPITRE IX
Nobles adieux de l'empereur Alexandre au duc de Richelieu. --
Sentiments patriotiques du duc. -- Ridicules de monsieur de
Vaublanc. -- Arrivťe de mon pŤre ŗ Paris. -- ProcŤs du marťchal
Ney. -- Son exťcution. -- Exaltation du parti royaliste. --
ProcŤs de monsieur de La Valette. -- Madame la duchesse
d'AngoulÍme s'engage ŗ demander sa gr‚ce. -- On l'en dťtourne. --
Dťmarches faites par le duc de Raguse. -- Il fait entrer madame
de La Valette dans le palais. -- Sa disgr‚ce. -- Fureur du parti
royaliste ŗ l'ťvasion de monsieur de La Valette.
Monsieur de Talleyrand s'est quelquefois vantť de s'Ítre retirť pour
ne pas signer le cruel traitť imposť ŗ la France. Le fait est qu'il a
succombť sous les malveillances accumulťes que j'ai dťjŗ signalťes.
Monsieur de Richelieu ťtait portť aux affaires par l'empereur
Alexandre, et, quelque dures qu'aient ťtť les conditions qu'on nous a
fait subir, elles l'auraient ťtť beaucoup plus avec tout autre
ministre. AussitŰt la nomination de monsieur de Richelieu, l'autocrate
s'ťtait dťclarť hautement le champion de la France. Aussi, lorsque ŗ
son dťpart il distribua des prťsents aux divers diplomates, il envoya
ŗ monsieur de Richelieu une vieille carte de France, servant ŗ la
confťrence et sur laquelle ťtaient tracťes les nombreuses prťtentions
territoriales ťlevťes par les Alliťs et que leurs reprťsentants
comptaient bien exiger. Il y joignit un billet de sa main portant que
la confiance inspirťe par monsieur de Richelieu avait seule ťvitť ces
ťnormes sacrifices ŗ sa patrie. Ce cadeau, ajoutait l'Empereur, lui
paraissait le seul digne de son noble caractŤre et celui que, sans
doute, il apprťcierait le plus haut. Un tel don honore ťgalement le
souverain qui en conÁoit la pensťe et le ministre qui mťrite de
l'inspirer.
Malgrť ce succŤs que monsieur de Richelieu n'ťtait pas homme ŗ
proclamer et qui n'a ťtť su que longtemps aprŤs, son coeur vraiment
franÁais saignait de ce terrible traitť. Le son de voix avec lequel il
en fit lecture ŗ la Chambre, le geste avec lequel il jeta le papier
sur la tribune aprŤs ce pťnible devoir accompli sont devenus
historiques et ont commencť ŗ rťconcilier tout ce qui avait de l'‚me
dans le pays ŗ un choix qui d'abord apparaissait comme un peu trop
russe.
Rien au monde n'ťtait plus injuste; monsieur de Richelieu ťtait
franÁais, exclusivement franÁais, nullement ťmigrť et point du tout
plus aristocrate que les circonstances ne le permettaient. Il ťtait,
dans le meilleur sens des deux termes, libťral et patriote. Pendant ce
premier ministŤre, il ťprouvait l'inconvťnient de ne point connaÓtre
les personnes et, pour un ministre prťpondťrant, cela est tout aussi
nťcessaire que de savoir les affaires. Cette ignorance lui fit
accepter sans opposition, un collŤgue donnť par Monsieur. C'ťtait
monsieur de Vaublanc. Il ne tarda pas ŗ dťployer une sottise si
dťlicieusement ridicule qu'il aurait fallu en p‚mer de rire s'il
n'avait pas trouvť de l'appui chez les princes et dans la Chambre.
Toutes les absurditťs ťtaient contagieuses dans ces parages.
Monsieur de Vaublanc chercha promptement ŗ fomenter une intrigue
contre monsieur de Richelieu; elle fut dťjouťe par le crťdit des
ťtrangers.
Ce fut vers ce temps que Monsieur donna ŗ monsieur de Vaublanc un
grand cheval blanc. Il posait dessus, dans le jardin du ministŤre de
l'intťrieur, pour la statue de Henri IV, personne, selon lui, ne se
tenant ŗ cheval dans une ťgale perfection. Si ses prťtentions
s'ťtaient bornťes lŗ, on s'en serait facilement accommodť; mais il les
rťunissaient toutes, portťes ŗ une exagťration sans exemple et
manifestťes avec une inconvenance incroyable dans sa naÔvetť.
Quoiqu'elle soit peu digne, mÍme de la macťdoine que j'ťcris, je ne
puis me refuser ŗ rapporter une saillie qui a toujours eu le don de me
faire sourire. Le boeuf gras se trouva petit et maigre cette annťe; on
le remarquait devant madame de Puisieux: ęJe le crois bien,
s'ťcria-t-elle, la pauvre bÍte aura trop souffert des sottises de son
neveu le Vaublanc.Ľ
C'est cette mÍme madame de Puisieux qui, voyant monsieur de Bonnay,
d'une p‚leur excessive, se verser un verre d'orgeat, l'arrÍta en lui
disant: ęAh, malheureux; il allait boire son sang!Ľ
Si nous avions vťcu dans un temps moins fťcond en grands ťvťnements,
les mots de madame de Puisieux auraient autant de cťlťbritť que ceux
de la fameuse madame de Cornuel.
Mon pŤre avait terminť; tant bien que mal, l'affaire relative aux
franÁais domiciliťs en Piťmont, et remis, pour satisfaire au traitť de
Paris, le reste de la Savoie au roi de Sardaigne.
Le roi Louis XVIII en ťtait aussi joyeux aux Tuileries qu'on pouvait
l'Ítre ŗ Turin. Son ambassadeur ne partageait pas cette satisfaction
et ce dernier acte de ses fonctions lui fut si dťsagrťable qu'il
refusa, mÍme avec un peu d'humeur, le grand cordon qui lui fut offert
ŗ l'occasion de cette restitution. ņ la vťritť, mon pŤre espťrait
alors l'ordre du Saint-Esprit et, si les prťjugťs de sa jeunesse le
lui faisaient dťsirer avec trop de vivacitť, ils lui inspiraient, en
revanche, un grand dťdain pour toutes les dťcorations ťtrangŤres.
ņ son arrivťe, monsieur de Richelieu le combla de marques de
confiance. Les prťparatifs qu'il lui fallut faire pour se rendre ŗ
Londres le retinrent assez longtemps pour avoir le malheur d'Ítre
appelť ŗ siťger au procŤs du marťchal Ney.
Je ne prťtends pas entrer dans le dťtail de cette dťplorable affaire.
Elle nous tint dans un grand ťtat d'anxiťtť. Pendant les derniers
jours du jugement, les pairs et tout ce qui leur appartenait reÁurent
des lettres menaÁantes. Il est ŗ peu prŤs reconnu que la pairie devait
condamner le marťchal. On a fort reprochť au Roi de ne lui avoir pas
fait gr‚ce. Je doute qu'il le pŻt; je doute aussi qu'il le voulŻt.
Quand on juge les ťvťnements de cette nature ŗ la distance des annťes,
on ne tient plus assez compte des impressions du moment. Tout le monde
avait eu peur, et rien n'est aussi cruel que la peur. Il rťgnait une
ťpidťmie de vengeance. Je ne veux d'autre preuve de cette contagion
que les paroles du duc de Richelieu en envoyant ce procŤs ŗ la Cour
des pairs. Puisque ce beau et noble caractŤre n'avait pu s'en
dťfendre, elle devait Ítre bien gťnťrale, et je ne sais s'il ťtait
possible de lui refuser la proie qu'elle rťclamait, sans la pousser ŗ
de plus grands excŤs.
Nous avons vu plus tard un autre Roi s'interposer personnellement
entre les fureurs du peuple et les tÍtes qu'elles exigeaient. Mais
d'abord, ce Roi-lŗ, selon moi, est un homme fort supťrieur, et puis
les honnÍtes gens de son parti apprťciaient et encourageaient cette
modťration. Il risquait une ťmeute populaire; sa vie pouvait y
succomber, mais non pas son pouvoir.
En 1815, au contraire, c'ťtait, il faut bien le dire, les honnÍtes
gens du parti, les princes, les ťvÍques, les Chambres, la Cour, aussi
bien que les ťtrangers, qui demandaient un exemple pour effrayer la
trahison. L'Europe disait: Vous n'avez pas le droit d'Ítre gťnťreux,
de faire de l'indulgence au prix de nos trťsors et de notre sang.
Le duc de Wellington l'a bien prouvť en refusant d'invoquer la
capitulation de Paris. La gr‚ce du marťchal ťtait dans ses mains, bien
plus que dans celles de Louis XVIII. Ajoutons que la peine de mort en
matiŤre politique se prťsentait alors ŗ tous les esprits comme de
droit naturel, et n'oublions pas que c'est ŗ la douceur du
gouvernement de la Restauration que nous devons d'avoir vu croÓtre et
se rťpandre aussi gťnťralement les idťes d'un libťralisme ťclairť.
Je ne prťtends en aucune faÁon excuser la frťnťsie qui rťgnait ŗ cette
ťpoque. J'ai ťtť aussi indignťe alors que je le serais ŗ prťsent de
voir des hommes de la sociťtť prodiguer libťralement leurs services
personnels pour garder le marťchal dans la chambre de sa prison, y
coucher, dans la crainte qu'il ne s'ťvad‚t, d'autres s'offrir
volontairement ŗ le conduire au supplice, les gardes du corps
solliciter comme une faveur et obtenir comme rťcompense la permission
de revÍtir l'uniforme de gendarme pour le garder plus ťtroitement et
ne lui laisser aucune chance de dťcouvrir sur le visage d'un vieux
soldat un regard de sympathie.
Tout cela est odieux, mais tout cela est vrai. Et je veux seulement
constater que, pour faire gr‚ce au marťchal Ney, il fallait plus que
de la bontť, il fallait un grand courage. Or, le roi Louis XVIII
n'ťtait assurťment pas sanguinaire, mais il avait ťtť trop
constamment, trop exclusivement prince pour faire entrer dans la
balance des intťrÍts la vie d'un homme comme d'un grand poids.
Au reste, ce pauvre marťchal, dont on a fait un si triste holocauste
aux passions du moment et que d'autres passions ont pris soin depuis
d'entourer d'aurťole, s'il avait vťcu, n'aurait ťtť pour les
impťrialistes que le traÓtre de Fontainebleau, le transfuge de
Waterloo, le dťnonciateur de Napolťon. Aux yeux des royalistes, la
culpabilitť de sa conduite ťtait encore plus dťmontrťe.
Mais ses torts civils se sont effacťs dans son sang et il n'est restť
dans la mťmoire de tous que cette intrťpiditť militaire si souvent et
si rťcemment employťe, avec une vigueur surhumaine, au service de la
patrie. La sagesse populaire a dit: ęIl n'y a que les morts qui ne
reviennent pas.Ľ J'ťtablirais plus volontiers qu'en temps de
rťvolution les morts seuls reviennent.
Je me souviens qu'un jour, pendant le procŤs, je dÓnais chez monsieur
de Vaublanc. Mon pŤre arriva au premier service, sortant du Luxembourg
et annonÁant un dťlai accordť ŗ la demande des avocats du marťchal.
Monsieur sieur de Vaublanc se leva tout en pied, jeta sa serviette
contre la muraille en s'ťcriant:
ęSi messieurs les Pairs croient que je consentirai ŗ Ítre ministre
avec des corps qui montrent une telle faiblesse, ils se trompent bien.
Encore une pareille l‚chetť et tous les honnÍtes gens n'auront plus
qu'ŗ se voiler le visage.Ľ
Il y avait trente personnes ŗ table dont plusieurs dťputťs, tous
faisaient chorus. Il ne s'agissait pourtant que d'un dťlai lťgal,
impossible ŗ refuser ŗ moins de s'ťriger en chambre ardente. On
comprend quelle devait Ítre l'exaltation des gens de parti lorsque
ceux qui dirigeaient le gouvernement ťtaient si cruellement
intempestifs.
Mon pŤre et moi ťchange‚mes notre indignation dŤs que nous fŻmes
remontťs en voiture; si nous l'avions exprimťe dans la maison, on nous
aurait lapidťs. Nous ťtions dťjŗ classťs au nombre des _gens mal
pensants_; mais ce n'est qu'aprŤs l'ordonnance du 5 septembre qu'il
fut constatť que je _pensais comme un cochon_. Ne riez pas, mes
neveux, c'est l'expression textuelle de fort grandes dames, et elles
la distribuaient largement.
Je rencontrais partout le duc de Raguse, et surtout chez madame de
Duras oý il venait familiŤrement. J'ťprouvais contre lui quelques-unes
des prťventions gťnťralement ťtablies et, sans avoir jamais aimť
Napolťon, je lui savais mauvais grť de l'avoir trahi. Les ťtrangers
bien informťs de cette transaction furent les premiers ŗ m'expliquer
combien la loyautť du marťchal avait ťtť calomniťe. Je remarquai, d'un
autre cŰtť, ŗ quel point, malgrť les insultes dont l'abreuvait le
parti bonapartiste, il restait fidŤle ŗ ses anciens camarades.
Il les soutenait toujours fortement et vivement dŤs qu'ils ťtaient
attaquťs, les louait volontiers sans aucune rťticence et se portait le
protecteur actif et zťlť de tous ceux qu'on molestait. Cela commenÁa ŗ
m'adoucir en sa faveur et ŗ me faire mieux goŻter un esprit trŤs
distinguť et une conversation animťe et variťe, mťrites qu'on ne
pouvait lui refuser. Le jour approchait oý mon affection pour lui
devait ťclore.
Monsieur de La Valette, fort de son innocence et persuadť qu'aux
termes de la loi il n'avait rien ŗ craindre, se constitua prisonnier.
Il aurait ťtť acquittť sans un document dont voici la source: le vieux
monsieur Ferrand, directeur de la poste, avait ťtť saisi d'une telle
terreur le jour du retour de l'Empereur qu'il n'osait plus rester ni
partir. Il demanda ŗ monsieur de La Valette, son prťdťcesseur sous
l'Empereur, de lui signer un permis de chevaux de poste. Celui-ci s'en
dťfendit longtemps, enfin il cťda aux larmes de madame Ferrand et,
pour calmer les terreurs du vieillard, il mit son nom au bas d'un
permis fait ŗ celui de monsieur Ferrand, dans son cabinet, et entourť
de sa famille pleine de reconnaissance.
C'est la seule preuve qu'on pŻt apporter qu'il eŻt repris ses
fonctions avant le terme que fixait la loi. Je suppose que la remise
de cette piŤce aura beaucoup coŻtť ŗ la famille Ferrand; j'avoue que
ce dťvouement royaliste m'a toujours paru hideux. Monsieur de
Richelieu en fut indignť. Il avait d'ailleurs horreur des
persťcutions, et, plus il s'aguerrissait aux affaires, plus il
s'ťloignait des opinions de parti. Ne pouvant ťviter le jugement de
monsieur de La Valette, il s'occupa d'obtenir sa gr‚ce s'il ťtait
condamnť.
De son cŰtť, monsieur Pasquier, quoique naguŤre garde des sceaux, alla
tťmoigner vivement et consciencieusement en sa faveur. Monsieur de
Richelieu demanda sa gr‚ce au Roi. Il lui rťpondit qu'il n'osait
s'exposer aux fureurs de sa famille mais que, si madame la duchesse
d'AngoulÍme consentait ŗ dire un mot en ce sens, il la lui accorderait
avec empressement. Le duc de Richelieu se rendit chez Madame et, avec
un peu de peine, il obtint son consentement. Il fut convenu qu'elle
demanderait la gr‚ce au Roi le lendemain aprŤs le dťjeuner. Il en fut
prťvenu.
Lorsque le duc de Richelieu arriva chez le Roi, le lendemain, le
premier mot qu'il lui dit fut:
ęHť bien! ma niŤce ne m'a rien dit, vous aurez mal compris ses
paroles.
--Non, Sire, Madame m'a promis positivement.
--Voyez-la donc et t‚chez d'obtenir la dťmarche, je l'attends si elle
veut venir.Ľ
Or, il s'ťtait passť un immense ťvťnement dans le palais des
Tuileries; car, la veille au soir, on y avait manquť aux habitudes.
Chaque jour aprŤs avoir dÓnť chez le Roi, Monsieur descendait chez sa
belle-fille ŗ huit heures; ŗ neuf heures il retournait chez lui.
Monsieur le duc d'AngoulÍme allait se coucher et Madame passait chez
sa dame d'atour, madame de Choisy. C'ťtait lŗ oý se rťunissaient les
plus purs, c'est-ŗ-dire les plus violents du parti royaliste.
Le soir en question, Madame les trouva au grand complet. Ils avaient
eu vent du projet de gr‚ce. Elle avoua Ítre entrťe dans ce complot, et
dit que son beau-pŤre et son mari l'approuvaient. AussitŰt les cris,
les dťsespoirs ťclatŤrent. On lui montra les dangers de la couronne si
imminents aprŤs un pareil acte que, chose sans exemple, elle monta
dans la voiture d'une personne de ce sanhťdrin et se rendit au
pavillon de Marsan oý elle trouva Monsieur ťgalement chapitrť par son
monde et fort disposť ŗ revenir sur le consentement qui lui avait ťtť
arrachť.
Il fut rťsolu que Madame ne ferait aucune dťmarche et que, si le
ministre et le Roi voulaient se dťshonorer, du moins le reste de la
famille royale n'y tremperait pas. Voilŗ ŗ quoi tenait le silence de
Madame. Monsieur de Richelieu obtint une audience, mais la trouva
inťbranlable. Elle ťtait trop engagťe. C'est de ce moment qu'a datť
leur mutuelle rťpugnance l'un pour l'autre.
Monsieur de Richelieu vint rendre compte au Roi.
ęJe l'avais prťvu; ils sont implacables, dit le monarque en soupirant;
mais, si je les bravais, je n'aurais plus un instant de repos.Ľ
Tandis que ceci se passait chez les princes, on ťtait venu demander au
duc de Raguse ce qu'il consentirait ŗ faire en faveur de monsieur de
La Valette. ęTout ce qu'on voudraĽ, avait-il rťpondu. Il se rendit
d'abord auprŤs du Roi, qui lui fit ce que lui-mÍme appelait son
_visage de bois_, le laissa parler aussi longtemps qu'il voulut, sans
donner le moindre signe d'intťrÍt et le congťdia sans avoir rťpondu
une parole.
Le marťchal comprit que monsieur de La Valette ťtait perdu. Ignorant
les dťmarches vainement tentťes auprŤs de Madame, il n'espťra qu'en
elle. Il courut avertir madame de La Valette qu'il fallait avoir
recours ŗ ce dernier moyen. Mais ce danger avait ťtť prťvu, tous les
accŤs lui ťtaient fermťs; elle ne pouvait arriver jusqu'ŗ la
princesse.
Le marťchal, qui ťtait de service comme major gťnťral de la garde, la
cacha dans son appartement et, pendant que le Roi et la famille royale
ťtaient ŗ la messe, il forÁa toutes les consignes et la fit entrer
dans la salle des Marťchaux par oý on ne pouvait ťviter de repasser.
Madame de La Valette se jeta aux pieds du Roi et n'en obtint que ces
mots: ęMadame, je vous plains.Ľ
Elle s'adressa ensuite ŗ madame la duchesse d'AngoulÍme et saisit sa
robe; la princesse l'arracha avec un mouvement qui lui a ťtť souvent
reprochť depuis et attribuť ŗ une haineuse colŤre. Je crois que cela
est parfaitement injuste. Madame avait engagť sa parole; elle ne
pouvait plus reculer. Probablement son mouvement a ťtť fait avec sa
brusquerie accoutumťe; mais je le croirais bien plutŰt inspirť par la
pitiť et le chagrin de n'oser y cťder que par la colŤre. Le malheur de
cette princesse est de n'avoir pas assez d'esprit pour diriger son
trop de caractŤre: la proportion ne s'y trouve pas.
La conduite du marťchal fut aussi bl‚mťe parmi les courtisans
qu'approuvťe du public. Il reÁut ordre de ne point reparaÓtre ŗ la
Cour et partit pour sa terre. L'officier des gardes du corps qui lui
avait laissť forcer la consigne fut envoyť en prison.
Ces [faits] prťalables connus, on s'ťtonnera moins du long cri de rage
qui s'ťleva dans tout le parti lorsqu'on apprit l'ťvasion de monsieur
de La Valette. Le Roi et les ministres furent soupÁonnťs d'y avoir
prÍtť les mains. La Chambre des dťputťs rugissait, les femmes
hurlaient. Il semblait des hyŤnes auxquelles on avait enlevť leurs
petits. On alla jusqu'ŗ vouloir sťvir contre madame de La Valette, et
l'on fut obligť de la faire garder quelque temps en prison pour
laisser calmer l'orage. Monsieur Decazes, fort aimť jusque-lŗ des
royalistes, commenÁa ŗ leur inspirer une dťfiance qui ne tarda guŤre ŗ
devenir de la haine.
Quoique le gouvernement n'eŻt en rien facilitť la fuite de monsieur de
La Valette, je pense qu'au fond il en fut charmť. Le Roi partagea
cette satisfaction. Il rappela assez promptement le duc de Raguse et
le traita bien au retour. Mais le parti fut moins indulgent et on lui
montra autant de froideur qu'il trouvait d'empressement jusque-lŗ.
J'en excepte toujours madame de Duras; elle faisait bande ŗ part dans
ce monde extravagant. Si elle se passionnait, ce n'ťtait jamais que
pour des idťes gťnťreuses, et la dťfaveur du marťchal ťtait un mťrite
ŗ ses yeux. Malgrť cette disposition de la maÓtresse de la maison,
l'isolement oý il se trouvait souvent dans son salon le rapprocha de
moi, et nous causions ensemble. Mais ce n'est que lorsque sa conduite
ŗ Lyon eut achevť de le brouiller avec le parti ultra-royaliste qu'il
vint se rťfugier dans la petite coterie qui s'est formťe autour de
moi, et dont il a ťtť un des piliers jusqu'ŗ ce que de nouveaux orages
aient encore une fois bouleversť son aventureuse existence.
J'aurai probablement souvent occasion d'en parler dorťnavant.
CHAPITRE X
FÍtes donnťes par le duc de Wellington. -- Monsieur le duc
d'AngoulÍme. -- Refus d'une grande-duchesse pour monsieur le duc
de Berry. -- On se dťcide pour une princesse de Naples. --
Traitement d'une ambassadrice d'Angleterre. -- Faveur de monsieur
Decazes. -- Monsieur de Polignac refuse de prÍter serment comme
pair. -- Mot de monsieur de Fontanes. -- Sťjour de la famille
d'Orlťans en Angleterre. -- Demande de madame la duchesse
d'Orlťans douairiŤre au marquis de RiviŤre.
Mon pŤre partit pour Londres dans le commencement de 1816; ma mŤre l'y
suivit. Je ne les rejoignis qu'au printemps.
Les ťtrangers s'ťtaient retirťs dans les diverses garnisons qui leur
avaient ťtť assignťes par le traitť de Paris. Le duc de Wellington
seul, en sa qualitť de gťnťralissime de toutes les armťes
d'occupation, rťsidait ŗ Paris et nous en faisait les honneurs ŗ nos
frais. Il donnait assez souvent des fÍtes oý il ťtait indispensable
d'assister. Il tenait ŗ avoir du monde et, notre sort dťpendant en
grande partie de sa bonne humeur, il fallait supporter ses caprices
souvent bizarres.
Je me rappelle qu'une fois il inventa de faire de la Grassini, alors
en possession de ses bonnes gr‚ces, la reine de la soirťe. Il la plaÁa
sur un canapť ťlevť dans la salle de bal, ne quitta pas ses cŰtťs, la
fit servir la premiŤre, fit ranger tout le monde pour qu'elle vÓt
danser, lui donna la main et la fit passer la premiŤre au souper,
l'assit prŤs de lui, enfin lui rendit les hommages qui d'ordinaire ne
s'accordent guŤre qu'aux princesses. Heureusement, il y avait quelques
grandes dames anglaises ŗ partager ces impertinences, mais elles
n'ťtaient pas obligťes de les subir comme nous et leur ressentiment ne
pouvait Ítre comparable.
En gťnťral, le carnaval fut trŤs triste, et cela ťtait convenable de
tout point. Nos princes n'allaient nulle part. Monsieur le duc de
Berry se trouvait tout ŗ fait ťclipsť par son frŤre; la diffťrente
conduite tenue par eux pendant les Cent-Jours justifiait cette
position. Cependant monsieur le duc d'AngoulÍme montrait des vellťitťs
de modťration qui commenÁaient ŗ dťplaire, et le parti dťvot ne lui
pardonnait pas son ťloignement pour la politique du confessionnal.
Le caractŤre de monsieur le duc d'AngoulÍme est singuliŤrement
difficile ŗ peindre. C'est une rťunion si bizarre et si disparate
qu'on peut, ŗ diverses ťpoques de sa vie, le reprťsenter comme un
prince sage, pieux, courageux, conciliant, ťclairť, ou bien comme un
bigot imbťcile et presque stupide, en disant ťgalement la vťritť. ņ
mesure que les circonstances se prťsenteront, je le montrerai tel que
nous l'avons vu; mais il faut commencer, pour le comprendre, par
admettre qu'il a toujours ťtť dominť par la pensťe de l'obťissance
illimitťe due au Roi. Plus il ťtait prŤs de la couronne, plus, selon
lui, il en devait l'exemple.
Tant que Louis XVIII a vťcu, cette passive obťissance ťtait un peu
modifiťe, au moins pour la forme, par celle qu'il accordait ŗ
Monsieur; mais, lorsque l'autoritť de pŤre et de roi a ťtť concentrťe
en Charles X, elle n'a plus connu de bornes et nous avons ťtť tťmoins
des tristes rťsultats qu'elle a amenťs.
On s'occupait de marier monsieur le duc de Berry; dťjŗ en 1814, il en
avait ťtť question. L'empereur Alexandre avait dťsirť lui voir ťpouser
sa soeur; la maniŤre dont elle avait ťtť repoussťe lui avait donnť
beaucoup d'humeur. Monsieur le duc de Berry souhaitait cette alliance,
mais le Roi et Monsieur trouvaient la maison de Russie trop peu
ancienne pour donner une mŤre aux fils de France.
Madame la duchesse d'AngoulÍme partageait cette maniŤre de voir. De
plus, elle redoutait une belle-soeur ŗ laquelle ses rapports
politiques auraient donnť une existence indťpendante et avec laquelle
il aurait fallu compter. Elle craignait aussi une princesse
personnellement accomplie qui aurait pu rallier autour d'elle les
personnes distinguťes par leur esprit pour lesquelles Madame a
toujours ťprouvť une rťpugnance instinctive, quelles qu'aient ťtť
leurs couleurs.
La princesse de Naples, nťe Bourbon, appartenant ŗ une petite Cour,
n'ayant reÁu aucune ťducation, rťunit tous les suffrages de la
famille. Elle fut imposťe ŗ monsieur le duc de Berry qui ne s'en
souciait nullement. Monsieur de Blacas fut chargť de cette nťgociation
qui n'occupa pas longuement ses talents diplomatiques.
Dans le mÍme temps, on conÁut l'idťe de marier Monsieur. Cela ťtait
assez raisonnable, mais Madame l'en dissuada le plus qu'elle put. Elle
aurait trop souffert ŗ voir une autre princesse tenir la Cour et
prendre le pas sur elle; et Monsieur, qui l'aimait tendrement,
n'eŻt-il pas eu d'autres motifs, n'aurait pas voulu lui donner ce
chagrin.
Cela me rappelle un mot heureux de Louis XVIII. Il ťtait goutteux,
infirme, dans un ťtat de santť pitoyable. Un jour oý il parlait
sťrieusement ŗ Monsieur de la convenance de se marier, celui-ci lui
dit en ricanant et d'un ton un peu goguenard:
ęMon frŤre, vous qui prÍchez si bien, pourquoi ne vous mariez-vous pas
vous-mÍme?
--Parce que je ferais des aÓnťs, mon frŤre,Ľ reprit le Roi trŤs
sŤchement.
Monsieur se tint pour battu.
L'intťrieur des Tuileries n'ťtait ni confiant, ni doux; cependant, ŗ
cette ťpoque, le Roi causait avec les siens des affaires publiques; la
rupture n'ťtait pas encore complŤte.
L'ambassadeur d'Angleterre, sir Charles Stuart, ťpousa lady …lisabeth
Yorke, fille de lord Hardwick. La prťsentation de la nouvelle
ambassadrice donna lieu, pour la premiŤre fois depuis la Restauration,
ŗ ce qu'on appelle en terme de Cour un _traitement_. Nous fŻmes
appelťes une douzaine de femmes, la plupart titrťes, ŗ nous trouver
chez madame la duchesse d'AngoulÍme ŗ deux heures. La situation de mon
pŤre en Angleterre me valut cette distinction.
Nous ťtions toutes rťunies dans le salon de Madame, lorsqu'un huissier
vint avertir madame de Damas, qui remplaÁait sa mŤre, madame de
Sťrent, dans le service de dame d'honneur, que l'ambassadrice
arrivait. Au mÍme instant, Madame, qui probablement, selon ses
habitudes, guettait ŗ sa fenÍtre, entra par une autre porte
magnifiquement parťe et, comme nous, en robe de Cour. Elle avait eu ŗ
peine le temps de nous dire bonjour et de s'asseoir que madame de
Damas rentra conduisant l'ambassadrice accompagnťe de la dame qui
l'avait ťtť quťrir, des maÓtres des cťrťmonies, et de l'introducteur
des ambassadeurs qui restŤrent ŗ la porte. Madame se leva, fit un ou
deux pas au-devant de l'ambassadrice, reprit son fauteuil et la fit
placer sur une chaise _ŗ dos_ prťparťe ŗ sa gauche. Les dames titrťes
s'assirent derriŤre, sur des pliants, et nous autres nous nous tÓnmes
debout. Cela dura assez longtemps: Madame soutint le dialogue ŗ elle
toute seule.
Lady …lisabeth, jeune et timide, ťtait trop embarrassťe pour rien
ajouter aux monosyllabes de ses rťponses et j'admirais la maniŤre dont
Madame exploita l'Angleterre et la France, l'Irlande et l'Italie d'oý
arrivait lady …lisabeth pour remplir le temps qu'allongeait outre
mesure la marche lente et pťnible du Roi.
Enfin il entra; tout le monde se leva; le silence le plus profond
rťgna. Il l'interrompit, quand il fut vers le milieu de la chambre,
pour dire sans sourciller, du ton le plus grave et d'une voix sonore,
la niaiserie convenue depuis le temps de Louis XIV: ęMadame, je ne
vous savais pas en si bonne compagnie.Ľ Madame lui rťpondit une autre
phrase, probablement ťgalement d'ťtiquette, mais que je ne me rappelle
pas. Ensuite le Roi adressa quelques paroles ŗ lady …lisabeth. Elle ne
lui rťpondit pas plus qu'ŗ Madame. Le Roi resta debout ainsi que tout
le monde; au bout de peu de minutes, il se retira.
Alors on s'assit, pour se relever immťdiatement ŗ l'entrťe de
Monsieur. ęNe devrai-je pas dire que je ne vous savais pas en aussi
bonne compagnie?Ľ, dit-il, en souriant; puis, s'approchant
gracieusement de lady …lisabeth, il lui prit la main et lui fit un
compliment obligeant. Il refusa d'accepter un siŤge que Madame lui
offrit, mais fit asseoir les dames et resta bien plus longtemps que le
Roi.
Les dames se levŤrent ŗ sa sortie, puis se rassirent pour se relever
de nouveau ŗ l'entrťe de monsieur le duc d'AngoulÍme; pour cette fois,
les premiers compliments passťs, il prit une chaise _ŗ dos_ et fit la
conversation. Il semblait que la timiditť de l'ambassadrice lui donn‚t
du courage. Je ne conserve aucune idťe d'avoir vu monsieur le duc de
Berry ŗ cette cťrťmonie. Je ne sais s'il s'en dispensait
ordinairement ou s'il en ťtait absent par accident. J'ignore aussi
comment cela s'est passť depuis pour madame la duchesse de Berry. Je
n'ai pas eu d'autre occasion d'assister ŗ pareilles rťceptions.
La sortie de monsieur le duc d'AngoulÍme fut accompagnťe du lever et
du _rassied_ comme les autres; je ne pus m'empÍcher de penser aux
gťnuflexions du vendredi saint. Au bout de quelques minutes, la dame
d'honneur avertit l'ambassadrice qu'elle ťtait ŗ ses ordres. Madame
lui fit une phrase sur la crainte de la fatiguer en la retenant plus
longtemps, et elle s'en alla, escortťe comme ŗ son arrivťe. Elle
remonta dans les carrosses du Roi, accompagnťe de la dame qui l'avait
ťtť chercher. Sa voiture ŗ six chevaux et en grand apparat suivait ŗ
vide. Madame s'entretint avec nous un instant de la nouvelle prťsentťe
et rentra dans son intťrieur ŗ ma grande satisfaction, car j'ťtais
depuis deux heures sur mes jambes et j'en avais assez de mes honneurs.
Cependant il fallut assister au dÓner ou _traitement_.
L'ambassadrice revint ŗ cinq heures. Cette fois, elle ťtait
accompagnťe de son mari et de quelques dames anglaises de distinction.
Toutes les franÁaises qui avaient assistť ŗ la rťception ťtaient
invitťes; il y avait aussi des hommes des deux pays.
Le premier maÓtre d'hŰtel, alors le duc des Cars, et la dame d'honneur
de Madame firent les honneurs du dÓner qui ťtait trŤs bon et
magnifique, mais sans ťlťgance comme tout ce qui se passait ŗ la Cour
des Tuileries. Immťdiatement aprŤs, chacun fut enchantť de se sťparer
et d'aller se reposer de toute cette ťtiquette. Les hommes ťtaient en
uniforme, les femmes trŤs parťes mais point en habit de Cour.
De Roi, de princesses, de princes, il n'en fut pas question; seulement
j'aperÁus derriŤre un paravent Madame et son mari qui, avant de
monter dÓner chez le Roi, s'amusaient ŗ regarder la table et les
convives.
Je n'ai jamais pu concevoir comment, lorsque les souverains ťtrangers
reÁoivent constamment et familiŤrement ŗ leur table les ambassadeurs
de France, ils consentaient ŗ subir, en la personne de leurs
reprťsentants, l'arrogance de la famille de Bourbon. Ne pas inviter
les ambassadeurs chez soi n'ťtait dťjŗ pas trop obligeant, mais les
faire venir avec tout cet appareil et cet _in fiochi_ dÓner ŗ l'office
m'a toujours paru de la derniŤre impertinence. Sans doute cet _office_
ťtait frťquentť par des gens de bonne maison; mais enfin c'ťtait une
seconde table dans le ch‚teau, car, apparemment, celle du Roi ťtait la
premiŤre.
Le festin ne se passait pas mÍme dans l'appartement du premier maÓtre
d'hŰtel oý cela aurait pu avoir l'apparence d'une rťunion de sociťtť;
les piŤces ťtaient trop petites et il logeait trop haut. On se
rťunissait dans la salle d'attente de l'appartement de Madame et on
dÓnait dans l'antichambre de monsieur le duc d'AngoulÍme, de maniŤre
qu'on semblait relťguť dans les piŤces extťrieures, comme lorsqu'on
prÍte un local ŗ ses gens pour une fÍte qu'on leur donne. Je
concevrais que les vieilles ťtiquettes de Versailles et de Louis XIV
eussent pu continuer sans interruption, mais je n'imagine pas qu'on
ait osť inventer de les renouveler.
Louis XVIII y tenait extrÍmement et, sans l'ťtat de sa santť et
l'espŤce d'humiliation que lui causaient ses infirmitťs, nous aurions
revu les levers et les couchers avec toutes leurs ridicules
cťrťmonies.
Monsieur en avait moins le goŻt et, ŗ son avŤnement au trŰne, il a
continuť l'usage ťtabli par son frŤre de borner le coucher ŗ une
courte rťception des courtisans ayant les entrťes et les chefs de
service qui venaient prendre le mot d'ordre. On ne disait plus: _je
vais au coucher_, mais _je vais ŗ l'ordre_. Cela ťtait ŗ la fois plus
digne et plus dťcent que ces habitudes de l'ancienne Cour dont le
pauvre Louis XVI donnait chaque soir le spectacle.
C'ťtait ŗ _l'ordre_ que les personnes de la Cour avaient occasion de
parler au Roi sans Ítre obligťes de solliciter une audience. Aussi la
permission d'aller ŗ _l'ordre_ ťtait-elle fort prisťe par les
courtisans de la Restauration.
Le favoritisme de monsieur Decazes s'ťtablissait de plus en plus;
monsieur de Richelieu y poussait de toutes ses forces. Pourvu que le
bien se fÓt, il lui ťtait bien indiffťrent par quel moyen et il
n'ťtait pas homme ŗ trouver une mesure sage moins sage parce qu'elle
s'obtenait par une autre influence que la sienne. Il ťtait trŤs
sincŤrement enchantť que monsieur Decazes prÓt la peine de plaire au
Roi et le voyait y rťussir avec une entiŤre satisfaction. Je crois, ŗ
vrai dire, que monsieur Decazes avait le bon sens de ne s'en point
targuer vis-ŗ-vis de ses collŤgues. Il mettait son crťdit en commun
dans le Conseil, mais, vis-ŗ-vis du monde, il commenÁait ŗ dťployer sa
faveur avec une joie de parvenu qui lui valait quelques ridicules.
Le Roi, qui avait toujours eu besoin d'une idole, partageait ses
adorations entre lui et sa soeur, madame Princeteau, bonne petite
personne, bien bourgeoise, qu'il avait fait venir de Libourne pour
tenir sa maison et qui ťtait fort gentille jusqu'ŗ ce que les fumťes
de l'encens lui eussent tournť la tÍte.
On a fait beaucoup d'histoires sur son compte; j'ignore avec quel
fondement. Ce que je sais, c'est qu'elle paraissait uniquement dťvouťe
ŗ son frŤre; et, si elle a eu un moment de crťdit personnel, elle le
lui a rapportť tout entier.
Pendant ce premier hiver de faveur, la maison de monsieur Decazes
ťtait trŤs frťquentťe. La fuite de monsieur de La Valette avait bien
apportť un lťger refroidissement; toutefois les plus chauds partisans
de l'ancien rťgime y allaient assidŻment. On espťrait se servir de
monsieur Decazes pour maintenir le Roi dans _la bonne voie_. La vanitť
du ministre l'aurait assez volontiers poussť dans la phalange
aristocratique qui, vers cette ťpoque, prit le nom d'_ultra_, si ses
exigences n'ťtaient devenues de jour en jour plus grandes. Quant au
monarque, il inspirait toujours beaucoup de mťfiance.
Monsieur Lainť avait remplacť monsieur de Vaublanc dont les folies
avaient comblť la mesure. Dans cette circonstance, monsieur de
Richelieu, selon son usage, avait, en ayant raison dans le fond, mis
les formes contre lui et l'avait chassť d'une faÁon qui fournissait au
parti qu'il reprťsentait quelque prťtexte de plaintes. Au reste, les
fureurs de monsieur de Vaublanc furent si absurdes qu'il se noya dans
le ridicule.
Le jour oý le nom de son successeur parut dans le _Moniteur_, je crus
devoir aller faire une visite chez monsieur de Vaublanc. Je ne
m'attendais pas ŗ Ítre reÁue; je fus admise quoique je n'eusse aucun
rapport intime avec lui et les siens. La porte ťtait ouverte ŗ tout
venant; il ťtait au milieu de ses paquets de ministre et de
particulier; mÍlant les affaires d'…tat et de mťnage de la faÁon la
plus comique. Un de ses commensaux vint lui raconter que son ministŤre
serait partagť entre trois personnes:
ęTrois, rťpondit-il sťrieusement, trois, ce n'est pas assez; ils ne
peuvent pas me remplacer ŗ moins de cinq.Ľ
Il ťnumťra sur ses doigts les cinq parties du ministŤre de l'intťrieur
qui rťclament la vie entiŤre de tout autre homme mais que lui menait
facilement toutes cinq de front, sans que rien fŻt jamais en retard;
et il nous fit faire l'inventaire de ses portefeuilles pour que nous
pussions tťmoigner que tout ťtait ŗ jour. Je n'ai jamais assistť ŗ
scŤne plus bouffonne, d'autant que la plupart des assistants lui
ťtaient aussi ťtrangers que moi.
Je n'entrerai pas dans le rťcit des extravagances du parti ŗ la
Chambre: elles sont trop importantes pour que l'histoire les nťglige;
mais je ne puis m'empÍcher de raconter une histoire qui m'a amusťe
dans le temps.
Un vieux dťputť de pur sang qui, comme le roi de Sardaigne, voulait
rťtablir l'ancien rťgime de tous points, rťclamait journellement et ŗ
grands cris nos _anciens supplices_, comme il disait. Un collŤgue un
peu plus avisť lui reprťsenta que, sans doute, cela serait fort
dťsirable mais qu'il ne fallait pas susciter trop d'embarras au
gouvernement du Roi et qu'il n'ťtait pas encore temps.
ęAllons, mon ami, reprit le dťputť en soupirant, vous avez peut-Ítre
raison, remettons la potence ŗ des temps plus heureux!Ľ
On ne saurait assez dire combien ce mot: _Il n'est pas encore temps_,
qui se trouvait sans cesse dans la bouche des habiles du parti
royaliste en 1814 et 1815, a fait d'ennemis ŗ la royautť et
l'influence qu'il a eue sur les Cent-Jours. Peut-Ítre ne
l'employaient-ils que pour calmer les plus violents des leurs, mais
les antagonistes y voyaient une de ces menaces vagues, d'autant plus
alarmantes qu'elles sont illimitťes, et les chefs des diverses
oppositions ne manquaient pas de l'exploiter avec zŤle.
D'autres petites circonstances se renouvelaient sans cesse pour
inspirer des doutes sur la bonne foi de la Cour.
Jules de Polignac fut crťť pair; il refusa de siťger. Il ne pouvait,
disait-il, lui, catholique, prÍter serment ŗ une charte reconnaissant
la libertť des cultes. Le Roi nomma une commission de pairs pour
l'arraisonner. Monsieur de Fontanes en ťtait, et je me rappelle qu'un
jour oý on lui demandait si leurs confťrences avaient rťussi, il
rťpondit avec un air de componction:
ęJe ne sais ce qui en rťsultera; mais je sais qu'il faut tenir sa
conscience ŗ deux mains pour ne pas cťder aux sentiments si nobles, si
ťclairťs, si entraÓnants que je suis appelť ŗ ťcouter.Ľ
Pour moi qui connaissais la logique de Jules, j'en conclus seulement
que monsieur de Fontanes croyait ce langage de mise dans le salon,
trŤs royaliste, oý il le tenait. Jules finit par cťder et prÍta
serment; mais, pendant toute cette nťgociation qui dura longtemps, il
ťtait ostensiblement caressť par Madame et par Monsieur, quoique ce
prince eŻt prÍtť le serment que Jules refusait. Toutefois la
Congrťgation, qui l'avait excitť au refus, craignit de s'Ítre trop
avancťe. Elle voulait se faire connaÓtre sans se trop compromettre.
Jules reÁut ordre de reculer.
Monsieur le nomma publiquement adjudant gťnťral de la garde nationale,
et lui confia, secrŤtement, la place de ministre de la police du
gouvernement occulte, car son existence remonte jusqu'ŗ cette ťpoque,
quoiqu'elle n'ait ťtť rťvťlťe que plus tard, et qu'il n'ait ťtť
complŤtement organisť qu'aprŤs la dissolution de la Chambre
introuvable.
Le sťjour prolongť de la famille d'Orlťans en Angleterre n'ťtait pas
entiŤrement volontaire. On avait contre elle de fortes prťventions au
palais des Tuileries, et le cabinet commenÁait ŗ les partager. Presque
tous les mťcontents invoquaient le nom de monsieur le duc d'Orlťans,
et la conduite toujours un peu mťticuleuse de ce prince semblait
justifier plus de dťfiance qu'elle n'en mťritait rťellement.
Monsieur de La Ch‚tre, courtisan nť, favorisait des soupÁons qu'il
savait plaire au Roi.
Telle ťtait la situation des affaires lorsque je quittai Paris pour me
rendre ŗ Londres. En ma qualitť de chroniqueur des petites
circonstances, il me revient ŗ l'esprit ce qui se passa devant moi le
jour oý j'allai prendre congť de madame la duchesse d'Orlťans
douairiŤre. Je la trouvai trŤs prťoccupťe et fort agitťe dans
l'attente du marquis de RiviŤre. Il partait le lendemain pour son
ambassade de Constantinople. La princesse lui avait ťcrit deux fois
dans la matinťe pour s'assurer sa visite. Monsieur de RiviŤre, mandť
chez le Roi, ne pouvait disposer de lui-mÍme. Sa femme ťtait lŗ,
promettant ŗ madame la duchesse d'Orlťans qu'il viendrait dŤs qu'il
sortirait des Tuileries, sans pouvoir calmer son anxiťtť. Enfin il
arriva. La joie que causa sa prťsence fut ťgale ŗ l'impatience avec
laquelle il ťtait attendu.
La princesse expliqua qu'elle avait un trŤs grand service ŗ lui
demander: monsieur de Follemont prenait du cafť plusieurs fois par
jour; il ťtait fort difficile et n'en trouvait que rarement ŗ son
goŻt. Madame la duchesse d'Orlťans attachait un prix infini ŗ ce que
l'ambassadeur de France ŗ Constantinople s'occup‚t de lui procurer le
meilleur cafť de moka fourni par l'Orient.
Le marquis de RiviŤre entra avec la patience exercťe d'un courtisan
dans tous les dťtails les plus minutieux, enfin il ajouta:
ęMadame veut-elle me dire combien elle en veut?
--Mais, je ne sais pas ... beaucoup ... le cafť se garde-t-il?
--Oui, madame, il s'amťliore mÍme.
--Eh bien, j'en veux beaucoup ... une grande provision.
--Je voudrais que madame me dÓt ŗ peu prŤs la quantitť?
--Mais ... mais, j'en voudrais bien douze livres.Ľ
Nous partÓmes tous d'un ťclat de rire. Elle aurait dit, tout de mÍme,
douze cent mille livres.
Malgrť l'ťmigration, elle n'avait acquis aucune idťe de la valeur des
choses ou de l'argent. Les femmes de son ‚ge, avant la Rťvolution,
conservaient une ignorance du matťriel de la vie qui aujourd'hui nous
paraÓt fabuleuse. Il n'ťtait pas mÍme nťcessaire d'Ítre princesse.
Madame de Preninville, femme d'un fermier gťnťral immensťment riche,
s'informant de ce qu'ťtait devenu un joli petit enfant, fils d'un de
ses gens, qu'elle voyait quelquefois jouer dans son antichambre, reÁut
pour rťponse qu'il allait ŗ l'ťcole.
ęAh! vous l'avez mis ŗ l'ťcole, et combien cela vous coŻte-t-il?
--Un ťcu par mois, madame.
--Un ťcu! C'est bien cher! J'espŤre au moins qu'il est bien nourri!Ľ
J'entendais rťvoquer en doute, il y a quelques jours, que madame
Victoire pŻt avoir eu la pensťe de nourrir le peuple de croŻte de p‚tť
pendant une disette. Pour moi, j'y crois, d'abord parce que ma mŤre
m'a dit que madame AdťlaÔde en plaisantait souvent sa soeur qui avait
horreur de la croŻte de p‚tť, au point d'ťprouver de la rťpugnance ŗ
en voir servir, et puis parce que j'ai encore vu et su tant de traits
de cette ingťnuitť vraie et candide sur la vie rťelle que cela
m'ťtonne beaucoup moins que la gťnťration nouvelle.
SIXI»ME PARTIE
L'ANGLETERRE ET LA FRANCE
1816-1820
CHAPITRE I
Retour en Angleterre. -- Aspect de la campagne. -- Londres. --
Concert ŗ la Cour. -- Ma prťsentation. -- La reine Charlotte. --
…gards du prince rťgent pour elle. -- La duchesse d'York. -- La
princesse Charlotte de Galles. -- Miss Mercer. -- Intrigue
dťjouťe par le prince Lťopold de Saxe-Cobourg. -- La marquise
d'Hertford. -- Habitudes du prince rťgent. -- DÓners ŗ Carlton
House.
AprŤs une absence de douze annťes, je revis l'Angleterre avec un vif
intťrÍt. J'y retrouvais le charme des souvenirs. Je rentrais dans la
patrie de ma premiŤre jeunesse; chaque dťtail m'ťtait familier et
pourtant suffisamment ťloignť de ma pensťe journaliŤre pour avoir
acquis le piquant de la nouveautť. C'ťtait un vieil ami, revenu de
loin, qu'on retrouve avec joie et qui rappelle agrťablement le temps
jadis, ce temps oý la vie, chargťe de moins d'ťvťnements, se porte
plus lťgŤre et laisse, avec plus de regrets peut-Ítre, un penser bien
plus doux ŗ repasser dans la mťmoire.
Je fus trŤs frappťe de l'immense prospťritť du pays. Je ne crois pas
qu'elle fŻt sensiblement augmentťe; mais l'habitude m'avait autrefois
blasťe sur l'aspect qu'il prťsente au voyageur et l'absence m'y avait
rendue plus attentive.
Ces chemins si bien soignťs, sur lesquels des chevaux de poste, tenus
comme nos plus ťlťgants attelages, vous font rouler si agrťablement,
cette multitude de voitures publiques et privťes, toutes charmantes,
ces innombrables ťtablissements qui ornent la campagne et donnent
l'idťe de l'aisance dans toutes les classes de la sociťtť, depuis la
cabane du paysan jusqu'au ch‚teau du seigneur, ces fenÍtres de la plus
petite boutique offrant aux rares rayons du soleil des vitres dont
l'ťclat n'est jamais terni par une lťgŤre souillure, ces populations
si propres se transportant d'un village ŗ un autre par des sentiers
que nous envierions dans nos jardins, ces beaux enfants si bien tenus
et prenant leurs ťbats dans une libertť qui contraste avec le maintien
rťservť du reste de la famille, tout cela m'ťtait familier et pourtant
me frappait peut-Ítre plus vivement que si c'eŻt ťtť la premiŤre fois
que j'en ťtais tťmoin.
Je fis la route de Douvres ŗ Londres par un beau dimanche du mois de
mai et dans un continuel enchantement. Il s'y mÍlait de temps en temps
un secret sentiment d'envie pour ma patrie. Le Ciel lui a ťtť au moins
aussi favorable; pourquoi n'a-t-elle pas acquis le mÍme degrť de
prospťritť que ses voisins insulaires?
Lorsque les chevaux de poste, suspendant leur course rapide, prirent
cette allure fastidieuse qu'ils affectent dans Londres, que
l'atmosphŤre lourde et enfumťe de cette grande ville me pesa sur la
tÍte, que je vis ses silencieux habitants se suivant l'un l'autre sur
leurs larges trottoirs comme un cortŤge funŤbre, que les portes, les
fenÍtres, les boutiques fermťes semblŤrent annoncer autant de
tristesse dans l'intťrieur des maisons que dans les rues, je sentis
petit ŗ petit tout mon ťpanouissement de coeur se resserrer et,
lorsque je descendis ŗ l'ambassade, mon enthousiasme sur l'Angleterre
avait dťjŗ reÁu un ťchec.
Quelque prodigieuse que soit la prospťritť commerciale de Londres et
le luxe qu'on y dťploie dans toutes les classes de la sociťtť, je
crois que son aspect paraÓtra bien moins remarquable ŗ un ťtranger que
celui du reste de l'Angleterre. Cette grande citť, composťe de petites
maisons pareilles et de larges rues tirťes au cordeau, toutes
semblables les unes aux autres, est frappťe de monotonie et d'ennui.
Aucun monument ne vint rťveiller l'attention fatiguťe. Quand on s'est
promenť cinq minutes, on peut se promener cinq jours dans des
quartiers toujours diffťrents et toujours pareils.
La Tamise, aussi bien que son immense mouvement qui attacherait un
caractŤre particulier ŗ cette capitale du monde britannique, est
soigneusement cachťe de toute part. Il faut une volontť assez
intelligente pour parvenir ŗ l'apercevoir, mÍme en l'allant chercher.
On a pu voir partout des rues qui ressemblent ŗ celles de Londres,
mais je ne crois pas qu'aucun autre pays puisse donner idťe de la
campagne en Angleterre. Je n'en connais point oý elle soit autant en
contraste avec la ville. On y voit un autre ciel; on y respire un
autre air. Les arbres y ont un autre aspect; les plantes s'y montrent
d'une autre couleur. Enfin c'est une autre population, quoique
l'habitant du Northumberland ou du Devonshire soit parfaitement
semblable ŗ celui du promeneur de Piccadilly.
On conÁoit, au reste, que le nuage orange, striť de noir, de brun, de
gris, saturť de suie, qui semble un vaste ťteignoir placť sur la
ville, influe sur le moral de la population et agisse sur ses
dispositions. Aussi n'y a-t-il aucune langue oý l'on vante les
charmes de la campagne, en vers et en prose, avec une passion plus
vive et plus sincŤre que dans la littťrature anglaise. Quiconque aura
passť trois mois ŗ Londres comprendra le bien-Ítre tout matťriel qu'on
ťprouve en en sortant.
Malgrť les vertiges qu'elle cause aux nouveaux dťbarquťs, cette
atmosphŤre si triste n'est pas malsaine; on s'y accoutume bientŰt
assez pour ne plus s'apercevoir qu'on en souffre. J'ai entendu
attribuer la salubritť de Londres au mouvement que la marťe apporte
quatre fois le jour dans la Tamise. Ce grand dťplacement forme un
ventilateur naturel qui agite et assainit cet air qui paraÓt ťpais,
mÍme ŗ la vue, et laisse sur les vÍtements les preuves positives que
l'oeil ne s'est pas trompť. La robe blanche, mise le matin, porte
avant la fin de la journťe des traces de souillures qu'une semaine ne
lui infligerait pas ŗ Paris. L'extrÍme recherche des habitants, leur
propretť, rendue indispensable par de telles circonstances, ont tirť
parti de ces nťcessitťs pour en combattre la mauvaise influence; et
l'aspect des maisons aussi bien que des personnes n'offre que les
apparences de la plus complŤte nettetť.
Si ma longue absence m'avait rendue plus sensible aux charmes de la
route, je l'ťtais davantage aussi aux inconvťnients de Londres qui ne
m'avaient guŤre frappťe jusque-lŗ. Dans la premiŤre jeunesse, on
s'occupe peu des objets extťrieurs.
Le surlendemain de mon arrivťe, le prince rťgent donnait un concert ŗ
la Reine sa mŤre. Pour Ítre admis, il fallait Ítre prťsentť. La Reine,
me sachant ŗ Londres, eut la bontť de se souvenir que je l'avais ťtť
autrefois et me fit inviter. Mes parents dÓnaient ŗ Carlton House. J'y
arrivai seule le soir, pensant me mÍler inaperÁue dans la foule. Il
ťtait un peu tard; le concert ťtait dťjŗ commencť.
La salle, en galerie, ťtait partagťe par des colonnes en trois parties
ŗ peu prŤs ťgales. Celle du milieu se trouvait exclusivement occupťe
par la Cour et les musiciens placťs vis-ŗ-vis de la Reine, des
princesses, de leurs dames, des ambassadrices et de quelques autres
femmes ayant les grandes entrťes qui ťtaient assises. Tout le reste de
la sociťtť se tenait dans les parties latťrales, sťparťes par les
colonnes, et restait debout. On circulait dans les autres salons,
selon l'usage gťnťral du pays, oý un concert ŗ banquettes paraÓtrait
horriblement ennuyeux.
Je trouvai ŗ la porte lady Macclesfield, une des dames du palais. Elle
m'attendait pour me conduire ŗ la Reine et, sans me donner un instant
pour respirer, me mena ŗ travers tout ce monde, toute cette musique,
tout ce silence et tout ce vide jusqu'ŗ Sa Majestť. Je n'avais pas
encore eu le temps d'avoir grand'peur; mais, au moment oý j'approchai,
la Reine se leva en pied, et les quarante personnes qui l'entouraient
imitŤrent son mouvement. Ce froufrou, auquel je ne m'attendais pas,
commenÁa ŗ m'intimider. La Reine fut trŤs bonne et trŤs gracieuse, je
crois; mais, pendant tout le temps qu'elle me parlait, je m'ťtais
occupťe que de l'idťe de mťnager ma retraite.
Lady Macclesfield m'avait quittťe pour reprendre sa place parmi ses
compagnes. Lorsque la Reine fit la petite indication de tÍte qui
annonÁait l'audience terminťe, je sentis le parquet s'effondrer sous
mes pas. J'ťtais lŗ, seule, abandonnťe, portant les yeux de toute
l'Angleterre braquťs sur ma personne et ayant un vťritable voyage ŗ
faire pour regagner, dans cet isolement, les groupes placťs derriŤre
les colonnes. Je ne sais pas comment j'y arrivai.
J'avais ťtť prťsentťe ŗ bien des Cours et ŗ bien des potentats. Je
n'ťtais plus assez jeune pour conserver une grande timiditť; j'avais
l'habitude du monde et pourtant il me reste de cette soirťe et de
cette prťsentation de faveur un souvenir formidable.
Ce n'est pas que la reine Charlotte fut d'un aspect bien imposant.
Qu'on se figure un pain de sucre couvert de brocart d'or et on aura
une idťe assez exacte de sa tournure. Elle n'avait jamais ťtť grande
et, depuis quelques annťes, elle ťtait rapetissťe et complŤtement
dťformťe. Sa tÍte, placťe sur un col extrÍmement court, prťsentait un
visage renfrognť, jaune, ridť, accompagnť de cheveux gris poudrťs ŗ
frimas. Elle ťtait coiffťe en bonnet, en turban, en toque, selon
l'occasion, mais toujours je lui ai vu une petite couronne fermťe, en
pierreries, ajoutťe ŗ sa coiffure. J'ai entendu dire qu'elle ne la
quittait jamais. Malgrť cette figure hťtťroclite, elle ne manquait
pourtant pas d'une sorte de dignitť; elle tenait sa cour ŗ merveille,
avec une extrÍme politesse et des nuances fort variťes.
SťvŤre pour la conduite des femmes, elle se piquait d'une grande
impartialitť; et souvent un regard froid, ou une parole moins
obligeante de la Reine ŗ une de ses protťgťes, a suffi pour arrÍter
une jeune personne sur les bords du prťcipice. Pour les femmes
divorcťes, elle ťtait inexorable. Jamais aucune, quelque excuse que le
public lui donn‚t, quelque bonne que fŻt sa conduite ultťrieure, n'a
pu franchir le seuil du palais.
Lady Holland en a ťtť une preuve bien marquante: son esprit, son
influence politique, la domination qu'elle exerÁait sur son mari, lui
avaient reconquis une existence sociale. Refuser d'aller ŗ Holland
House aurait paru une bťgueulerie ŗ peine avouable. Lady Holland y
tenait une cour frťquentťe par tout ce qu'il y avait de plus distinguť
en anglais et en ťtrangers; mais, quelques soins qu'elle se soit
donnťs, quelques nťgociateurs qu'elle ait employťs, et le prince
rťgent a ťtť du nombre, jamais, tant que la vieille Reine a vťcu, elle
n'a pu paraÓtre ŗ celle de Saint-James.
Je n'oserais dire que la Reine fŻt aimťe, mais elle ťtait vťnťrťe. Le
prince rťgent donnait l'exemple des ťgards. Il ťtait trŤs soigneux et
trŤs tendre pour elle en particulier. En public, il la comblait
d'hommages.
Je fus frappťe, le soir de ce concert, de voir un valet de chambre
apporter un petit plateau, avec une tasse de thť, un sucrier et un pot
ŗ crŤme et le remettre au Rťgent qui le prťsenta lui-mÍme ŗ sa mŤre.
Il resta debout devant elle pendant tout le temps qu'elle arrangea sa
tasse, sans se lever, sans se presser, sans interrompre sa
conversation. Seulement elle lui disait toujours en anglais, quelque
langue qu'elle parl‚t dans le moment: _Thank you, George._ Elle
rťpťtait le mÍme remerciement dans les mÍmes termes lorsque le prince
rťgent reprenait le plateau des mains du valet de chambre pour
recevoir la tasse vide. C'ťtait l'usage constant. Cette cťrťmonie se
renouvelait deux ŗ trois fois dans la soirťe, mais n'avait lieu que
lorsque la Reine ťtait chez le prince. Chez elle, c'ťtait
ordinairement une des princesses, quelquefois un des princes, jamais
le Rťgent, mais toujours un de ses enfants qui lui prťsentait sa tasse
de thť.
Tous les autres membres de la famille royale, y compris le Rťgent,
partageaient les rafraÓchissements prťparťs pour le reste de la
sociťtť, sans aucune distinction. En gťnťral, autant l'ťtiquette ťtait
sťvŤrement observťe pour la Reine, autant il en existait peu pour les
autres. Les princes et princesses recevaient et rendaient des visites
comme de simples particuliers.
Je me rappelle que, ce mÍme soir, oý j'avais subi la prťsentation ŗ
la Reine, me trouvant peu ťloignťe d'une petite femme trŤs blonde que
douze annťes d'absence avaient effacťe de mon souvenir, elle dit ŗ
lady Charlotte Greville avec laquelle je parlais:
ęLady Charlotte, nommez-moi ŗ madame de Boigne.Ľ
C'ťtait la duchesse d'York; elle resta longtemps ŗ causer avec nous
sur tout et de toutes choses, avec une grande aisance et sans aucune
forme princiŤre.
Le lendemain, ma mŤre me mena faire des visites ŗ toutes les
princesses; nous laiss‚mes des cartes chez celles qui ne nous admirent
pas et la prťsentation fut faite.
La princesse Charlotte de Galles, mariťe au prince de Cobourg, ťtait
encore plongťe dans les douceurs de la lune de miel et ne quittait pas
la campagne. Ma mŤre avait assistť ŗ son mariage, bťni dans un salon
de Carlton House. Lorsque, plus tard, je lui dis combien je regrettais
n'avoir pas partagť cet honneur, elle me rťpondit:
ęVous avez raison; c'est un spectacle rare que l'hťritiŤre d'un
royaume faisant un mariage d'amour et donnant sa main lŗ oý son coeur
est dťjŗ engagť. En tout, le bonheur parfait n'est pas commun; je
serai charmťe que vous veniez souvent en Ítre tťmoin ŗ Claremont.Ľ
Pauvre princesse!... Je ne fis connaissance avec elle qu'ŗ un autre
voyage. En ce moment, j'en entendais beaucoup parler. Elle ťtait fort
populaire, affectait les maniŤres brusques attribuťes ŗ la reine
…lisabeth qu'elle portait mÍme jusqu'ŗ avoir adoptť ses jurons. Elle
ťtait trŤs tranchťe dans ses opinions politiques, accueillait avec des
serrements de main les plus affectueux tous les hommes, jeunes ou
vieux, qu'elle regardait comme de son parti, ne manquait pas une
occasion de marquer de l'opposition au gouvernement de son pŤre et de
l'hostilitť personnelle ŗ sa grand'mŤre et ŗ ses tantes. Elle
professait une vive tendresse pour sa mŤre qu'elle regardait comme
sacrifiťe aux malveillances de sa famille.
La princesse Charlotte recherchait avec soin les occasions d'Ítre
impertinente pour les femmes qui composaient la sociťtť particuliŤre
du Rťgent. On lui avait persuadť que son pŤre avait eu le dťsir de
faire casser son mariage et de nier la lťgitimitť de sa naissance. Je
ne sais si cela a quelque fondement; en tout cas ses droits ťtaient
inscrits sur son visage: elle ressemblait prodigieusement au prince.
Elle ťtait nťe neuf mois aprŤs le mariage dont l'intimitť n'avait pas
durť beaucoup de jours. Il est certain que le prince de Galles avait
tenu ŗ cette ťpoque beaucoup de mauvais propos que la conduite de sa
femme n'a que trop justifiťs; mais je ne sache pas qu'il ait jamais
pensť ŗ attaquer l'existence de la princesse Charlotte.
Il accusait miss Mercer d'avoir montť la tÍte de la jeune princesse en
lui racontant cette fable; il l'avait expulsťe du palais et la
dťtestait cordialement. Miss Mercer conservait une correspondance
clandestine avec la princesse Charlotte. Elle avait excitť ses
rťpugnances contre le prince d'Orange que le cabinet anglais dťsirait
lui faire ťpouser et encouragť le goŻt que la grande-duchesse
Catherine de Russie avait cherchť ŗ lui faire prendre pour le prince
Lťopold de Saxe-Cobourg. Cette intrigue avait ťtť conduite par ces
deux femmes jusqu'au point d'amener la princesse Charlotte ŗ dťclarer
qu'elle voulait ťpouser le prince Lťopold et ťtait dťcidťe ŗ refuser
tout autre parti. L'opposition l'appuyait.
Miss Mercer, fille de lord Keith, riche hťritiŤre mais fort laide,
prťtendait de son cŰtť ťpouser le duc de Devonshire et lui apporter en
dot son crťdit sur la future souveraine. Tout le parti whig,
applaudissant ŗ cette alliance, s'ťtait liguť pour y dťterminer le
duc. Je ne sais s'il y aurait rťussi; mais, lorsque le mariage de la
princesse semblait avoir assurť le succŤs de cette longue intrigue,
elle ťchoua complŤtement devant le bon sens du prince Lťopold. Il
profita de la passion qu'il inspirait ŗ sa femme pour l'ťloigner de la
coterie dont elle ťtait obsťdťe, la rapprocher de sa famille et
changer son attitude politique et sociale. Ce ne fut pas l'affaire
d'un jour, mais il s'en occupa tout de suite et, dŤs la premiŤre
semaine, miss Mercer, s'ťtant rendue ŗ Claremont aprŤs y avoir ťcrit
quelques billets restťs sans rťponse, y fut reÁue si froidement
qu'elle dut abrťger sa visite, au point d'aller rechercher au village
sa voiture qu'elle y avait renvoyťe.
Des plaintes amenŤrent des explications dont le rťsultat fut que la
princesse manquerait de respect ŗ son pŤre en recevant chez elle une
personne qu'il lui avait dťfendu de voir. Miss Mercer fut outrťe; le
parti de l'opposition cessa d'attacher aucun prix ŗ son mariage avec
le duc de Devonshire et tout le monde se moqua d'elle d'y avoir
prťtendu.
Pour cacher sa dťconvenue, elle affecta de s'ťprendre d'une belle
passion pour monsieur de Flahaut que ses succŤs auprŤs de deux reines
du sang impťrial bonapartiste avaient inscrit au premier rang dans les
fastes de la galanterie. Il ťtait prťcisťment ce qu'on peut appeler un
charmant jeune homme et habile dans l'art de plaire. Il dťploya tout
son talent. Miss Mercer se trouva peut-Ítre plus engagťe qu'elle ne
comptait d'abord. Lord Keith se dťclara hautement contre cette
liaison; elle en acquit plus de prix aux yeux de sa fille. Quelques
mois aprŤs, elle ťpousa monsieur de Flahaut, malgrť la volontť
formelle de son pŤre qui ne lui a jamais tout ŗ fait pardonnť et l'a
privťe d'une grande partie de sa fortune. Madame de Flahaut n'a pas
dťmenti les prťcťdents de miss Mercer: elle a conservť le goŻt le
plus vif pour les intrigues politiques et les tracasseries sociales.
Le prince rťgent menait la vie d'un homme du monde. Il allait dÓner
chez les particuliers et assistait aux rťunions du soir. Ces habitudes
donnaient une existence ŗ part aux ambassadeurs; ils ťtaient
constamment priťs dans les mÍmes lieux que le prince et il en ťtait
presque exclusivement entourť. ņ tous les dÓners, il ťtait toujours ŗ
table entre deux ambassadrices; dans les soirťes, il se plaÁait
ordinairement sur un sopha ŗ cŰtť de lady Hertford et appelait une
ambassadrice de l'autre cŰtť.
Lady Hertford, qu'on nommait _la marquise_ par excellence, ťtait alors
la reine de ses pensťes. Elle avait ťtť trŤs belle, mais elle avait la
cinquantaine bien sonnťe et il y paraissait, quoiqu'elle fŻt trŤs
parťe et trŤs pomponnťe. Elle avait le maintien rigide, la parole
empesťe, le langage pťdant et chaste, l'air calme et froid. Elle
imposait au prince et exerÁait sur lui beaucoup d'empire, ťtait trŤs
grande dame, avait un immense ťtat et trouvait qu'en se laissant
quotidiennement ennuyer par le souverain elle lui accordait grande
faveur.
La princesse Charlotte avait essuyť ses dťdains envers elle, mais elle
lui avait rendu impertinence pour impertinence. La vieille Reine
l'accueillait avec des ťgards qui tťmoignaient de la bonne opinion
qu'elle lui conservait et lady Hertford promenait son _torysme_ dans
les salons avec toute la hauteur d'une sultane.
Le prince se levait extrÍmement tard; sa toilette ťtait ťternelle. Il
restait deux heures entiŤres en robe de chambre. Dans cet intťrieur,
il admettait quelques intimes, ses ministres et les ambassadeurs
ťtrangers lorsqu'ils lui faisaient demander ŗ entrer. C'ťtait ce qui
lui plaisait le mieux. Si on ťcrivait pour obtenir une audience ou
qu'on la lui demand‚t d'avance, il recevait habillť et dans son
salon, mais cela dťrangeait ses habitudes et le gÍnait. En se
prťsentant ŗ sa porte sans avoir prťvenu, il ťtait rare qu'on ne fŻt
pas admis. Il commenÁait la conversation par une lťgŤre excuse sur le
dťsordre oý on le trouvait, mais il en ťtait de meilleure humeur et
plus disposť ŗ la causerie.
Il n'achevait sa toilette qu'au dernier moment, lorsqu'on lui
annonÁait ses chevaux. Il montait ŗ cheval, suivi d'un seul
palefrenier, et allait au Parc oý il se laissait aborder facilement. ņ
moins qu'il ne dÓt: ęPromenons-nous ensembleĽ, on se bornait ŗ en
recevoir un mot en passant sans essayer de le suivre. Quand il
s'arrÍtait, c'ťtait une grande politesse, mais elle excluait la
familiaritť et on ne l'accompagnait pas. La premiŤre annťe, il
s'arrÍtait pour mon pŤre, mais, lorsqu'il le traita plus amicalement,
ou il l'engageait ŗ se promener avec lui, ou il lui faisait un signe
de la main en passant sans jamais s'arrÍter.
Du Parc il se rendait chez lady Hertford oý il achevait sa matinťe.
Plus habituellement sa voiture l'y venait prendre, quelquefois il
revenait ŗ cheval. Il fallait Ítre trŤs avant dans sa faveur pour que
lady Hertford engage‚t ŗ venir chez elle ŗ l'heure du prince, et
encore trouvait-on souvent la porte fermťe. Les ministres y allaient
frťquemment.
Lady Hertford sans avoir beaucoup d'esprit, avait un grand bon sens,
n'entrait dans aucune intrigue, ne voulait rien pour elle ni pour les
siens; elle ťtait au fond la meilleure intimitť que le prince, ŗ qui
la sociťtť des femmes ťtait nťcessaire, pŻt choisir. Les ministres ont
eu occasion de s'en persuader encore davantage lorsque le Rťgent,
devenu roi, a remplacť cette affection, toute de convenance, par une
fantaisie pour lady Conyngham dont le ridicule n'a pas ťtť le seul
inconvťnient.
Le prince rťgent avait trois maniŤres d'inviter ŗ dÓner. Sur une
ťnorme carte, le grand chambellan prťvenait _par ordre_ qu'on ťtait
conviť _pour rencontrer la Reine_. Alors, on ťtait en grand uniforme.
Le secrťtaire intime, sir Benjamin Bloomfield, avertissait par un
petit billet personnel, ťcrit ŗ la main, que le prince priait pour tel
jour. Alors, c'ťtait en frac et la forme la plus ordinaire. Elle
s'adressait aux femmes comme aux hommes. Les dÓners n'ťtaient jamais
de plus de vingt et ordinairement de douze ŗ quinze personnes.
La troisiŤme maniŤre ťtait rťservťe pour les intimes. Le prince
envoyait, le matin mÍme, un valet de pied dire verbalement que, si
monsieur un tel ťtait tout ŗ fait libre et n'avait rien ŗ faire, le
prince l'engageait ŗ venir dÓner ŗ Carlton House, mais il le priait
surtout de ne pas se gÍner. Il ťtait bien entendu cependant qu'on
n'avait jamais autre chose ŗ faire, et je crois que le prince aurait
trouvť trŤs ťtrange qu'on ne se rendit pas ŗ cette invitation. Mon
pŤre avait fini par la recevoir trŤs frťquemment. Elle ne s'adressait
jamais aux femmes. Ces dÓners n'ťtaient que de cinq ŗ six personnes et
la liste des invitťs ťtait fort limitťe.
CHAPITRE II
Le corps diplomatique. -- La comtesse de Lieven. -- La princesse
Paul Esterhazy. -- Vie des femmes anglaises. -- Leur enfance. --
Leur jeunesse. -- Leur ‚ge mŻr. -- Leur vieillesse. -- Leur mort.
-- Sort des veuves.
La ligne de dťmarcation entre les ambassadeurs et les ministres
plťnipotentiaires est plus marquťe ŗ la Cour d'Angleterre qu'ŗ aucune
autre. Les ambassadeurs ťtaient de tout, les ministres de rien.
Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux, si ce n'est peut-Ítre le
ministre de Prusse et encore bien rarement, ait dÓnť ŗ Carlton House.
Ils n'allaient pas aux soirťes de la Reine oý l'on admettait pourtant
quelquefois les ťtrangers de distinction qu'ils avaient prťsentťs et,
dans les salons, ils ne jouissaient d'aucune prťrogative, tandis que
les ambassadeurs prenaient le pas sur tout le monde.
Cette grande diffťrence dťplaisait ŗ une partie du corps diplomatique,
sans nuire pourtant ŗ sa bonne intelligence qui n'a pas ťtť troublťe
pendant mon sťjour en Angleterre. La comtesse de Lieven y tenait la
premiŤre place: ťtablie depuis longtemps dans le pays, elle y avait
une importance sociale et une influence politique toute personnelle
qu'on ne pouvait lui disputer.
L'arrivťe de la princesse Paul Esterhazy lui avait causť de vives
inquiťtudes. L'Autriche ťtait alors l'alliťe la plus intime du cabinet
anglais. Lord Castlereagh subissait l'influence du prince de
Metternich. Paul Esterhazy, fort bien traitť par le Rťgent, ťtait dŤs
longtemps trŤs accueilli dans la sociťtť. La jeune femme qu'il
ramenait se trouvait petite niŤce de la Reine, propre niŤce de la
duchesse de Cumberland, cousine et bientŰt favorite de la princesse
Charlotte.
C'ťtaient bien des moyens de succŤs. La comtesse de Lieven en frťmit
et ne put cacher son dťpit, car, en outre de ses autres avantages, la
nouvelle ambassadrice ťtait plus jeune, plus jolie, et avait un
impertinent embonpoint qui offusquait la dťsespťrante maigreur de sa
rivale. Cependant elle s'aperÁut promptement que la princesse ne
profiterait pas de sa brillante position. Toute aux regrets d'une
absence forcťe de Vienne, elle pťrissait de chagrin ŗ Londres et, au
bout de fort peu de mois, elle obtint la permission de retourner en
Allemagne. Elle ťtait ŗ cette ťpoque fort gentille et fort bonne
enfant; nous la voyions beaucoup, elle se rťfugiait dans notre
intťrieur contre les ennuis du sien et contre les politesses hostiles
et perfides de la comtesse de Lieven. Je dois convenir lui en avoir vu
exercer envers la princesse Esterhazy. Pour nous, elle a ťtť
uniformťment gracieuse et obligeante; nous n'offusquions en rien ses
prťtentions.
La France, ťcrasťe par une occupation militaire et les sommes ťnormes
qui lui ťtaient imposťes, avait besoin de tout le monde pour l'aider ŗ
soulever quelque peu de ce fardeau et n'ťtait en mesure de disputer le
pavť ŗ personne.
La comtesse, devenue princesse de Lieven, a un esprit extrÍmement
distinguť, exclusivement appliquť ŗ la diplomatie plus encore qu'ŗ la
politique. Pour elle tout se rťduit ŗ des questions de personnes. Un
long sťjour en Angleterre n'a pu, sous ce point de vue, ťlargir ses
premiŤres idťes russes, et c'est surtout cette faÁon d'envisager les
ťvťnements qui lui a acquis et peut-Ítre mťritť la rťputation d'Ítre
trŤs intrigante. En 1816, elle ťtait peu aimťe mais fort redoutťe ŗ
Londres. On y tenait beaucoup de mauvais propos sur sa conduite
personnelle, et la vieille Reine tťmoignait parfois un peu d'humeur de
la nťcessitť oý elle se trouvait de l'accueillir avec distinction.
Madame de Lieven n'aurait pas tolťrť la moindre nťgligence en ce
genre.
Je ne saurais dire ce qu'est monsieur de Lieven, certainement homme de
fort bonne compagnie et de trŤs grandes maniŤres, parlant peu mais ŗ
propos, froid mais poli. Quelques-uns le disent trŤs profond, le plus
grand nombre le croient trŤs creux. Je l'ai beaucoup vu et j'avoue
n'avoir aucune opinion personnelle. Il ťtait complŤtement ťclipsť par
la supťrioritť incontestťe de sa femme qui affectait cependant de lui
rendre beaucoup et semblait lui Ítre ťgalement soumise et attachťe. On
ne la voyait presque jamais sans lui: ŗ pied, en voiture, ŗ la ville,
ŗ la campagne, dans le monde, partout on les trouvait ensemble; et
pourtant personne ne croyait ŗ l'union sincŤre de ce mťnage.
Le prince Paul Esterhazy, grand seigneur, bon enfant, ne manque ni
d'esprit, ni de capacitť dans les affaires. Il est infiniment moins
nul qu'un rire assez niais a autorisť ses dťtracteurs ŗ le publier
pendant longtemps. Il est difficile de se prťsenter dans le monde avec
autant d'avantages de position sans y exciter des jalousies.
Parmi les hommes du corps diplomatique, le comte Palmella ťtait le
seul remarquable. Il a jouť un assez grand rŰle dans les vicissitudes
du royaume de Portugal pour que l'histoire se charge du soin
d'apprťcier tout le bien et tout le mal que les partis en ont dit. Je
n'ai aucun renseignement particulier sur lui: on m'a souvent avertie
qu'il avait beaucoup d'esprit; je n'en ai jamais ťtť frappťe. Il ťtait
joueur et menait ŗ Londres une vie dťsordonnťe qui l'ťloignait de
l'intimitť de ses collŤgues et lui causait du malaise vis-ŗ-vis d'eux.
Je me retrouvai ŗ peu prŤs ťtrangŤre dans le monde anglais; la sociťtť
s'ťtait presque entiŤrement renouvelťe. La mort y avait fait sa
cruelle rťcolte; beaucoup de mes anciennes amies avaient succombť. Un
assez grand nombre voyageaient sur le continent que la paix avait
enfin rouvert ŗ l'humeur vagabonde des insulaires britanniques;
d'autres ťtaient ťtablies ŗ la campagne. Les plus jeunes se livraient
aux soins de l'ťducation de leurs enfants; celles plus ‚gťes
subissaient la terrible corvťe de mener leurs filles ŗ la quÍte d'un
mari.
Je ne connais pas un mťtier plus pťnible. Il faut beaucoup d'esprit
pour pouvoir y conserver un peu de dignitť; aussi est-il assez
gťnťralement admis que les mŤres peuvent en manquer impunťment dans
cette phase de leur carriŤre.
La vie des anglaises est mal arrangťe pour l'‚ge mŻr; cette
indťpendance de la famille dont le poŤte a si bien peint le rťsultat:
That independence Briton's prize so high,
Keeps man from man, and breaks the social tye,
pŤse principalement sur les femmes.
L'enfance, trŤs soignťe, est ordinairement heureuse; elle est censťe
durer jusqu'ŗ dix-sept ou dix-huit ans. ņ cet ‚ge, on quitte la
_nursery_; on est prťsentť ŗ la Cour; le nom de la fille est gravť sur
la carte de visite de la mŤre; elle est menťe en tout lieu et passe
immťdiatement de la retraite complŤte ŗ la plus grande dissipation.
C'est le moment de la chasse au mari.
Les filles y jouent aussi leur rŰle, font des avances trŤs marquťes et
ordinairement ont grand soin de _tomber amoureuses_, selon
l'expression reÁue, des hommes dont la position sociale leur paraÓt
la plus brillante. S'il joint un titre ŗ une grande fortune, alors
tous les coeurs de dix-huit ans sont ŗ sa disposition.
L'habiletť du chaperon consiste ŗ laisser assez de libertť aux jeunes
gens pour que l'homme ait occasion de se laisser sťduire et engager,
et pas assez pour que la demoiselle soit compromise, si on n'obtient
pas de succŤs. Toutefois, le remŤde est ŗ cŰtť du mal. Un homme qui
rendrait des soins assidus ŗ une jeune fille pendant quelques mois et
qui se retirerait sans _proposer_, comme on dit, serait bl‚mť, et,
s'il rťpťtait une pareille conduite, trouverait toutes les portes
fermťes.
On a accusť quelques jeunes gens ŗ la mode d'avoir su _proposer_ avec
une telle adresse qu'il ťtait impossible _d'accepter_; mais cela est
rare. Ordinairement, les _assiduitťs_, pour me servir toujours du
vocabulaire convenu, amŤnent une dťclaration d'amour en forme ŗ la
demoiselle et, par suite, une demande en mariage aux parents.
C'est pour arriver ŗ ces _assiduitťs_ qu'il faut souvent jeter la
ligne plusieurs campagnes de suite. Cela est tellement dans les moeurs
du pays que, lorsqu'une jeune fille a atteint ses dix-huit ans et que
sa mŤre, pour une cause quelconque, ne peut la mener, on la confie ŗ
une parente, ou mÍme ŗ une amie, pour la conduire ŗ la ville, aux
eaux, dans les lieux publics, en un mot lŗ oý elle peut trouver des
_chances_. Les parents qui s'y refuseraient seraient hautement bl‚mťs
comme manquant ŗ tous leurs devoirs. Il est ťtabli qu'ŗ cet ‚ge une
demoiselle entre en vente et qu'on doit la diriger sur les meilleurs
marchťs. J'ai entendu une tante, ramenant une charmante jeune niŤce
qu'elle avait conduite ŗ des eaux trŤs frťquentťes, dire ŗ la mŤre
devant elle: ęWe have had no bite as yet this season, but several
glorious nibblesĽ, et proposer de l'y ramener l'annťe suivante, si
l'hameÁon n'avait pas rťussi ailleurs.
Comme on est toujours censť se marier par amour, et qu'ordinairement
il y en a un peu, du moins d'un cŰtť, les premiŤres annťes de mariage
sont celles oý les femmes vivent le plus dans leur intťrieur. Si leur
mari a un goŻt dominant, et les anglais en professent presque
toujours, elles s'y associent. Elles sont trŤs maÓtresses dans leur
mťnage, et souvent, ŗ l'aide de quelques phrases banales de
soumission, dominent mÍme la communautť.
Les enfants arrivent. Elles les soignent admirablement; la maison
s'anime. Le mari, l'amour passť, conserve quelque temps encore les
habitudes casaniŤres. L'ennui survient ŗ son tour. On va voyager. Au
retour, on se dit qu'il faut rťtablir des relations nťgligťes, afin de
produire dans le monde plus avantageusement les filles qui
grandissent. C'est lŗ le moment de la coquetterie pour les femmes
anglaises, et celui oý elles succombent quelquefois. C'est alors qu'on
voit des mŤres de famille, touchant ŗ la quarantaine, s'ťprendre de
jeunes gens de vingt-cinq ans et fuir avec eux le domicile conjugal oý
elles abandonnent de nombreux enfants.
Lorsqu'elles ont ťchappť ŗ ce danger, et assurťment c'est la grande
majoritť, arrive ce mťtier de promeneuse de filles qui me paraÓt si
dur. Pour les demoiselles, la situation est supportable; elles ont des
distractions. La dissipation les amuse souvent; elles y prennent
[goŻt] naturellement et gaiement. Mais, pour les pauvres mŤres, on les
voit toujours ŗ la besogne, s'inquiťtant de tous les bons partis, de
leurs allures, de leurs habitudes, de leurs goŻts, les suivant ŗ la
piste, s'agitant pour les faire rencontrer ŗ leurs filles. Leur visage
s'ťpanouit quand un frŤre aÓnť vient les prier ŗ danser; si elles
causent avec un cadet, en revanche, les mŤres s'agitent sur leurs
banquettes et paraissent au supplice.
Sans doute les plus spirituelles dissimulent mieux cet ťtat d'anxiťtť
perpťtuel, mais il existe pour toutes. Et qu'on ne me dise pas que ce
n'est que dans la classe vulgaire de la sociťtť, c'est dans toutes.
En 1816, aucune demoiselle anglaise ne valsait. Le duc de Devonshire
arriva d'un voyage en Allemagne; il raconta un soir, ŗ un grand bal,
qu'une femme n'ťtait complŤtement ŗ son avantage qu'en valsant, que
rien ne la faisait mieux valoir. Je ne sais si c'ťtait malice de sa
part, mais il rťpťta plusieurs fois cette assertion. Elle circula et,
au bal prochain, toutes les demoiselles valsaient. Le duc les admira
beaucoup, dit que cela ťtait charmant et animait parfaitement un bal,
puis ajouta nťgligemment que, pour lui, il ne se dťciderait jamais ŗ
ťpouser une femme qui valserait.
C'est ŗ la duchesse de Richemond et ŗ Carlton House qu'il fit cette
rťvťlation. La pauvre duchesse, la plus maladroite de ces mŤres ŗ
projets, pensa tomber ŗ la renverse. Elle la rťpťta ŗ ses voisines qui
la redirent aux leurs; la consternation gagna de banquette en
banquette. Les rires des personnes dťsintťressťes et malveillantes
ťclatŤrent. Pendant tout ce temps, les jeunes ladys valsaient en
sŻretť de conscience; les vieilles enrageaient; enfin la
malencontreuse danse s'acheva.
Avant la fin de la soirťe, la bonne duchesse de Richemond avait ťtabli
que ses filles ťprouvaient une telle rťpugnance pour la valse qu'elle
renonÁait ŗ obtenir d'elles de la surmonter. Quelques jeunes filles
plus fiŤres continuŤrent ŗ valser; le grand nombre cessa. Les habiles
dťcidŤrent qu'on valsait exclusivement ŗ Carlton House pour plaire ŗ
la vieille Reine qui aimait cette danse nationale de son pays. Il est
certain que, malgrť son excessive pruderie, elle semblait prendre
grand plaisir ŗ retrouver ce souvenir de sa jeunesse.
La rude t‚che de la mŤre se prolonge, plus ou moins, selon le nombre
de ses filles et la facilitť qu'elle trouve ŗ les placer. Une fois
mariťes, elles lui deviennent ťtrangŤres, au point qu'on s'invite
rťciproquement ŗ dÓner, par ťcrit, huit jours d'avance. En aucun pays
le prťcepte de l'…vangile: _PŤre et mŤre quitteras pour suivre ton
mari_, n'est entrť plus profondťment dans les moeurs.
D'un autre cŰtť, dŤs que le fils aÓnť a atteint ses vingt et un ans,
son premier soin est de se faire un ťtablissement ŗ part. Cela est
tellement convenu que le pŤre s'empresse de lui en faciliter les
moyens. Quant aux cadets, la nťcessitť de prendre une carriŤre, pour
acquťrir de quoi vivre, les a depuis longtemps ťloignťs de la maison
paternelle.
Suivons la mŤre. La voilŗ rentrťe dans son intťrieur devenu
complŤtement solitaire, car, pendant le temps, de ces dissipations
forcťes, le mari a pris l'habitude de passer sa vie au club. Que
fera-t-elle? Supportera-t-elle cet isolement dans le moment de la vie
oý on a le plus besoin d'Ítre entourť? On ne saurait l'exiger. Elle
ira augmenter ce nombre de vieilles femmes qui peuplent les assemblťes
de Londres, se parant chaque jour, veillant chaque nuit, jusqu'ŗ ce
que les infirmitťs la forcent ŗ s'enfermer dans sa chambre, oý
personne n'est admis, et ŗ mourir dans la solitude.
Qu'on ne reproche donc pas aux femmes anglaises de courir aprŤs les
plaisirs dans un ‚ge assez avancť pour que cela puisse avoir
l'apparence d'un manque de dignitť. Les moeurs du pays ne leur
laissent d'autre alternative que le grand nombre ou la solitude,
l'extrÍme dissipation ou l'abandon. Si elles perdent leur mari, leur
sort est encore bien plus cruel car une pťnurie relative, suivant
leur condition, vient l'aggraver. La belle-fille arrive, accompagnant
son mari, prend immťdiatement possession du ch‚teau, donne tous les
ordres. La mŤre s'occupe de faire ses paquets et, au bout de fort peu
de jours, se retire dans un modeste ťtablissement que souvent la
sollicitude du feu lord lui a prťparť.
Il est rare que son revenu excŤde le dixiŤme de celui qu'elle a ťtť
accoutumťe ŗ partager, et elle voit son fils hťriter, de son vivant,
de la fortune qu'elle-mÍme a apportťe. C'est la loi du pays: ŗ moins
de prťcautions prises dans le contrat de mariage, la dot de la femme
appartient tellement au mari que ses hťritiers y ont droit, mÍme
pendant la vie de la veuve dont gťnťralement toutes les prťtentions se
rťsolvent en une pension viagŤre.
Nos demoiselles franÁaises ne doivent pas trop envier ŗ leurs jeunes
compagnes anglaises la libertť dont elles jouissent et leurs mariages
soi-disant d'inclination. Cette indťpendance de la premiŤre jeunesse a
pour rťsultat de les laisser sans protection contre la tyrannie d'un
mari s'il veut l'exercer, et de leur assurer l'isolement de l'‚ge mŻr
si elles y arrivent.
S'il est permis de se servir de cette expression, les anglaises me
semblent avoir un nid plutŰt qu'un intťrieur, des petits plutŰt que
des enfants.
CHAPITRE III
Indťpendance du caractŤre des anglais. -- DÓner chez la comtesse
Dunmore. -- Jugement portť sur lady George Beresford. -- Salons
des grandes dames. -- Comment on comprend la sociťtť en
Angleterre et en France. -- Bal donnť chez le marquis d'Anglesey.
-- Lady Caroline Lamb. -- Mariage de monsieur le duc de Berry. --
Rťponse du prince de Poix.
J'examinais les usages d'un oeil plus curieux ŗ ce retour que lorsque,
plus jeune, je n'avais aucun autre point de comparaison, et je
trouvais que, si l'Angleterre avait l'avantage bien marquť dans le
matťriel de la vie, la sociabilitť ťtait mieux comprise en France.
Personne n'apprťcie plus haut que moi le noble caractŤre, l'esprit
public qui distinguent la nation.
Avec cet admirable bon sens qui fait la force du pays, l'anglais,
malgrť son indťpendance personnelle, reconnaÓt la hiťrarchie des
classes. En traversant un village, on entend souvent un homme sur le
pas de sa chaumiŤre dire ŗ sa petite fille: ęCurtsey to your betters,
BetsyĽ, expression qui ne peut se traduire exactement en franÁais.
Mais ce mÍme homme n'admet point de supťrieur lŗ oý son droit lťgal
lui paraÓt atteint.
Il a ťgalement recours ŗ la loi contre le premier seigneur du comtť
par lequel il se pense molestť et contre le voisin avec lequel il a
une querelle de cabaret. C'est sur cette confiance qu'elle le protŤge
dans toutes les occurrences de la vie qu'est fondť le sentiment
d'indťpendance d'oý naÓt ce respect de lui-mÍme, cachet des hommes
libres.
D'autre part, cette indťpendance, ennemie de la sociabilitť et qui
porterait avec elle un caractŤre un peu sauvage, est modifiťe par la
passion qu'a la classe infťrieure de ne rien faire qui ne soit
_genteel_, et la classe plus ťlevťe rien qui ne soit _gentlemanlike_.
C'est lŗ le lien qui unit les anglais entre eux. Quant ŗ la fantaisie
d'Ítre _fashionable_, c'est le but du petit nombre. Elle est poussťe
souvent jusqu'au ridicule.
En observant les deux pays de prŤs, on remarque combien des gens,
ťgalement dťlicats dans le fond de leurs sentiments, peuvent pourtant
se blesser rťciproquement dans la maniŤre de les exprimer, je dirai
presque de les concevoir. Cette pensťe me vient du souvenir d'un dÓner
que je fis chez une de mes anciennes amies, lady Dunmore, en trŤs
petit comitť. On s'y entretint de la nouvelle du jour, la condamnation
de lord Bective par la cour ecclťsiastique de Doctors Commons. Voici ŗ
quelle occasion:
Lady George Beresford ťtait, l'annťe prťcťdente, une des plus
charmantes, des plus distinguťes, des plus heureuses femmes de
Londres. ņ la suite d'une couche, le lait lui monta ŗ la tÍte et elle
devint folle. Son mari fut dťsespťrť. La nťcessitť de rechercher
quelques papiers d'affaires le forÁa ŗ ouvrir une cassette appartenant
ŗ sa femme; elle contenait une correspondance qui ne laissait aucun
doute sur le genre de son intimitť avec lord Bective. Le mari devint
furieux. Quoique la femme rest‚t folle et fŻt enfermťe, il entama une
procťdure contre elle. Des tťmoins, qui la traÓnŤrent dans la boue,
furent entendus; et lord Bective condamnť ŗ douze mille louis de
dommages envers lord George.
C'ťtait sur la quotitť de cette somme qu'on discutait ŗ la table oý
je me trouvais assise. Elle paraissait aux uns disproportionnťe au
mťrite de lady George; les autres ne la trouvaient qu'ťquivalente.
Elle ťtait si blanche, d'une si belle tournure, tant de talents, si
gracieuse!--Pas tant, et puis elle n'ťtait plus trŤs jeune.--Elle lui
avait donnť de si beaux enfants!--Sa santť s'altťrait, son teint se
g‚tait.--Elle avait tant d'esprit!--Elle devenait triste et assez
maussade depuis quelques mois.
La discussion se soutenait, avec un avantage ŗ peu prŤs ťgal, lorsque
la maÓtresse de la maison la termina en disant:
ęJe vous accorde que douze mille louis est une bien grosse somme, mais
le pauvre lord George l'aimait tant!Ľ
La force de cet argument parut irrťsistible et concilia toutes les
opinions. J'ťcoutais avec ťtonnement. Je me sentais froissťe
d'entendre des femmes de la plus haute volťe ťnumťrer et discuter les
mťrites d'une de leurs compagnes comme on aurait pu faire des qualitťs
d'un cheval et ensuite apprťcier en ťcus le chagrin que sa perte avait
dŻ causer ŗ son mari qui, dťjŗ, me paraissait odieux en poursuivant
devant les tribunaux la mŤre de ses enfants frappťe par la main de
Dieu de la plus grande calamitť ŗ laquelle un Ítre humain puisse Ítre
condamnť.
Faut-il conclure de lŗ que la haute sociťtť en Angleterre manque de
dťlicatesse! Cela serait aussi injuste que d'ťtablir que les femmes
franÁaises sont sans modestie parce qu'elles emploient quelques
locutions proscrites de l'autre cŰtť du canal. Ce qui est vrai, c'est
que les diffťrents usages prťsentent les objets sous d'autres faces,
et qu'il ne faut pas se h‚ter de juger les ťtrangers sans avoir fait
un profond examen de leurs moeurs. Quelle sociťtť ne prťsente pas des
anomalies choquantes pour l'observateur qui n'y est pas accoutumť?
J'admirais en thťorie le respect des anglais pour les hiťrarchies
sociales, et puis ma sociabilitť franÁaise s'irritait de les voir en
action dans les salons.
Les grandes dames ouvrent leurs portes une ou deux fois dans l'annťe ŗ
tout ce qui, par une relation quelconque mais surtout par celles qui
se rapportent aux ťlections, a l'honneur d'oser se faire ťcrire chez
elles en arrivant ŗ Londres. Cette visite se rend par l'envoi d'une
trŤs grande carte sur laquelle est imprimť: la duchesse *** _at home_,
tel jour, ŗ la date de plusieurs semaines. Le nom des personnes
auxquelles elle s'adresse est ťcrit derriŤre, ŗ la main. Dieu sait
quel mouvement on se donne pour en recevoir une, et toutes les
courses, toutes les manoeuvres, pour faire valoir ses droits ŗ en
obtenir.
Le jour arrivť, la maÓtresse de la maison se place debout ŗ la porte
de son salon; elle y fait la rťvťrence ŗ chaque personne qui entre;
mais quelle rťvťrence, comme elle leur dit: ęQuoique vous soyez chez
moi, vous comprenez bien que je ne vous connais pas et ne veux pas
vous connaÓtre!Ľ Cela est rendu encore plus marquť par l'accueil
diffťrent accordť aux personnes de la sociťtť fashionable.
Hť bien, dans ce pays de bons sens, personne ne s'en choque: chacun a
eu ce qu'il voulait: les familiers la bonne rťception, les autres la
joie de l'invitation. La carte a ťtť fichťe pendant un mois sur la
glace; elle y a ťtť vue par toutes les visites. On a la possibilitť de
dire dans sa sociťtť secondaire comment sont meublťs les salons de la
duchesse ***, la robe que portait la marquise ***, et autres remarques
de cette nature. Le but auquel ces invitťs prťtendent est atteint, et
peut-Ítre seraient-ils moins fiers d'Ítre admis chez la duchesse ***
si elle ťtait plus polie.
Chez nous, personne ne supporterait un pareil traitement. J'ai
quelquefois pensť que la supťrioritť de la sociťtť franÁaise sur
toutes les autres tenait ŗ ce que nous ťtablissons que la personne qui
reÁoit, celle qui fait les frais d'une soirťe ou d'un dÓner, est
l'obligťe des personnes qui s'y rendent et que, partout ailleurs,
c'est le contraire. Si on veut y rťflťchir, on trouvera, je crois,
combien cette seule diffťrence doit amener de facilitť dans le
commerce et d'urbanitť dans les formes.
Les immenses raouts anglais sont si peu en proportion avec la taille
des maisons qu'ordinairement le trop plein des salons s'ťtend dans
l'escalier et quelquefois jusque dans la rue oý les embarras de
voitures ajoutent encore ŗ l'ennui de ces rťunions. La libertť
anglaise (et lŗ je ne reconnais pas la haute judiciaire du pays)
n'admet pas qu'on ťtablisse aucun ordre dans les files. C'est ŗ coup
de timon et en lanÁant les chevaux les uns contre les autres qu'on
arrive, ou plutŰt qu'on n'arrive pas. Il n'y a pas de soirťe un peu ŗ
lŗ mode oý il ne reste deux ou trois voitures brisťes sur le pavť.
Cela ťtonne encore plus ŗ Londres oý elles sont si belles et si
soignťes.
Les raouts ont exaltť le sentiment que je portais dťjŗ ŗ nos bons et
utiles gendarmes; mon amour pour la libertť a toujours flťchi devant
eux. Je me rappelle entre autre les avoir appelťs de tous mes voeux un
soir oý nous fŻmes sept quarts d'heure en perdition, prÍts ŗ Ítre
broyťs en cannelle ŗ chaque instant, pour arriver chez lady Hertford.
Nous partions de Portman square; elle demeurait dans Manchester
square: il y a bien pour une minute de chemin, lorsqu'il est libre.
Pour ťviter au prince rťgent l'ennui de ces embarras; il arrivait dans
le salon de la marquise en traversant un petit jardin et par la
fenÍtre. C'ťtait fort simple assurťment, mais, quand cette fenÍtre
s'ťlevait ŗ grand bruit pour le laisser entrer, un sourire
involontaire passait sur toutes les figures.
En outre de la fatigue de ces assemblťes, ce qui les rend odieuses aux
ťtrangers c'est l'heure oý elles commencent. J'en avais perdu le
souvenir. Engagťe ŗ un bal le lendemain du raout de lady Hertford,
j'avais vu sonner minuit sans que ma mŤre songe‚t ŗ partir. Je la
pressai de s'y dťcider.
ęVous le voulez, j'y consens, mais nous gÍnerons.Ľ
Pour cette fois, nous ne trouv‚mes pas de file; nous ťtions les
premiŤres, les salons n'ťtaient pas achevťs d'ťclairer. La maÓtresse
de la maison entra tirant ses gants; sa fille n'eut achevť sa toilette
qu'une demi-heure plus tard, et la foule ne commenÁa ŗ arriver qu'ŗ
prŤs d'une heure du matin.
Je me suis laissť raconter que beaucoup de femmes se couchent entre
leur dÓner et l'heure oý elles vont dans le monde pour Ítre plus
fraÓches. Je crois que c'est un conte, mais certainement beaucoup
s'endorment par ennui.
Pendant que je suis sur l'article des bals, il me faut parler d'un
trŤs beau et trŤs bizarre par la situation des gens qui le donnaient.
Le marquis d'Anglesey, aprŤs avoir ťtť mariť vingt et un ans ŗ une
Villiers et en avoir eu une multitude d'enfants, avait divorcť en
…cosse oý la loi admet les infidťlitťs du mari comme cause suffisante.
Il venait d'ťpouser lady …milie Wellesley qui, divorcťe pour son
compte en Angleterre, laissait aussi une quantitť d'enfants ŗ un
premier mari.
La marquise d'Anglesey avait, de son cŰtť, ťpousť le duc d'Argyll.
Elle n'ťtait pas dans la catťgorie des femmes divorcťes et continuait
ŗ Ítre admise chez la Reine et dans le monde. Toutefois ce second
mariage avait ťtť si prompt qu'on tenait qu'elle ťtait, tout au moins,
d'accord avec lord d'Anglesey pour amener leur divorce. Plusieurs
filles (les ladys Paget) de dix-huit ŗ vingt-deux ans rťsidaient chez
leur pŤre, mais allaient dans le monde menťes par la duchesse.
Lord d'Anglesey avait eu la jambe emportťe ŗ la bataille de Waterloo.
Son ťtat trŤs alarmant pendant longtemps avait excitť un vif intťrÍt
dans la sociťtť; il en avait reÁu des preuves soutenues. Pour
tťmoigner de sa reconnaissance, il imagina de donner une grande fÍte ŗ
ses nombreux amis ŗ l'occasion de son rťtablissement.
On construisit une salle de bal ŗ la suite des beaux appartements
d'Uxbridge House, et tous les prťparatifs furent faits par le marquis
et la nouvelle lady d'Anglesey sur le pied de la plus grande
magnificence. Les billets, dans une forme trŤs inusitťe, n'ťtaient au
nom de personne. Lord d'Anglesey, en adressant ses remerciements ŗ
monsieur et madame un tel de leurs soins obligeants, espťraient qu'ils
viendraient passer la soirťe du ... ŗ Uxbridge House.
Un moment avant l'arrivťe de la sociťtť, lady d'Anglesey, femme
divorcťe qu'on ne voyait pas, aprŤs avoir veillť ŗ tous les
arrangements, partit pour la campagne. Lord d'Anglesey, trop tendre et
trop galant pour laisser son ťpouse dans la solitude, l'accompagna. De
sorte qu'il n'y avait plus ni maÓtre, ni maÓtresse de maison lŗ oý se
donnait cette grande fÍte. Les filles de la premiŤre femme en
faisaient les honneurs et, par courtoisie, elles s'ťtaient associť
mesdemoiselles Wellesley, filles de la seconde par son premier mari
avec lequel elles demeuraient.
Il faut avouer qu'on ne pouvait guŤre concevoir une idťe plus ťtrange
que celle d'appeler le public chez soi dans de pareils prťdicaments.
Ce bal fut illustrť par une autre singularitť. Lady Caroline Lamb
avait fait paraÓtre quelques jours avant le roman de _Glenarvon_.
C'ťtait le rťcit de ses aventures avec le fameux lord Byron, aventures
poussťes le plus loin possible. Elle avait fait entrer dans le cadre
de son roman tous les personnages marquants de la sociťtť et surtout
les membres de sa propre famille, y compris son mari William Lamb
(devenu depuis lord Melbourne).
ņ la vťritť, elle lui accordait un trŤs beau caractŤre et une fort
noble conduite; elle avait ťtť moins bťnťvole pour beaucoup d'autres,
et, comme les noms ťtaient supposťs, on se disputait encore sur les
personnes qu'elle avait prťtendu peindre.
ņ ce bal d'Uxbridge House, je l'ai vue, pendue amoureusement au bras
de son mari et distribuant la _clef_, comme elle disait, de ses
personnages fort libťralement. Elle avait eu le soin d'en faire faire
de nombreuses copies oý le nom supposť et le nom vťritable ťtaient en
regard, et c'ťtaient ceux de gens prťsents ou de leurs parents et
amis. Cette scŤne complťtait la bizarrerie de cette singuliŤre soirťe.
Je renonÁai bien vite ŗ mener la vie de Londres; en outre qu'elle
m'ennuyait, j'ťtais souffrante. J'avais rapportť de GÍnes une douleur
rhumatismale dans la tÍte qui n'a cťdť que quatre ans aprŤs, ŗ l'effet
des eaux d'Aix, et qui me rendait incapable de prendre part aux
plaisirs bruyants.
Aussi n'ťprouvai-je aucun regret de ne point assister aux fÍtes
donnťes en France pour le mariage de monsieur le duc de Berry. Les
rťcits qui nous en arrivaient les reprťsentaient comme ayant ťtť aussi
magnifiques que le permettait la dťtresse gťnťrale du royaume. Elles
avaient ťtť plus animťes qu'on ne devait s'y attendre dans de si
pťnibles circonstances. La plupart de ceux appelťs ŗ y figurer
appartenaient ŗ une classe de personnes qui regardent la Cour comme
nťcessaire au complťment de leur existence. Quand une circonstance
quelconque de disgr‚ce ou de politique les tire de cette atmosphŤre,
il manque quelque chose ŗ leur vie. Un grand nombre d'entre elles
avaient ťtť privťes d'assister ŗ des fÍtes de Cour par les ťvťnements
de la Rťvolution; elles y portaient un entrain de dťbutantes et un
zŤle de nťophytes qui simulaient au moins la gaietť si elle n'ťtait
pas complŤtement de bon aloi.
Je ne sais jusqu'ŗ quel point le public s'identifia ŗ ces joies;
j'ťtais absente et les rapports furent contradictoires. De tous les
rťcits, il n'est restť dans ma mťmoire qu'un mot du prince de Poix. Le
jour de l'entrevue ŗ Fontainebleau, le duc de Maillť, s'adressant ŗ un
groupe de courtisans qui, comme lui, sortaient des appartements, leur
dit:
ęSavez-vous, messieurs, que notre nouvelle princesse a un oeil plus
petit que l'autre.
--Je n'ai pas du tout vu celaĽ, reprit vivement le prince de Poix.
Mais aprŤs avoir rťflťchi, il ajouta:
ęPeut-Ítre madame la duchesse de Berry a-t-elle l'oeil gauche un peu
plus grand.Ľ
Cette rťponse est trop classique en son genre pour nťgliger de la
rapporter.
Je reviens ŗ Londres. Je ne sortais guŤre de l'intťrieur de
l'ambassade, oý nous avions fini par attirer quelques habituťs, que
pour aller chez les collŤgues du corps diplomatique, chez les
ministres et ŗ la Cour dont je ne pouvais me dispenser.
CHAPITRE IV
La famille d'Orlťans ŗ Twickenham. -- Espionnage exercť contre
elle. -- Division entre le roi Louis XVIII et monsieur le duc
d'Orlťans ŗ Lille en 1815. -- Intťrieur de Twickenham. -- Mots de
la princesse Marie. -- La comtesse de Vťrac. -- Naissance d'une
princesse d'Orlťans. -- La comtesse Mťlanie de Montjoie. -- Le
baron de Montmorency. -- Le comte Camille de Sainte-Aldegonde. --
Le baron Athalin. -- Monsieur le duc de Bourbon. -- La princesse
Louise de Condť.
Je ne mets pas au rang des devoirs, car ce m'ťtait un plaisir, de
frťquentes visites ŗ Twickenham. Monsieur le duc d'Orlťans y ťtait
retirť avec les siens; il y menait une vie simple, exclusivement de
famille.
Avant l'arrivťe de mon pŤre, la sottise courtisane de monsieur de La
Ch‚tre l'avait entourť d'espions ŗ gages qui empoisonnaient ses
actions les plus innocentes et le tourmentaient de toutes faÁons. Mon
pŤre mit un terme ŗ ces ignobles tracasseries et les exilťs de
Twickenham lui en surent grť, d'autant qu'en montrant leur conduite
telle qu'elle ťtait en effet, il leur ouvrait les portes de la France
oý ils aspiraient ŗ rentrer.
Un des agents rťtribuťs par la police franÁaise vint dire ŗ mon pŤre,
un beau matin, que monsieur le duc d'Orlťans se dťmasquait enfin. Des
proclamations factieuses s'imprimaient clandestinement ŗ Twickenham et
des ballots allaient s'expťdier sur les cŰtes de France. Le rťvťlateur
assurait pouvoir s'en procurer.
ęHť bien, lui dit mon pŤre, apportez-moi, je ne dis pas seulement une
proclamation, mais une publication bien moins grave, sortie d'une
presse ťtablie ŗ Twickenham et je vous compte cent guinťes
sur-le-champ.Ľ Il attendit vainement.
Le dimanche suivant, allant faire une visite le soir ŗ madame la
duchesse d'Orlťans, nous trouv‚mes toute la famille autour d'une
table, composant une page d'impression. On avait achetť, pour divertir
les enfants, une petite imprimerie portative, un vťritable joujou, et
on les en amusait le dimanche. Dťjŗ on avait tirť quelques exemplaires
d'une fable d'une vingtaine de vers, faite par monsieur le duc de
Montpensier dans son enfance; c'ťtait le travail d'un mois: et voilŗ
la presse clandestine destinťe ŗ bouleverser le monde!
Ces niaises persťcutions ne servaient qu'ŗ irriter monsieur le duc
d'Orlťans. Louis XVIII l'a constamment abreuvť de dťgoŻts, en France
et ŗ l'ťtranger. La rencontre ŗ Lille, oý le dissentiment sur la
conduite ŗ tenir fut si public, avait achevť de fomenter leur mutuelle
intimitť.
ņ la premiŤre nouvelle du dťbarquement de l'Empereur ŗ Cannes,
monsieur le duc d'Orlťans avait accompagnť Monsieur ŗ Lyon. Revenu ŗ
Paris avec ce prince, il ťtait reparti seul pour Lille oý il avait
prťparť, avec le marťchal Mortier, la dťfense de la place. Quand le
Roi y fut arrivť, il l'engagea ŗ y ťtablir le siŤge de son
gouvernement. Le Roi, aprŤs quelque hťsitation, le promit; il donna
parole tout au moins de ne point abandonner le sol franÁais. Ce furent
ses derniers mots ŗ monsieur le duc d'Orlťans lorsque celui-ci se
retira dans l'appartement qu'il occupait. Trois heures aprŤs, on vint
le rťveiller pour lui apprendre que le Roi ťtait parti et prenait la
route de Belgique; les ordres ťtaient dťjŗ donnťs lorsqu'il assurait
vouloir rester en France. Monsieur le duc d'Orlťans, courroucť de ce
secret gardť envers lui, ťcrivit au Roi pour se plaindre amŤrement, au
marťchal Mortier pour le dťgager de toutes ses promesses et, renonÁant
ŗ suivre le Roi, s'embarqua pour rejoindre sa famille en Angleterre.
Il loua une maison ŗ Twickenham, village qu'il avait dťjŗ habitť lors
de la premiŤre ťmigration.
AussitŰt que la famille d'Orlťans se fut bien persuadťe que le
successeur de monsieur de La Ch‚tre ne suivrait pas ses errements et
qu'elle n'avait aucune tracasserie ŗ craindre de mon pŤre, la
confiance la plus loyale s'ťtablit et monsieur le duc d'Orlťans ne fit
aucune dťmarche que d'accord avec lui. Il poussa la dťfťrence envers
le gouvernement du Roi jusqu'ŗ ne recevoir personne ŗ Twickenham sans
en donner avis ŗ l'ambassadeur et toutes ses dťmarches en France
furent combinťes avec lui.
L'espionnage tomba de lui-mÍme. Monsieur Decazes rappela les agents
que monsieur de La Ch‚tre lui avait reprťsentťs comme nťcessaires; et,
puisque je dis tout, peut-Ítre la crainte de voir retirer les fonds
secrets qu'il recevait pour ce service rendait-elle l'ambassadeur plus
mťticuleux.
Mademoiselle fut la derniŤre ramenťe ŗ la confiance, mais aussi elle
le fut complŤtement et ŗ jamais. C'est pendant ces longues journťes de
campagne que j'ai eu occasion d'apprťcier la distinction de son esprit
et la franchise de son caractŤre. Mon tendre dťvouement pour son
auguste belle-soeur se dťveloppait chaque jour de plus en plus.
La conversation de monsieur le duc d'Orlťans n'a peut-Ítre jamais ťtť
plus brillante qu'ŗ cette ťpoque. Il avait passť l'‚ge oý une
ťrudition aussi profonde et aussi variťe paraissait un peu entachťe de
pťdantisme. L'impartialitť de son esprit lui faisait comprendre
toutes les situations et en parler avec la plus noble modťration. Son
bonheur intťrieur calmait ce que sa position politique pouvait avoir
d'irritant, et, au fond, je ne l'ai jamais vu autant ŗ son avantage,
ni peut-Ítre aussi content, que dans le petit salon de Twickenham,
aprŤs d'assez mauvais dÓners que nous partagions souvent.
De leur cŰtť, les princes habitants de Twickenham n'avaient point
d'autre pied-ŗ-terre ŗ Londres que l'ambassade dans les courses assez
rares qu'ils y faisaient.
Monsieur le duc de Chartres, quoique bien jeune, ťtait dťjŗ un bon
ťcolier, mais n'annonÁait ni l'esprit, ni la charmante figure que nous
lui avons vus. Il ťtait dťlicat et un peu ťtiolť comme un enfant nť
dans le Midi. Ses soeurs avaient ťchappť ŗ cette influence du soleil
de Palerme.
L'aÓnťe, distinguťe dŤs le berceau par l'ťpithŤte de la _bonne
Louise_, a constamment justifiť ce titre en marchant sur les traces de
son admirable mŤre: elle ťtait fraÓche, couleur de rose et blanc, avec
une profusion de cheveux blonds. La seconde, trŤs brune et plus
mutine, ťtait le plus dťlicieux enfant que j'aie jamais rencontrť:
_Marie_ n'ťtait pas si parfaite que _Louise_, mais ses sottises
ťtaient si intelligentes et ses reparties si spirituelles qu'on avait
presque l'injustice de leur accorder la prťfťrence.
Ma mŤre en raffolait. Un jour oý elle avait ťtť _bien mauvaise_,
madame la duchesse d'Orlťans la fit gronder par elle. La petite
princesse fut dťsolťe. ņ notre prochaine visite madame de Vťrac, dame
d'honneur de madame la duchesse d'Orlťans, dit ŗ ma mŤre:
ęVous n'avez que des compliments ŗ faire aujourd'hui, madame d'Osmond;
la princesse Marie a ťtť sage toute la semaine. Elle a appris ŗ faire
la rťvťrence, voyez comme elle la fait bien; elle a ťtť polie; elle a
bien pris ses leÁons, enfin madame la duchesse d'Orlťans va vous dire
qu'elle en est trŤs contente.Ľ
Ma mŤre caressa le joyeux enfant; ses parents ťtaient ŗ la promenade;
un instant aprŤs nous vÓmes la petite princesse ŗ genoux ŗ cŰtť de
madame de Vťrac:
ęQue faites-vous lŗ, princesse Marie?
--Je vous fais de la reconnaissance, et puis au bon Dieu.Ľ
Qu'on me passe encore deux histoires de la princesse Marie. L'annťe
suivante, on donnait sur le thť‚tre de Drury Lane une de ces
arlequinades oý les anglais excellent; tous les enfants de la famille
d'Orlťans devaient y assister aprŤs avoir passť la journťe ŗ
l'ambassade. On arriva un peu trop tŰt; le dernier acte d'une tragťdie
oý jouait mademoiselle O'Neil n'ťtait pas achevť. Au bout de quelques
minutes, la princesse Marie se retourna ŗ sa gouvernante:
ęDonnez-moi mon mouchoir, madame Mallet. Je ne suis pas mťchante je
vous assure, mais mes yeux pleurent malgrť moi; cette dame a la voix
si malheureuse!Ľ
Plus tard, lorsqu'elle avait prŤs de six ans, je me trouvai un soir au
Palais-Royal; la princesse Marie s'amusait ŗ ťlever des fortifications
avec des petits morceaux de bois taillťs ŗ cet effet, et recevait les
critiques d'un gťnťral dont elle avait sollicitť le suffrage. Elle
releva son joli visage et avec sa petite mine si piquante, lui dit:
ęAh! sans doute, gťnťral, ce n'est pas du Vauban.Ľ
Monsieur le duc de Nemours, ou plutŰt _Moumours_, comme il commenÁait
ŗ s'appeler lui-mÍme, ťtait beau comme le jour.
Madame la duchesse d'Orlťans ťtait accouchťe ŗ Twickenham d'une
petite princesse qu'elle nommait _la fille de monsieur d'Osmond_,
parce que mon pŤre avait ťtť appelť ŗ constater son ťtat civil. Ce
maillot complťtait la famille.
Tout le monde dans l'intťrieur s'entendait pour que ces enfants
reÁussent dŤs le berceau la meilleure ťducation qu'il fŻt possible
d'imaginer; je n'en ai jamais connu de plus soignťs et de moins g‚tťs.
Le reste des habitants se composait ainsi: La comtesse de Vťrac, nťe
Vintimille, dame d'honneur de madame la duchesse d'Orlťans dŤs
Palerme, excellente personne, dťvouťe ŗ sa princesse et dont la mort a
ťtť une perte rťelle pour le Palais-Royal; madame de Montjoie, aussi
distinguťe par les qualitťs du coeur que par celles de l'esprit, ťtait
attachťe ŗ Mademoiselle depuis leur premiŤre jeunesse ŗ toutes deux et
identifiťe de telle faÁon qu'elle n'a ni autre famille ni autres
intťrÍts. Raoul de Montmorency et Camille de Sainte-Aldegonde, aides
de camp de monsieur le duc d'Orlťans, se partageant entre la France et
Twickenham.
Monsieur Athalin y rťsidait ŗ poste fixe. Avant 1814, il ťtait
officier d'ordonnance de l'Empereur. Monsieur le duc d'Orlťans,
suivant son systŤme d'amalgame, l'avait pris pour aide camp avec
l'agrťment du Roi; mais, en 1815, il ťtait retournť prŤs de son ancien
chef en ťcrivant au prince une lettre fort convenable. Les Cent-Jours
terminťs, monsieur le duc d'Orlťans rťpondit ŗ cette lettre en
l'engageant ŗ venir le rejoindre. Monsieur Athalin profita de cette
indulgence. Elle fut trŤs mal vue ŗ la Cour des Tuileries, mais elle a
fondť le dťvouement sans bornes qu'il porte ŗ ses nobles protecteurs.
La gouvernante des princesses et l'instituteur de monsieur le duc de
Chartres, monsieur du Parc, homme de mťrite, complťtaient les
commensaux de cet heureux intťrieur. On y menait la vie la plus calme
et la plus rationnelle. Si on y conspirait, c'ťtait assurťment ŗ bien
petit bruit et d'une faÁon qui ťchappait mÍme ŗ l'activitť de la
malveillance.
Je voudrais pouvoir parler en termes ťgalement honorables du pauvre
duc de Bourbon; mais, si toutes les vertus familiales semblaient avoir
ťlu domicile ŗ Twickenham, toutes les inconvenances habitaient avec
lui dans une mauvaise ruelle de Londres oý il avait pris un
appartement misťrable. Un seul domestique l'y servait; il n'avait pas
de voiture.
Mon pŤre ťtait chargť de le faire renoncer ŗ cette maniŤre de vivre,
mais il ne put y rťussir. AprŤs sa triste apparition dans la Vendťe,
il s'ťtait embarquť et ťtait arrivť ŗ Londres pendant les Cent-Jours.
Monsieur le prince de Condť le rappelait auprŤs de lui et mettait ŗ sa
disposition toutes les sommes dont il pouvait avoir besoin; mais lui
persistait ŗ continuer la mÍme existence. Il dÓnait dans une boutique
de cŰtelettes, _Chop house_, car cela ne mťrite pas le nom de
restaurateur, se rendait alternativement ŗ un des thť‚tres, attendait
en se promenant sous les portiques que l'heure du demi-prix fŻt
arrivťe, entrait dans la salle et en ressortait ŗ la fin du spectacle
avec une ou deux mauvaises filles qui variaient tous les jours et
qu'il menait souper dans quelque tabagie, alliant ainsi les dťsordres
grossiers avec ses goŻts parcimonieux. Quelquefois, lord William
Gordon ťtait de ces parties, mais plus souvent il allait seul: C'ťtait
pour jouir de cette honorable vie qu'il s'obstinait ŗ rester en
Angleterre, et toutes les supplications ne purent le dťcider ŗ partir
ŗ temps pour recevoir le dernier soupir de son pŤre.
Par d'autres motifs, la princesse sa soeur refusait aussi de rentrer
en France; c'ťtait ŗ cause de sa haine pour le Concordat. J'avais une
grande vťnťration spťculative pour cette jeune Louise de Condť,
pleurant au pied des autels les crimes de son pays et offrant en
sacrifice un si pur holocauste pour les expier.
Je m'en ťtais fait un roman; mais il fallait ťviter d'en apercevoir
l'hťroÔne, commune, vulgaire, ignorante, banale dans ses pensťes, dans
ses sentiments, dans ses actions, dans ses paroles, dans sa personne.
On ťtait tentť de plaindre le bon Dieu d'Ítre si constamment importunť
par elle; elle l'appelait en aide dans toutes les circonstances les
plus futiles de sa puťrile existence. Je lui ai vu dire oraison pour
retrouver un peloton de laine tombť sous sa chaise: c'ťtait la
caricature d'une religieuse de comťdie. Mon pŤre fut obligť de lui
faire presque violence pour la dťcider ŗ partir.
CHAPITRE V
Lord Castlereagh. -- Lady Castlereagh. -- Cray Farm. --
Dťvouement de lady Castlereagh pour son mari. -- Accident et
prudence. -- Soupers de lady Castlereagh. -- Partie de campagne
chez lady Liverpool. -- Ma toilette ŗ la Cour de la Reine. --
Beautť de cette assemblťe. -- BaptÍme de la petite princesse
d'Orlťans. -- La princesse de Talleyrand. -- Elle consent ŗ se
sťparer du prince de Talleyrand. -- La comtesse de Pťrigord. --
La duchesse de Courlande. -- La princesse Tyszkiewicz. -- Mariage
de Jules de Polignac.
J'ai dťjŗ dit que je n'avais eu aucune connaissance dťtaillťe des
affaires par mon pŤre. Je n'en ai su que ce qui est assez public pour
qu'il n'y ait point d'intťrÍt ŗ le raconter. Chaque semaine, il
recevait deux courriers de Paris toujours chargťs d'une longue lettre
particuliŤre du duc de Richelieu. Il lui rťpondait aussi directement,
de sorte que les bureaux et la lťgation n'ťtaient pas initiťs au fond
de ces nťgociations dont le but, pourtant, ťtait patent pour tout le
monde. Il s'agissait d'obtenir quelque soulagement ŗ l'oppression de
notre pauvre patrie. Le coeur du ministre et de l'ambassadeur
battaient ŗ l'unisson; leur vie entiŤre y ťtait consacrťe.
Lord Castlereagh ťtait un homme d'affaires avec de l'esprit, de la
capacitť, du talent mÍme, mais sans haute distinction. Il connaissait
parfaitement les hommes et les choses de son pays; il s'en occupait
depuis l'‚ge de vingt ans; mais il ťtait parfaitement ignorant des
intťrÍts et des rapports des puissances continentales.
Lorsqu'ŗ la fin de 1813 une mission, confiťe ŗ Pozzo, l'attira au
quartier gťnťral des souverains alliťs, il savait seulement que le
blocus minait l'Angleterre, qu'il fallait abattre la puissance en
position de concevoir une pareille idťe, ou du moins la mettre hors
d'ťtat de la rťaliser, et que l'Autriche devait Ítre l'alliťe
naturelle de l'Angleterre. Il n'en fallait pas davantage pour le
livrer ŗ l'habiletť du prince de Metternich. Lord Castlereagh est une
des premiŤres mťdiocritťs puissantes sur laquelle il ait exercť sa
complŤte domination.
Toujours et en tout temps les affaires anglaises se font exclusivement
par les anglais et ŗ Londres; mais, pour tout ce qui tenait ŗ la
politique extťrieure, Downing Street se trouvait sous la surveillance
de la chancellerie de Vienne; et je crois que cette situation s'est
prolongťe autant que la vie de lord Castlereagh.
Lorsque je l'ai connu, il ne donnait aucun signe de la fatale maladie
hťrťditaire qui l'a portť au suicide. Il ťtait, au contraire,
uniformťment calme et doux, discutant trŤs bien les intťrÍts anglais,
mais sans passion et toujours parfaitement _gentlemanlike_. Il parlait
assez mal franÁais; une de ses phrases habituelles dans les
confťrences ťtait: ęMon cher ambassadeur, il faut terminer cela ŗ
_l'aimable_Ľ; mais, si le mot ťtait peu exact, le sentiment qui
l'inspirait se montrait sincŤre.
Lord Castlereagh avait une grande considťration pour le caractŤre
loyal du duc de Richelieu, et la confiance qu'il inspirait a, partout,
facilitť les nťgociations dans ces temps de nťfaste mťmoire.
J'avais connu lady Castlereagh assez belle: devenue trŤs forte et trŤs
grasse, elle avait perdu toute distinction en conservant de beaux
traits. Elle avait peu d'esprit mais beaucoup de bienveillance, et une
politesse un peu banale sans aucun usage du monde.
Au congrŤs de Vienne, elle avait inventť de se coiffer avec les ordres
en diamants de son mari et avait placť la jarretiŤre en bandeau sur
son front. Le ridicule de cette exhibition l'avait empÍchťe de la
renouveler, et les boÓtes, que les traitťs faisaient abonder de toutes
parts, fournissaient suffisamment ŗ son goŻt trŤs vif pour la parure
et les bijoux. Toutefois, il ťtait dominť par celui de la campagne,
des fleurs, des oiseaux, des chiens et des animaux de toute espŤce.
Elle n'ťtait jamais si heureuse qu'ŗ Cray oý lord Castlereagh avait
une vťritable maison de curť. On descendait de voiture ŗ une petite
barriŤre qui, ŗ travers deux plates-bandes de fleurs communes, donnait
accŤs ŗ une maison composťe de trois piŤces. L'une servait de salon et
de cabinet de travail au ministre, l'autre de salle ŗ manger, la plus
petite de cabinet de toilette. Au premier, il y avait trois chambres ŗ
coucher: l'une appartenait au mťnage Castlereagh, les deux autres se
donnaient aux amis parmi lesquels on comptait quelques ambassadeurs.
Mon pŤre a ťtť plusieurs fois ŗ demeure, pendant quelques jours, ŗ
Cray farm; il m'a dit que l'ťtablissement n'ťtait guŤre plus
magnifique que le local.
Lady Castlereagh avait le bon goŻt d'y renoncer ŗ ses atours. On l'y
trouvait en robe de mousseline, un grand chapeau de paille sur la
tÍte, un tablier devant elle et des ciseaux ŗ la main ťmondant ses
fleurs. DerriŤre cette maison, dont l'entrťe ťtait si prodigieusement
mesquine mais qui ťtait situťe dans un charmant pays et jouissait
d'une vue magnifique, il y avait un assez grand enclos, des plantes
rares, une mťnagerie et un chenil qui partageaient, avec les serres,
les sollicitudes de lady Castlereagh.
Jamais elle ne s'ťloignait de son mari. Elle ťtait prŤs de son bureau
pendant qu'il travaillait. Elle le suivait ŗ la ville, ŗ la campagne;
elle l'accompagnait dans tous ses voyages; mais aussi jamais elle ne
paraissait dťrangťe ni contrariťe de quoi que ce fŻt. Elle passait les
nuits, supportait le froid, la faim, la fatigue, les mauvais gÓtes
sans se plaindre et sans mÍme avoir l'air d'en souffrir. Enfin elle
s'arrangeait pour Ítre le moins incommode possible dans la prťsence
rťelle qu'elle semblait lui imposer. Je dis semblait, parce que les
plus intimes croyaient qu'en cela elle suivait sa propre volontť plus
que celle de lord Castlereagh. Jamais, pourtant, il ne faisait la
moindre objection.
Avait-elle dťcouvert quelque signe de cette maladie, qu'une si
affreuse catastrophe a rťvťlťe au monde, et voulait-elle Ítre prťsente
pour en surveiller les occasions et en attťnuer les effets? Je l'ai
quelquefois pensť depuis. Ce serait une explication bien honorable de
cette prťsence persťvťrante qui paraissait quelquefois un peu ridicule
et dont nous nous moquions dans le temps. Quoi qu'il en soit, jamais
lady Castlereagh ne permettait ŗ son mari une sťparation d'une heure,
et cependant on ne l'a point accusťe de chercher ŗ exercer une
influence politique. J'ai ťtť tťmoin d'une occasion oý elle montra
beaucoup de caractŤre.
Parmi tous ses chiens, elle possťdait un _bull-dog_. Il se jeta un
jour sur un petit ťpagneul qu'il s'apprÍtait ŗ ťtrangler lorsque lord
Castlereagh interposa sa mťdiation. Il fut cruellement mordu ŗ la
jambe et surtout ŗ la main. Il fallut du secours pour faire l‚cher
prise au _bull-dog_ qui ťcumait de colŤre. Lady Castlereagh survint;
son premier soin fut de caresser le chien, de le calmer. Les bruits de
rage ne tardŤrent pas ŗ circuler; elle n'eut jamais l'air de les avoir
entendus. Le _bull-dog_ ne quittait pas la chambre oý lord Castlereagh
ťtait horriblement souffrant de douleurs qui attaquŤrent ses nerfs.
Les indiffťrents s'indignaient des caresses que lady Castlereagh
prodiguait ŗ une si mťchante bÍte. Elle ne s'en inquiťtait nullement
et faisait vivre son mari familiŤrement avec cet ennemi domestique,
ťvitant ainsi toutes les inquiťtudes que l'imagination aurait pu lui
causer. Ce n'est qu'au bout de quatre mois, quand lord Castlereagh fut
complŤtement guťri, que, d'elle-mÍme, elle se dťbarrassa du chien que
jusque-lŗ elle avait comblť de soins et de caresses.
Lady Castlereagh n'ťtait pas une personne brillante, mais elle avait
un bon sens ťminent. ņ Londres, elle donnait ŗ souper le samedi aprŤs
l'opťra. Elle avait prťfťrť ce jour-lŗ parce qu'elle n'aimait pas ŗ
veiller et que, le rideau tombant ŗ minuit prťcis, pour que la
reprťsentation n'entam‚t pas sur la journťe du dimanche, on arrivait
plus tŰt chez elle qu'on n'aurait fait tout autre jour de la semaine;
ce qui, pour le dire en passant, donne l'idťe des heures tardives que
la mode imposait aux fashionables de Londres quoique tout le monde
s'en plaignÓt.
Ces soupers de lady Castlereagh, moins cohue que ses raouts, ťtaient
assez agrťables. Le corps diplomatique y ťtait admis de droit, ainsi
que les personnes du gouvernement; les autres ťtaient invitťes de vive
voix et pour chaque fois.
Au nombre des choses changťes, ou que j'avais oubliťes, pendant mon
absence, se trouvait le costume que les femmes portaient ŗ la
campagne. Je l'appris ŗ mes dťpens. J'avais ťtť assez liťe avec lady
Liverpool dans notre mutuelle jeunesse. Elle m'engagea ŗ venir dÓner ŗ
quelques milles de Londres oý lord Liverpool avait une maison fort
mťdiocre, quoique trŤs supťrieure au _Cray_ de son collŤgue
Castlereagh.
Elle me recommanda d'arriver de bonne heure pour me montrer son
jardin et faire une bonne journťe de campagne. J'y allai avec mon
pŤre. Des affaires le retinrent et nous n'arriv‚mes qu'ŗ cinq heures
et demie. Lady Liverpool nous gronda de notre retard puis nous promena
dans son jardin, ses serres, son potager, sa basse-cour, son
poulailler, son toit ŗ porcs, tout cela mťdiocrement soignť.
Lord Liverpool arriva de Londres; nous le laiss‚mes avec mon pŤre et
prÓmes le chemin de la maison. J'ťtais vÍtue, il m'en souvient d'une
redingote de gros de Tours blanc garnie de ruches tout autour; j'avais
un chapeau de paille de riz avec des fleurs, je me croyais trŤs belle.
En entrant dans la maison, lady Liverpool me dit:
ęVoulez-vous venir dans ma chambre pour Űter votre pelisse et votre
chapeau. Avez-vous amenť votre femme de chambre ou voulez-vous vous
servir de la mienne?Ľ
Je lui rťpondis un peu embarrassťe, que je n'avais pris aucune
prťcaution pour changer de toilette:
ęAh! cela ne fait rien du tout, reprit-elle, voilŗ un livre pendant
que je vais faire la mienne.Ľ
ņ peine j'ťtais seule que j'entendis arriver une voiture et bientŰt je
vis entrer lady Mulgrave, en robe de satin, coiffťe en cheveux avec
des bijoux et des plumes, puis parut miss Jenkinson, la niŤce de la
maison, avec une robe de crÍpe, des souliers blancs et une guirlande
de fleurs, puis enfin lady Liverpool elle-mÍme, vÍtue je ne sais
comment, mais portant sur sa tÍte un voile ŗ l'Iphigťnie retenu avec
un diadŤme d'or incrustť de pierreries. Je ne savais oý me fourrer. Je
crus qu'il s'agissait d'un grand dÓner diplomatique et que nous
allions voir arriver successivement toutes les ťlťgantes de Londres.
Nous nous mÓmes ŗ table huit personnes dont cinq ťtaient de la maison.
On n'attendait pas d'autres convives; mais c'est l'usage de
s'habiller, pour dÓner seul ŗ la campagne, comme on le serait pour
aller dans le grand monde. Je me le tins pour dit, et, depuis, je n'ai
plus commencť les _bonnes journťes de campagne_ avant sept heures et
demie, et vÍtue en costume de ville.
Pendant que je suis sur l'article toilette, il me faut raconter celle
avec laquelle j'allai ŗ la Cour. Peut-Ítre, dans vingt ans,
sera-t-elle aussi commune qu'elle me parut ťtrange lorsque je la
portai. CommenÁons par la tÍte.
Ma coiffure ťtait surmontťe du _panache_ de rigueur. J'avais obtenu ŗ
grand'peine du plumassier ŗ la mode, Carberry, qu'il ne fut composť
que de sept ťnormes plumes, c'ťtait le moins possible. Les _panaches_
modťrťs en avaient de douze ŗ quinze et quelques-uns jusqu'ŗ
vingt-cinq. Au-dessous du _panache_ (c'est le nom technique), je
portais une guirlande de roses blanches qui surmontait un bandeau de
perles. Des agrafes et un peigne de diamants, des barbes de blonde
achevaient la coiffure.
Ce mťlange de bijoux, de fleurs, de plumes, de blondes choquait fort ŗ
cette ťpoque notre goŻt restť classique depuis les costumes grecs.
Mais ce n'est encore rien.
Le buste ťtait ŗ peu prŤs arrangť comme ŗ l'ordinaire. Lorsque le
corsage fut ajustť, on me passa un ťnorme panier de trois aunes de
tour qui s'attachait ŗ la taille avec des aiguillettes. Ce panier
ťtait de toile gommťe, soutenue par des baleines, qui lui donnaient
une forme trŤs large devant et derriŤre et trŤs ťtroite des cŰtťs. Le
mien avait, sur une jupe de satin, une seconde jupe de tulle garnie
d'un grand falbala de dentelle d'argent. Une troisiŤme un peu moins
longue en tulle lamť d'argent, garnie d'une guirlande de fleurs, ťtait
relevťe en draperie, de sorte que la guirlande traversait en biais
tout le panier. Les ouvertures des poches ťtaient garnies de
dentelles d'argent et surmontťes d'un gros bouquet. J'en portais un
devant moi de faÁon que j'avais l'air de sortir d'une corbeille de
fleurs. Du reste, tous les bijoux possibles ŗ accumuler. Le bas de
robe de satin blanc bordť en argent ťtait retroussť en festons et
n'atteignait pas au bas de la jupe, c'ťtait l'ťtiquette. La Reine
seule le portait traÓnant, les princesses dťtachť mais ŗ peine
touchant terre.
Lorsque j'avais vu les immenses apprÍts de cette toilette, j'ťtais
restťe partagťe entre l'envie de rire de leur ťnormitť, qui me
paraissait bouffonne, et le chagrin de m'affubler si ridiculement. Je
dois avouer que, lorsqu'elle fut achevťe, je me trouvai assez ŗ mon
grť et que ce costume me sembla seyant.
Comme je suivais ma mŤre, je profitai des privilŤges diplomatiques; il
nous amenŤrent par des routes rťservťes au pied du grand escalier. On
y avait ťtabli tout du long une espŤce de palissade qui le sťparait en
deux. D'un cŰtť de cette balustrade, nous montions trŤs ŗ l'aise; de
l'autre, nous voyions les lords et les ladys s'ťcraser et s'ťtouffer
avec une violence dont les foules anglaises donnent seules l'exemple.
Je pensais, ŗ part moi, que cette distinction, en pleine vue,
dťplairait bien chez nous. Au haut de l'escalier, la sťparation se
refit plus discrŤte; les personnes ayant les entrťes passŤrent dans
une salle ŗ part. Elles furent admises les premiŤres dans le salon de
la Reine.
On lui avait fabriquť une espŤce de fauteuil oý, montťe sur un
marchepied et appuyťe sur des coussins, elle paraissait Ítre debout.
Avec son ťtrange figure, elle avait tout l'air d'une petite pagode de
Chine. Toutefois, elle tenait trŤs bien sa Cour. Les princesses,
suivant l'ordre de l'ťtiquette, ťtaient placťes de chaque cŰtť. En
l'absence de la princesse Charlotte qui aurait eu le premier rang, il
ťtait occupť par la duchesse d'York.
Le prince rťgent se tenait debout vis-ŗ-vis de la Reine, entourť de
ses frŤres et de sa maison. Il s'avanÁait pour parler aux femmes,
aprŤs qu'elles avaient passť devant la Reine.
Les ambassadrices avaient ou _prenaient_ (car on accusait la comtesse
de Lieven d'une usurpation) le droit de se mettre ŗ la suite des
princesses, aprŤs avoir fait leur cour et d'assister au reste de la
rťception. Je fus charmťe de profiter de cet usage pour voir bien ŗ
mon aise dťfiler toute cette riche et brillante procession. Comme ŗ
cette ťpoque de la vie de la Reine la Cour n'avait lieu qu'une ou deux
fois par an, la foule ťtait considťrable et les prťsentations trŤs
nombreuses.
Nulle part la beautť des anglaises n'ťtait plus ŗ son avantage. Le
plein jour de deux immenses fenÍtres, devant lesquelles elles
stationnaient, faisait valoir leur teint animť par la chaleur et un
peu d'ťmotion. Les jeunes filles de dix-huit ans joignaient ŗ l'ťclat
de leur ‚ge la timiditť d'un premier dťbut qui n'est pas encore de la
gaucherie, et les mŤres, en grand nombre, conservaient une fraÓcheur
que le climat d'Angleterre entretient plus longuement qu'aucun autre.
ņ la vťritť, quand elles s'avisent d'Ítre laides, elles s'en
acquittent dans une perfection inimitable. Il y avait des caricatures
ťtranges; mais, en masse, je n'ai jamais vu une plus belle assemblťe.
Ce costume insolite, en laissant aux femmes tous leurs avantages, les
dispensait de la gr‚ce dont, pour la plupart, elles sont dťpourvues,
de sorte que, loin d'y perdre, elles y gagnaient de tout point.
L'usage des paniers a cessť depuis la mort de la vieille reine
Charlotte. On a adoptť le costume de la Cour de France pendant la
Restauration.
J'avais ťtť prťsentťe lors de mon mariage, mais c'ťtait dans un autre
local et avec des formes diffťrentes. D'ailleurs, j'ťtais dans ce
temps-lŗ plus occupťe de moi-mÍme que de remarquer les autres et j'en
conserve un trŤs faible souvenir. Au lieu que la matinťe que je
passai, en 1816, ŗ Buckingham House m'amusa extrÍmement.
Le baptÍme de la petite princesse d'Orlťans donna lieu ŗ Twickenham ŗ
une fÍte telle que le permettait un pareil local. L'empereur
d'Autriche, reprťsentť par son ambassadeur, le prince Paul Esterhazy,
ťtait parrain. Il y eut un grand dťjeuner oý assistŤrent le prince
rťgent, le duc et la duchesse d'York, les ducs de Kent et de
Glocester. La vieille Reine et les princesses y vinrent, de Frogmore,
faire une visite.
Je m'ťtais flattťe d'y voir la princesse Charlotte, mais le prince
Lťopold arriva seul, chargť de ses excuses; un gros rhume servit de
prťtexte. Le vťritable motif ťtait sa rťpugnance ŗ se trouver avec sa
grand'mŤre et ses tantes. Elle l'avoua plus tard ŗ madame la duchesse
d'Orlťans. Elle l'aimait beaucoup et venait souvent faire des courses
ŗ Twickenham, mais je ne l'y ai jamais rencontrťe.
On comprend que la journťe du baptÍme fut lourde et fatigante. _Ce
diable chargť de princes_, dans une modeste maison bourgeoise, se
portait sur les ťpaules de tout le monde. On fit un grand soupir de
soulagement quand la derniŤre voiture emporta la derniŤre Altesse
Royale et la derniŤre Excellence et que, selon l'expression obligeante
de madame la duchesse d'Orlťans, nous nous retrouv‚mes en famille.
En outre des affaires de l'…tat, mon pŤre ťtait encore chargť d'une
autre nťgociation. Le prince de Talleyrand l'avait priť de faire ce
qu'il appelait _entendre raison_ ŗ sa femme. Elle s'ťtait rťfugiťe en
Angleterre pendant les Cent-Jours et, depuis, il l'y retenait sous
divers prťtextes. Le fait ťtait que monsieur de Talleyrand, amoureux
comme un homme de dix-huit ans de sa niŤce, la comtesse Edmond de
Pťrigord, se serait trouvť gÍnť par la prťsence de la princesse. On
comprend, du reste, qu'il ne fit pas cette confidence ŗ mon pŤre et
qu'il chercha d'autres raisons. Cependant cette commission lui ťtait
fort dťsagrťable; il la trouva beaucoup plus facile qu'il ne s'y
attendait.
Madame de Talleyrand, malgrť sa bÍtise, avait un bon sens et une
connaissance du monde qui lui firent comprendre que ce qu'il y aurait
de plus f‚cheux pour le prince et pour elle, serait d'amuser le public
de leurs dissensions intťrieures. Madame Edmond ťtant logťe dans sa
maison, elle ne serait plus tenable pour elle ŗ moins de parvenir ŗ la
chasser, ce qui ne pourrait s'accomplir sans scŤnes violentes. Elle
prit donc son parti de bonne gr‚ce et consentit ŗ s'ťtablir pour les
ťtťs dans une terre en Belgique, que monsieur de Talleyrand lui
abandonna, et ŗ passer ses hivers ŗ Bruxelles.
Elle n'est revenue ŗ Paris que plusieurs annťes aprŤs, lorsque la
sťparation ťtait trop bien constatťe pour que cela fŻt remarquť. Elle
fut trŤs douce, trŤs raisonnable, et pas trop avide dans toute cette
transaction oý elle joua entiŤrement le beau rŰle. Elle dit ŗ ma mŤre
ces paroles remarquables:
ęJe porte la peine d'avoir cťdť ŗ un faux mouvement d'amour-propre. Je
savais l'attitude de madame Edmond chez monsieur de Talleyrand ŗ
Vienne; je n'ai pas voulu en Ítre tťmoin. Cette susceptibilitť m'a
empÍchťe d'aller le rejoindre, comme je l'aurais dŻ, lorsque le retour
de l'Óle d'Elbe m'a forcťe de quitter Paris. Si j'avais ťtť ŗ Vienne,
au lieu de venir ŗ Londres, monsieur de Talleyrand aurait ťtť forcť de
me recevoir; et je le connais bien, il m'aurait parfaitement
accueillie. Plus cela l'aurait contrariť, moins il y aurait paru....
Au contraire, il aurait ťtť charmant pour moi.... Je le savais bien,
mais j'ai cette femme en horreur.... J'ai cťdť ŗ cette rťpugnance,
j'ai eu tort.... Oý je me suis trompťe, c'est que je le croyais trop
faible pour jamais oser me chasser. Je n'ai pas assez calculť le
courage des _poltrons dans l'absence_! J'ai fait une faute; il faut en
subir la consťquence et ne point aggraver la position en se raidissant
contre.... Je me soumets, et monsieur de Talleyrand me trouvera trŤs
disposťe ŗ ťviter tout ce qui pourrait augmenter le scandale.Ľ
Sous ce rapport elle a complŤtement tenu parole.
La douceur inespťrťe de madame de Talleyrand ťtait compensťe pour
monsieur de Talleyrand par les tourments que lui causait madame
Edmond. Elle s'ťtait passionnťe pour un autrichien, le comte de Clam,
et, pendant que la femme lťgitime lui abandonnait la rťsidence de la
rue Saint-Florentin, elle la fuyait sous l'escorte du comte. Monsieur
de Talleyrand en perdait la tÍte.
Il ťtait, d'un autre cŰtť, persťcutť par les dťsespoirs de la duchesse
de Courlande, mŤre de madame Edmond, qui mourait de jalousie des
succŤs de sa fille auprŤs de lui. En revanche, la princesse
Tyszkiewicz, ťgalement passionnťe pour monsieur de Talleyrand, n'ťtait
occupťe qu'ŗ lui adoucir la vie et ŗ faire la cour la plus assidue ŗ
l'heureuse rivale ŗ laquelle elle transfťrait ses hommages aussi
souvent que monsieur de Talleyrand transfťrait son coeur, et, jusqu'ŗ
ce que madame Edmond, et peut-Ítre les annťes, l'eussent fixť
dťfinitivement, cela ťtait frťquent.
Jules de Polignac passa une grande partie de cet ťtť en Angleterre. Il
y ťtait retenu pour accomplir son mariage avec une ťcossaise qu'il
avait rencontrťe ŗ Paris.
Quoiqu'elle port‚t le beau nom de Campbell, il fallait peu s'arrÍter
sur la naissance qui n'ťtait pas lťgitime, mais elle ťtait belle et
fort riche. Sa soeur ťtait mariťe ŗ monsieur Macdonald. Mademoiselle
Campbell avait ťtť fiancťe ŗ un jeune officier tuť ŗ la bataille de
Waterloo. L'hiver suivant, elle ťtait venue chercher ŗ Paris des
distractions ŗ son chagrin. Elle y trouva monsieur de Polignac; il
rťussit ŗ lui plaire, et obtint la promesse de sa main. Mais cela ne
suffisait pas; miss Campbell ťtait protestante. Une pareille union
aurait dťrangť l'avenir de Jules; il fallait donc obtenir d'elle de se
faire catholique. C'ťtait pour travailler ŗ cette abjuration, et
l'instruire dans les dogmes qu'elle consentait ŗ adopter qu'il avait
transportť son sťjour ŗ Londres. Pendant ce temps, il vivait ŗ
l'ambassade dans la mÍme commensalitť qu'ŗ Turin, y dťjeunant et y
dÓnant tous les jours. Les ťvťnements n'avaient guŤre modifiť ses
opinions, mais son langage ťtait plus mesurť que l'annťe prťcťdente.
Le mariage civil se fit dans le salon de mon pŤre. Nous nous rendÓmes
ensuite ŗ la chapelle catholique, puis ŗ l'ťglise protestante. Cela
est nťcessaire en Angleterre oý il n'y a pas d'autres registres de
l'ťtat civil que ceux tenus dans les paroisses. Je crois d'ailleurs
que miss Campbell n'avait pas encore dťclarť son abjuration.
Elle a fait payer chŤrement au pauvre Jules les sacrifices qu'il lui
imposait de son pays et de sa religion. Il est impossible d'Ítre plus
maussade, plus bizarre et plus dťsobligeante. Elle est morte de la
poitrine, trois ans aprŤs son mariage, laissant deux enfants qui
paraissent avoir hťritť de la santť de leur mŤre aussi bien que de sa
fortune. Jules s'ťtait conduit trŤs libťralement au moment de son
mariage au sujet des biens de sa femme. Les Macdonald s'en louaient
extrÍmement. Il a ťtť le meilleur et le plus soigneux des maris pour
sa quinteuse ťpouse. L'homme privť, en lui, est toujours facile,
obligeant et honorable.
CHAPITRE VI
Ordonnance qui casse la Chambre. -- Rťflexion de la vicomtesse de
Vaudreuil ŗ ce sujet. -- Nťgociation avec les ministres anglais.
-- Opposition du duc de Wellington. -- Embarras pour fonder le
crťdit. -- Mon retour ŗ Paris. -- Exaltation des partis. --
Brochure de monsieur Guizot. -- Regrets d'une femme du parti
ultra-royaliste. -- Monsieur Lainť qualifiť de bonnet rouge. --
Griefs des royalistes. -- Licenciement des corps de la maison du
Roi. -- Le colonel Pothier et monsieur de Girardin. -- Les
quasi-royalistes. -- Soirťe chez madame de Duras. -- La coterie
dite ęle ch‚teauĽ. -- Monsieur de Chateaubriand veut quitter la
France. -- Il vend le Val du Loup au vicomte de Montmorency. --
Propos tenu par le prince de Poix ŗ monsieur Decazes.
L'ordonnance du 5 septembre qui cassait la _Chambre introuvable_ de
1815 nous causa plus de joie que de surprise. Ses exagťrations
furibondes ťtaient incompatibles avec le gouvernement sage de Louis
XVIII. Le parti ťmigrť, qui avait conservť quelques reprťsentants en
Angleterre, en eut des accŤs de rage.
Je ne puis m'empÍcher de raconter un colloque qui eut lieu entre mon
pŤre et la vicomtesse de Vaudreuil (soeur du duc de Caraman), dame de
madame la duchesse d'AngoulÍme. Elle se trouvait alors comme voyageuse
ŗ Londres. Elle arriva toute tremblante d'agitation ŗ l'ambassade.
AprŤs avoir reÁu la confirmation de cette incroyable nouvelle, elle
s'adressa ŗ mon pŤre:
ęJe vous plains bien, monsieur d'Osmond, vous allez vous trouver dans
une situation terrible.
--Pourquoi donc, madame?
--Comment pouvez-vous annoncer ici un pareil ťvťnement? Casser une
Chambre! Les anglais ne voudront jamais croire que ce soit possible?Ľ
Mon pŤre lui affirma que rien n'ťtait plus commun dans les usages
britanniques et qu'il n'en rťsulterait pas mÍme de surprise.
ęVous m'accorderez bien au moins que, si on cassait le Parlement, on
n'oserait pas avoir assez peu de pudeur pour annoncer en mÍme temps
des ťlections et en convoquer un autre?Ľ
Voilŗ oý en ťtait l'ťducation de nos dames du palais sur les
gouvernements reprťsentatifs. Madame de Vaudreuil passait pour avoir
de l'esprit et exercer quelque influence sur madame la duchesse
d'AngoulÍme. Elle ťtait une des ouailles favorites de l'abbť Latil. Je
pense que toute sa sociťtť n'ťtait guŤre plus habile qu'elle sur la
pondťration des pouvoirs constitutionnels.
Je ne me rappelle pas, si je l'ai su, comment les nťgociations
s'entamŤrent avec les cabinets de la Sainte-Alliance. Elles ťtaient
arrivťes au point qu'on ťtait ŗ peu prŤs d'accord que l'occupation de
notre territoire pouvait Ítre abrťgťe en avanÁant le terme des
payements imposťs; mais atteindre ce but ťtait fort difficile.
Le duc de Wellington s'opposait ŗ voir diminuer l'armťe d'occupation,
en reconnaissant pourtant que la dťpense qu'elle occasionnait ťcrasait
le pays et rendait plus difficile le remboursement des contributions,
rťclamťes par les puissances, avant de consentir ŗ l'ťvacuation
complŤte de la France.
L'armťe d'occupation ťtait ŗ peine suffisante, selon le duc, pour se
faire respecter. Vainement on lui reprťsentait qu'elle ťtait surtout
imposante par sa force morale et qu'une diminution numťrique, en
calmant les esprits, en tťmoignant de l'intention de libťrer le sol,
assurerait mieux la sťcuritť de l'armťe contre le mauvais vouloir du
pays que ne pourrait faire l'entrťe de nouveaux bataillons.
Le duc ne voulait pas admettre ces arguments auxquels le ministre
anglais se montrait moins rťcalcitrant. Il vint exprŤs ŗ Londres pour
s'en expliquer. Il ťtablit surtout qu'en diminuant le contingent
anglais on laisserait trop d'importance relative aux troupes des
autres nations, qu'il lui serait difficile alors de conserver sa
suprťmatie et d'empÍcher les abus qui, en exaspťrant les habitants,
rendraient le danger plus imminent.
Le cabinet russe ťtait disposť ŗ se prÍter ŗ toutes les facilitťs
qu'on voudrait nous accorder, mais ceux de Vienne et surtout de Berlin
se montraient trŤs rťcalcitrants. Il fallait d'ailleurs s'entendre
entre soi et, lorsqu'on fait la conversation ŗ six cents lieues de
distance, les conclusions sont longues ŗ arriver. On en vint cependant
ŗ peu prŤs ŗ ce rťsultat que la libťration du territoire
s'effectuerait en proportion de l'argent prťalablement payť.
Maintenant oý trouver l'argent? C'ťtait un second point ťgalement
difficile ŗ rťsoudre. Il ťtait impossible de l'enlever directement aux
contribuables sans ruiner le pays, et, depuis cinquante ans, la France
n'avait pas de crťdit. Comment le crťer, et l'exploiter tout ŗ la
fois, dans un moment de crise et de dťtresse? Cette position occupait
les veilles du cabinet Richelieu; mon pŤre s'associait ŗ ses
inquiťtudes et ŗ ses agitations avec un entier dťvouement.
Tel ťtait l'ťtat politique de la situation lorsque je me dťcidai ŗ
venir passer quelques semaines ŗ Paris. Mon frŤre y ťtait retenu par
son service auprŤs de monsieur le duc d'AngoulÍme. Il logeait chez
moi, de faÁon qu'en arrivant ŗ l'a fin de dťcembre 1816, je me
trouvai en mťnage avec lui. Il me prťvint que les opinions ultras
avaient redoublť de violence, depuis l'ordonnance du 5 septembre. J'en
eus la preuve quelques instants aprŤs. La vicomtesse d'Osmond, ma
tante, arriva chez moi; je la savais le type du parti ťmigrť de Paris,
comme son mari l'ťtait du parti ťmigrť des gentilshommes de province.
J'ťvitai soigneusement tout ce qui pouvait engager une discussion;
mais, croyant rester sur un terrain neutre, je m'avisai de vanter un
ťcrit de monsieur Guizot que j'avais lu en route et qui se trouvait
sur ma table. Il ťtait dans les termes de la plus grande modťration et
sur des questions de pure thťorie. La vicomtesse s'enflamma
sur-le-champ.
ęQuoi! le pamphlet de cet affreux monsieur Guizot? Il n'est pas
possible, chŤre petite, que vous approuviez une pareille horreur!Ľ
Mon frŤre tťmoigna son ťtonnement de la maniŤre dont elle en parlait.
Il n'avait pas lu la brochure, mais il avait entendu monsieur le duc
d'AngoulÍme en faire grand ťloge.
ęMonsieur le duc d'AngoulÍme! Ah! je le crois bien! peut-Ítre mÍme ne
l'a-t-il pas trouvťe assez jacobine, assez insultante pour les
royalistes...Ľ
Et, s'ťchauffant dans son harnois, elle finit par dťclarer le livre
atroce et son auteur pendable. Quant aux lecteurs bťnťvoles, ils lui
paraissaient ťgalement odieux.
Je vis que Rainulphe m'avait bien renseignťe. Les folies ťtaient
encore grandies pendant mon absence.
Je me tins pour avertie; mais mes soins pour ťviter des discussions,
dont je reconnaissais la complŤte inutilitť, avec un parti oý les
personnalitťs insultantes arrivent toujours au troisiŤme argument,
furent insuffisants. Une prompte retraite ťtait le seul moyen ŗ
employer contre les querelles. J'y avais recours toutes les fois que
cela ťtait possible, mais je ne pouvais pas toujours ťviter les
attaques; alors il fallait bien rťpondre, car, si je consentis ŗ fuir
avant l'action, mes concessions n'allaient pas au delŗ. Je ne prťtends
pas n'avoir point modifiť frťquemment mes opinions, mais j'ai toujours
eu le courage de celles du moment.
Ce fut bien peu de jours aprŤs mon arrivťe que, causant sťrieusement
avec une femme d'esprit, trŤs bonne au fond, qui voulait m'effrayer
sur la tendance modťrťe et conciliante du ministŤre Richelieu, elle me
dit:
ęEnfin, voyez, chŤre amie, les sacrifices qu'on nous impose et combien
cela doit exaspťrer! Les Cent-Jours coŻtent plus de dix-huit cents
millions. Eh bien, que nous a-t-on donnť pour tout cela, et encore
avec quelle peine? la tÍte de deux hommes.Ľ
Je fis un mouvement en arriŤre.
ęMa chŤre, rťflťchissez ŗ ce que vous venez de dire; vous en aurez
horreur vous-mÍme, j'en suis sŻre.Ľ
Elle fut un peu embarrassťe et voulut expliquer qu'assurťment ce
n'ťtait pas dans des idťes sanguinaires ni mÍme de vengeance, mais
qu'il fallait inspirer un salutaire effroi aux factieux et rassurer
les honnÍtes gens (car ce sont toujours les _honnÍtes gens_ au nom
desquels on rťclame des rťactions) en leur montrant qu'on les
protťgeait efficacement.
Au fond, le vťritable crime du ministŤre Richelieu ťtait de laisser en
repos les fonctionnaires de l'Empire qui remplissaient bien leurs
places. Le parti ťmigrť voulait tout accaparer. La Chambre introuvable
et son ministre, Vaublanc, avaient travaillť ŗ cette _ťpuration_ (cela
s'appelait ainsi) avec un zŤle que la sagesse du cabinet avait
arrÍtť. Aussi monsieur Lainť, le successeur de monsieur de Vaublanc,
ťtait-il en butte ŗ une animadversion forcenťe. On avait ťtabli qu'il
ťtait enfant naturel, de sang de couleur, et qu'il avait dressť la
guillotine ŗ Bordeaux. De sorte que, dans les salons, on l'appelait
indiffťremment le B‚tard, le Mul‚tre, ou le Bonnet rouge. Il est
devenu plus tard l'idole du parti qui l'avait dťcorť de ces titres,
tous ťgalement inventťs et sans aucun fondement.
Il faut reconnaÓtre, toutefois, que les royalistes n'ťtaient pas sans
quelques griefs ŗ faire valoir; mais ils tenaient, en grande partie, ŗ
la maladresse de leurs propres chefs. Ainsi, par exemple, en 1814, on
avait formť les compagnies rouges de la maison du Roi.
Je conviens, tout d'abord, combien il ťtait absurde d'ajouter aux
armťes, les plus actives et les plus militaires du monde connu, un
corps d'ťlite, composť de jeunes gens qui n'avaient jamais rien fait
que des voeux contre l'Empire du fond de leur castel. Mais il n'en est
pas moins vrai que la gentilhommerie franÁaise avait achevť de
s'ťpuiser, dans un moment de dťtresse gťnťrale, pour parvenir ŗ
ťquiper ses fils, les armer, les monter ŗ ses frais et les envoyer
garder le monarque de ses affections.
La plupart de ces jeunes gens avaient trouvť le moyen de se rendre ŗ
Gand pendant les Cent-Jours. Ils furent licenciťs sans recevoir mÍme
des remerciements. Les chefs tirŤrent bon et utile parti de leur
situation, mais les simples gardes en furent pour leurs frais. Je ne
prťtends pas qu'on dŻt conserver les compagnies rouges, mais il ne
fallait pas les renvoyer avec cette _dťsinvolture_.
Autre exemple: messieurs les capitaines des gardes du corps
dťcidŤrent, tout ŗ coup, que leurs compagnies n'ťtaient pas assez
belles et n'avaient pas l'air suffisamment militaire. Un beau matin
ils les assemblŤrent, firent sortir des rangs ceux d'entre eux qui
n'atteignaient pas une taille fixťe et les avertirent qu'ils ne
faisaient plus partie du corps. Le hasard fit que cette rťforme tomba
principalement sur des gardes ayant fait le service ŗ Gand. On leur
donna, ŗ la vťritť, un brevet ŗ la suite d'une armťe encombrťe
d'officiers. Ils devaient aller en solliciter l'exťcution dans des
bureaux qui ne leur ťtaient nullement favorables, et les commis leur
tenaient peu compte de la campagne ŗ Gand qu'ils appelaient _le voyage
sentimental_.
Une circonstance particuliŤre donna lieu ŗ beaucoup de clabauderie. Le
colonel Pothier, voulant se marier, demanda, suivant l'usage,
l'agrťment du ministre de la guerre. Au bout de quelques jours, on lui
rťpondit qu'il ne pouvait pas se marier, attendu qu'il ťtait mort.
Fort ťtonnť de cette rťvťlation, il sortait pour aller aux
informations lorsqu'il vit entrer chez lui le comte Alexandre de
Girardin qui lui prťsenta, de la faÁon la plus obligeante, des lettres
de gr‚ce. Le colonel fut indignť et s'emporta vivement.
Pendant les Cent-Jours, il avait ťtť retrouver le Roi ŗ Gand. Monsieur
de Girardin, qui commandait dans le dťpartement du Nord pour
l'Empereur, avait prťsidť un conseil de guerre qui condamnait le
colonel Pothier et une douzaine d'autres officiers ŗ mort, pour
dťsertion ŗ l'ťtranger. Il avait oubliť cet incident que, dans la
rapiditť des ťvťnements, les parties les plus intťressťes avaient
elles-mÍmes ignorť.
Monsieur de Girardin devait ŗ son talent incontestable pour organiser
les ťquipages de chasse une existence toute de faveur, et inťbranlable
par aucune circonstance politique, auprŤs des princes de la
Restauration.
Il eut vent le premier de la rťvťlation faite au colonel Pothier et se
h‚ta d'avoir recours au Roi, espťrant que la gr‚ce, portťe tout de
suite, assoupirait cette affaire. Mais Pothier n'ťtait pas homme ŗ
prendre la chose si doucement: il dťclara qu'il ne voulait pas Ítre
graciť; il ne reconnaissait pas avoir _dťsertť ŗ l'ťtranger_. C'ťtait
un acte infamant dont il ne voulait pas laisser la tache ŗ ses
enfants.
Monsieur de Girardin eut beau faire; il ne put empÍcher les
criailleries et les haines du parti royaliste de se dťchaÓner contre
lui; mais son talent pour placer les guerrards et faire braconner les
oeufs de perdrix au profit des chasses royales l'a toujours soutenu en
dťpit des passions auxquelles, du reste, il a amplement sacrifiť par
la suite. Il se vantait, dŤs lors, de n'avoir repris de service auprŤs
de l'Empereur, pendant les Cent-Jours, que pour le trahir et d'avoir
conservť une correspondance active avec monsieur le duc de Berry,
espŤce d'excuse qui m'a toujours paru beaucoup plus odieuse que la
faute dont on l'accusait.
Le parti royaliste avait donc bien quelques plaintes rationnelles ŗ
faire valoir et il les exploitait avec l'aigreur qui lui est propre.
Il acceptait assez volontiers le nom d'_ultra-royaliste_; mais, comme
monsieur Decazes ťtait devenu sa bÍte noire, et qu'il avait peine ŗ
tolťrer les personnes qui conservaient des rapports avec lui, il nous
donnait en revanche celui de _quasi-royalistes_. Les quolibets ne lui
ont guŤre manquť; celui-ci ťtait assez drŰle; mais souvent il en
adopta de grossiers qui semblaient devoir Ítre repoussťs par des gens
se proclamant les organes exclusifs du bon goŻt.
J'eus bientŰt occasion de voir jusqu'oý l'animadversion ťtait portťe
contre le favori du Roi. Je fis ma rentrťe dans le monde parisien ŗ
une grande soirťe chez madame de Duras. Je circulais dans le salon,
donnant le bras ŗ la vicomtesse de Noailles, lorsque j'aperÁus madame
Princeteau. Je l'abordai, lui pris la main, et causai avec elle.
Pendant ce temps, madame de Noailles l‚chait mon bras et s'ťloignait.
Elle s'arrÍta ŗ quelques pas, auprŤs de la duchesse de Maillť. Je
rejoignis ces dames avec lesquelles j'ťtais extrÍmement liťe.
ęNous vous admirons de parler ainsi ŗ madame Princeteau ŗ la face
d'IsraŽl.
--Ah! c'est un courage de dťbutante; si elle ťtait ici depuis huit
jours, elle n'oserait pas.
--Comment voulez-vous que j'aie l'impertinence de passer ŗ cŰtť d'elle
sans lui faire politesse? je dÓne chez son frŤre demain.
--Cela ne fait rien, on va chez le ministre et on ne parle ni ŗ madame
Princeteau, ni mÍme ŗ monsieur Decazes quand on les rencontre
ailleurs.
--Jamais je n'aurai cette grossiŤretť.
--Nous verrons.
--Je vous jure que vous ne verrez pas.
--Hť bien, vous aurez un courage de lion.Ľ
Ces dames avaient raison, car, pour ne point faire une absurde
l‚chetť, il fallait affronter tout, jusqu'ŗ _la mode_! Je me dois la
justice de lui avoir rťsistť. J'ai toujours eu un grain d'indťpendance
dans ma nature qui s'opposait ŗ ces exigences de coteries.
ņ propos de coterie, il s'en ťtait formť pendant mon absence une des
plus compactes. Elle n'avait rien de politique ni de sťrieux, on
l'avait appelťe, ou elle s'ťtait appelťe, _le ch‚teau_. Quelques
femmes, retenues ŗ Paris pendant l'ťtť, avaient pris l'habitude de
passer toutes leurs soirťes ensemble, comme elles l'auraient fait dans
un ch‚teau de campagne, et y avaient attirť les hommes de leur
sociťtť. Rien n'ťtait plus naturel. Mais, lorsque l'hiver avait ramenť
le monde et les assemblťes nombreuses, elles avaient eu la prťtention
d'y transporter leurs nouvelles habitudes. Elles arrivaient ensemble,
s'ťtablissaient en rond dans un salon, entourťes de quelques hommes
admis ŗ leur familiaritť, et ne communiquaient plus avec les vulgaires
mortels.
On me fit de grandes avances pour entrer dans ce sanhťdrin, composť de
mes relations les plus habituelles. Non seulement je m'y refusai, mais
je m'y dťclarai hostile ouvertement et en face. Mon argument principal
pour le combattre (et je pouvais le soutenir sans offenser) ťtait que
cette coalition enlevait ŗ la sociťtť les personnes les plus faites
pour la parer et la rendre aimable.
Petit ŗ petit les hommes de quelque distinction se retirŤrent du
_ch‚teau_ qui fut pris en haine par tout ce qui n'en faisait pas
partie. Quelques dames s'obstinŤrent encore un peu de temps ŗ le
soutenir, mais il se dťmolit graduellement. Toutes en ťtaient dťjŗ
bien ennuyťes lorsqu'elles y renoncŤrent.
L'exclusif a quelque chose d'insociable qui ne rťussira jamais en
France, pas plus pour les jeunes femmes que pour les savants ou les
gens de lettres, encore moins pour les hommes politiques.
Madame de Duras s'ťtait placťe vis-ŗ-vis du _ch‚teau_ dans la mÍme
position que moi. Elle s'en tenait en dehors, quoique personnellement
liťe avec tout ce qui le composait. Le duc de Duras n'ťtant plus de
service, elle avait quittť les Tuileries.
J'allais toujours beaucoup chez elle, mais moins journellement. Elle
logeait dans la rue de Varenne et la distance m'arrÍtait quelquefois.
J'y trouvais aussi une opposition assez vive au ministŤre pour me
gÍner.
Les mťcomptes de monsieur de Chateaubriand s'ťtaient prolongťs et
aggravťs au point de le rendre trŤs hostile. Ses embarras pťcuniaires
s'accroissaient chaque jour et sa mťchante humeur suivait la mÍme
progression. Il conÁut l'idťe d'aller en Angleterre ťtablir un journal
d'opposition, la presse ne lui paraissant pas suffisamment libre ŗ
Paris pour attaquer le gouvernement du Roi.
Mon pŤre redoutait fort cet incommode visiteur. Heureusement, les
rťpugnances de madame de Chateaubriand, d'une part, et les
sollicitations des _Madames_, de l'autre, le firent renoncer ŗ ce
projet.
Le dťsir de faire effet, autant que le besoin d'argent, l'engagŤrent ŗ
vendre son habitation du Val-du-Loup. Son mťcontentement fut portť ŗ
l'excŤs lorsqu'il reconnut que personne ne s'occupait d'un si grand
ťvťnement; il avait pourtant cherchť ŗ lui donner le plus de publicitť
possible. La maison avait ťtť mise en loterie ŗ mille francs le
billet. Madame de Duras, aussi bien que lui, se persuadait que les
souscripteurs arriveraient de toutes les parties du monde connu et que
l'ingratitude de la maison de Bourbon pour son protecteur serait
tellement ťtablie devant le public que les indemnitťs en argent, en
places et en honneurs, allaient pleuvoir sur la tÍte de monsieur de
Chateaubriand.
Au lieu de cela, la loterie annoncťe, prŰnťe, colportťe, ne procura
pas de souscripteurs, personne ne voulut de billet; je crois qu'il n'y
en eut que trois de placťs. Mathieu de Montmorency acheta le
Val-du-Loup en remboursement d'un prÍt fait prťcťdemment ŗ monsieur de
Chateaubriand. La Cour, le gouvernement, le public, l'ťtranger,
personne ne s'en ťmut, et monsieur de Chateaubriand se trouva
dťpouillť de sa petite maison sans avoir produit l'effet qu'il en
espťrait.
L'irritation ťtait restťe fort grande dans son coeur. Il la fallait
bien vive pour le dťcider, plus tard, ŗ s'associer aux autres
fondateurs du _Conservateur_. Il n'avait rien de commun avec eux, ni
leurs prťjugťs, ni leurs sentiments, ni leurs regrets, ni leurs
espťrances, ni leur sottise, ni mÍme leur honnÍtetť. Il n'y a aucun
moment de sa vie oý ses convenances de position l'aient plus ťcartť de
ses opinions, de ses goŻts et de ses tendances personnelles. La
plupart des thŤmes qu'ils soutenaient rťpugnaient ŗ son jugement; il
les aurait bien mieux et plus volontiers rťfutťs s'il s'ťtait trouvť
au pouvoir et appelť ŗ les combattre. Au demeurant, il ťtait bien
maussade ŗ cette ťpoque et il m'en voulait terriblement d'Ítre
ministťrielle.
Au reste, ce n'ťtait pas la mode parmi ceux qui se prťtendaient les
royalistes par excellence. Je me souviens qu'ŗ un grand bal chez le
duc de Castries, le prince de Poix, qui pourtant honorait monsieur
Decazes de sa bienveillance, lui frappa sur l'ťpaule en lui disant
tout haut:
ęBonsoir, cher traÓtre.Ľ
Monsieur Decazes parut assez surpris de l'interpellation pour
embarrasser le prince de Poix qui, pour raccommoder cette premiŤre
gaucherie, ajouta, avec son intelligence accoutumťe:
ęMais, que voulez-vous, ils vous appellent tous comme cela.Ľ
Au fond, le prince de Poix disait la vťritť, mais la naÔvetť ťtait un
peu forte. Monsieur Decazes fut trŤs dťconcertť et probablement fort
irritť.
S'il est vrai, comme je le crois, qu'il se soit un peu trop jetť dans
une rťaction vers la gauche dans les annťes 1817 et 1818, certes le
parti royaliste peut bien se reprocher de l'y avoir poussť. Il est
impossible que des insultes aussi rťitťrťes ne finissent pas par
exaspťrer; et, sans en avoir la conscience, l'homme d'…tat ne rťsiste
pas constamment au besoin de dťfendre, peut-Ítre mÍme de venger,
l'homme privť.
Monsieur Decazes aurait trouvť de grandes facilitťs ŗ exercer des
reprťsailles s'il avait voulu, car, ŗ cette ťpoque, le Roi ne lui
aurait rien refusť; mais sa nature est bienveillante.
CHAPITRE VII
Nťgociations pour un emprunt. -- Ouvrard va en Angleterre. -- Il
amŤne monsieur Baring chez mon pŤre. -- Confťrence avec lord
Castlereagh. -- Arrivťe de messieurs Baring et LabouchŤre ŗ
Paris. -- Espťrances trompťes. -- DÓner chez la marťchale Moreau.
-- Brochure de Salvandy. -- Influence du gťnťral Pozzo sur le duc
de Wellington. -- Soirťe chez la duchesse d'Escars. -- Monsieur
Rubichon. -- L'emprunt ťtant conclu, l'opposition s'en plaint.
J'ai dťjŗ dit que toutes les sollicitudes du gouvernement portaient
sur la libťration du territoire et que cette nťgociation se trouvait
ramenťe ŗ une question d'argent. Ouvrard, le plus intelligent s'il
n'est le plus honnÍte des hommes de finance, s'offrit ŗ la traiter. Il
proposa plusieurs plans.
Les capitalistes franÁais, consultťs, dťclarŤrent unanimement qu'il
n'y avait aucun fond ŗ faire sur le crťdit. Monsieur Laffite, entre
autres, se moqua hautement de la pensťe d'un emprunt et dit
textuellement ŗ Pozzo, dont il ťtait le banquier et qui s'ťtait chargť
de le sonder, que la France ne trouverait pas un petit ťcu ŗ emprunter
sur aucune place de l'Europe.
Cet esprit de la Bourse de Paris dťsolait notre cabinet plus encore
comme symptŰme que comme rťsultat. Car les puissances, et surtout la
Prusse, n'acceptaient pas la garantie de capitalistes franÁais et
voulaient que l'emprunt fŻt consenti par des ťtrangers. Si donc les
banquiers franÁais s'ťtaient prťsentťs, il y aurait eu une difficultť
d'un autre genre ŗ les ťconduire.
Ouvrard seul persistait ŗ soutenir la possibilitť de rťtablir le
crťdit. On lui donna mission pour s'en occuper et il partit pour
Londres. Il se mit en rapport avec mon pŤre qu'il sťduisit par des
aperÁus les plus spťcieux et, en apparence, les plus clairs. Il ne
doutait jamais de rien. Au bout de peu de semaines, Ouvrard l'avertit
que l'emprunt ťtait fait ŗ des conditions fort avantageuses dont il
envoyait le dťtail ŗ monsieur Corvetto. Les maisons Baring et
LabouchŤre s'en chargeaient; il ne restait plus qu'une difficultť;
elle n'ťtait pas de sa compťtence.
Messieurs Baring et LabouchŤre ne demandaient en aucune faÁon la
garantie de l'…chiquier, mais seulement l'assurance qu'en se chargeant
de l'opťration ils ne feraient rien de contraire aux intentions du
gouvernement et qui pŻt nuire aux intťrÍts anglais. Ils dťsiraient
s'en expliquer avec mon pŤre.
La confťrence eut lieu. Monsieur Baring y fut conduit par Ouvrard. Il
se dťclara prÍt ŗ traiter dŤs que lord Castlereagh l'y aurait
autorisť. Mon pŤre se rendit chez le ministre; ils tombŤrent d'accord
de ce qu'il convenait de faire pour mťnager les autres puissances, et
principalement les susceptibilitťs du duc de Wellington. Le lendemain,
mon pŤre conduisit messieurs Baring et LabouchŤre chez lord
Castlereagh; il les y laissa.
Peu de temps aprŤs, ces messieurs revinrent lui demander leurs
passeports. Non seulement le ministre avait autorisť mais il avait
approuvť et avait ťtť jusqu'ŗ dire que ęces messieurs feraient un acte
de bon citoyen anglais en se chargeant de cette transaction, qu'ils
rendraient un service ťminent ŗ l'Europe entiŤre.Ľ Ils ťtaient
enchantťs.
Monsieur Baring ajouta que lord Castlereagh lui avait recommandť, en
souriant, de dťbarquer chez le duc de Wellington et de prendre ses
conseils, attendu que Sa Gr‚ce avait des prťtentions toutes
particuliŤres ŗ l'habiletť en matiŤre de finances et y attachait
infiniment plus de prix qu'ŗ ses talents militaires. Ils partirent le
soir mÍme en compagnie d'Ouvrard qui les devanÁa et arriva en
courrier.
Quoique le secret fŻt essentiel, j'ťtais au courant de ce qui se
passait et bien heureuse comme on peut croire, d'autant que Pozzo
m'annonÁait les dispositions du duc excellentes et qu'on ne semblait
avoir aucun autre obstacle ŗ vaincre. Aussi c'ťtait avec une
satisfaction que je dissimulais de mon mieux, que j'entendais chaque
jour [discuter] sur l'absurde crťdulitť du cabinet qui avait eu la
folle idťe de pouvoir faire un emprunt. Chacun avait connaissance d'un
banquier, ou d'un agent de change, qui lui avait dťmontrť la vanitť
d'un tel projet. Il est vrai qu'on en riait ŗ la Bourse.
Deux heures aprŤs son arrivťe ŗ Paris, Ouvrard ťtait chez moi. Il
avait vu nos ministres; il avait vu le duc de Wellington; il avait vu
Pozzo: il ťtait radieux. Ce dernier ne tarda pas ŗ nous rejoindre,
enchantť de sa propre visite au duc. Je me rappelle que nous dÓnions
en trŤs petit comitť chez monsieur Decazes; je laisse ŗ penser si nous
ťtions joyeux.
Le lendemain matin, je reÁus un billet de Pozzo qui me disait de
l'attendre afin de pouvoir ťcrire ŗ Londres aprŤs l'avoir vu. Le duc
l'avait envoyť chercher. Il entra chez moi la figure toute dťcomposťe.
Messieurs Baring et LabouchŤre ťtaient arrivťs; rien n'ťtait conclu;
Ouvrard avait pris ses voeux pour des faits accomplis: ou il s'ťtait
trompť, ou il avait voulu tromper pour faire un coup de Bourse, ce
dont il ťtait bien capable. Mais enfin, loin que ces messieurs eussent
consenti les arrangements qu'il avait apportťs comme conclus, ils
dťclaraient n'avoir ni acceptť, ni mÍme discutť aucune proposition.
Ils ne venaient que pour ťcouter ce qu'on leur demanderait. Ils
avaient au moment mÍme une confťrence avec monsieur Corvetto; mais,
d'aprŤs ce qu'ils avaient laissť entendre au duc des bases sur
lesquelles ils consentiraient ŗ traiter, elles ťtaient toutes
diffťrentes des paroles portťes par Ouvrard et tellement onťreuses
qu'il ťtait presque aussi impossible de les accepter que de se passer
d'un emprunt. La chute ťtait profonde de notre joie de la veille. Je
la sentis doublement et pour Paris et pour Londres.
C'ťtait un grand dťboire pour mon pŤre qui semblait pris pour dupe. Je
crois bien qu'Ouvrard avait jouť tout le monde en rťussissant avec
beaucoup d'adresse ŗ ťviter des paroles explicites sur l'ťtat de la
nťgociation; mais, lui-mÍme, je pense, s'ťtait trompť dans ses propres
finesses et avait espťrť que ces messieurs, aprŤs leur dťmarche
vis-ŗ-vis du cabinet anglais et leur voyage ŗ Paris, se trouveraient
trop engagťs pour reculer et accepteraient, ou ŗ peu prŤs, ses plans
sur l'emprunt.
Je crois aussi que monsieur Baring, avec lequel il s'ťtait
principalement abouchť ŗ Londres et qui ťtait bien plus facile en
affaires que monsieur LabouchŤre, s'ťtait montrť plus disposť ŗ la
transaction telle qu'elle ťtait offerte. Il est assez probable que,
pendant le voyage qu'ils firent dans la mÍme voiture, monsieur
LabouchŤre n'avait pas employť inutilement son ťloquence ŗ engager son
collŤgue ŗ profiter des nťcessitťs de la France pour lui imposer de
plus rudes conditions.
Ce qu'il y a de sŻr, c'est que les trois confťrences que mon pŤre
avait eues avec ces messieurs, en prťsence d'Ouvrard ŗ la vťritť, lui
avaient laissť l'impression que les bases de la transaction ťtaient
arrÍtťes. Cela ťtait si peu exact que, lorsqu'ils sortirent du cabinet
de monsieur Corvetto, le jour de leur arrivťe ŗ Paris, tout ťtait
rompu.
Je ne suivrai pas le dťtail de la maniŤre dont la nťgociation fut
renouťe. Le duc de Wellington ne s'y ťpargna pas. Quand une fois on
lui avait fait adopter une idťe et qu'on parvenait ŗ la lui persuader
_sienne_, il la suivait avec persťvťrance. Pozzo excellait dans cet
art, et c'est un des grands services qu'il a rendus ŗ la France dans
ces temps de douloureuse mťmoire oý notre sort dťpendait des caprices
d'un vieil enfant g‚tť.
Je me rappelle une circonstance oý ce jeu eut lieu devant nous d'une
faÁon assez plaisante. Monsieur de Barante, parlant ŗ la tribune comme
commissaire du Roi dans je ne sais quelle occasion, dťsigna l'armťe
d'occupation par l'ťpithŤte de _cent cinquante mille garnisaires_.
L'expression ťtait juste, mais le duc de Wellington fut courroucť ŗ
l'excŤs et on eut grand'peine ŗ l'apaiser.
Peu de jours aprŤs, je dÓnai chez la marťchale Moreau avec une partie
de nos ministres. Ils arrivŤrent dťsolťs. Il avait paru le matin une
petite brochure intitulťe _La France et la Coalition_, c'ťtait le
premier ouvrage d'un trŤs jeune homme, Salvandy. Il ťtait ťcrit avec
un patriotisme plein de coeur et de talent, et tout franchement il
appelait la nation aux armes contre les cent cinquante mille
garnisaires.
On ťtait en pleine nťgociation pour l'emprunt et pour la rťduction de
l'armťe d'occupation. Pour rťussir, il fallait maintenir la bonne
humeur du duc et on redoutait l'effet que cette brochure allait
produire sur lui. Le duc de Richelieu ťtait consternť; monsieur
Decazes partageait son inquiťtude. Il avait la brochure dans sa poche;
il en montra quelques phrases ŗ Pozzo: elles lui parurent bien
violentes.
ęCependant, dit-il, si le duc n'en a pas encore entendu parler, nous
nous en tirerons.Ľ
AprŤs s'Ítre fait attendre une heure, suivant son usage, le duc
arriva avec son sourire impassible sur son ci-devant beau visage, et
son: ęAh! oui! Ah! oui!Ľ au service de tout le monde; c'ťtait signe de
bonne humeur.
Pozzo me dit: ęLe duc ne sait rien.Ľ
Puis, s'adressant au duc de Richelieu qui ťtait ŗ cŰtť de moi:
ęSoyez tranquille; je me charge de votre affaire.Ľ
Il s'ťloigna des ministres avec une sorte d'affectation, prit l'air
trŤs grognon, dit ŗ peine un mot pendant le dÓner et eut soin de
laisser remarquer sa maussaderie.
ņ peine le cafť pris, il entraÓna le duc sur un canapť et lui parla
avec fureur de cette affreuse brochure et de la nťcessitť de se rťunir
pour en porter les plaintes les plus amŤres. Il n'y avait plus moyen
de supporter de pareilles insolences, etc.
Le duc, tout ťpouffť de cette sortie, lui demanda des dťtails sur la
brochure. Il lui en rapporta des phrases dont il eut soin d'envenimer
les expressions. Le duc s'occupa ŗ calmer les violences de
l'ambassadeur, le pria de ne faire aucune dťmarche sans Ítre entendu
avec lui, promit de lire la brochure et lui donna rendez-vous pour le
lendemain matin.
Pozzo vint reprendre son chapeau qui se trouvait prŤs de moi et me
dit:
ęPrťvenez-les que tout est accommodťĽ, et partit sans avoir ťchangť
une parole avec nos ministres.
Le duc, en revanche, se rapprocha d'eux et fit mille frais pour
compenser la mauvaise humeur de son collŤgue de Russie. Le lendemain
matin, Pozzo se rendit chez le duc. Celui-ci avait lu la brochure;
sans doute elle ťtait inconvenante, mais moins que le gťnťral Pozzo ne
l'avait annoncť. Les phrases rťpťtťes la veille ťtaient moins
offensantes, l'ťpithŤte la plus insultante ne s'y trouvait pas; puis
c'ťtait l'oeuvre d'un tout jeune homme qui n'avait aucune importance
personnelle; enfin la lecture n'avait pas excitť la colŤre du duc
autant que celle de Pozzo.
Celle-ci s'ťtait un peu apaisťe pendant la nuit. Il se laissa
persuader par l'ťloquence du duc et consentit ŗ ne point faire
d'ťclat, d'autant qu'il avait appris que le gouvernement franÁais
ťtait indignť et dťsolť de cette intempestive publication. Il fut donc
convenu qu'on la tiendrait pour non avenue; tout au plus en ferait-on
mention _amiablement_ pour tťmoigner en avoir connaissance et n'en
tenir aucun compte.
Nous nous amus‚mes fort de cette espŤce de proverbe. On comprend que
Pozzo n'abusait pas de ces formes et qu'il en usait assez sobrement
pour que le duc ne pŻt jamais se douter de l'empire qu'il exerÁait sur
lui.
Il ne faut pourtant pas croire que le duc de Wellington fŻt un homme
nul. D'abord, il avait l'instinct de la guerre ŗ un haut degrť
quoiqu'il en sŻt mal la thťorie, et le jugement sain dans les grandes
affaires quoique dťpourvu de connaissances acquises. Avec peu de
moralitť dans quelques parties de sa conduite, il ťtait ťminemment
loyal et franc, c'est-ŗ-dire qu'il ne cherchait jamais ŗ dissimuler sa
pensťe du jour, ni son engagement de la veille; mais une fantaisie
suffisait pour faire changer sa volontť du tout au tout. C'ťtait ŗ
combattre ses frťquents caprices, ŗ empÍcher qu'ils ne dirigeassent
ses actions, que le gťnťral Pozzo s'employait habilement, et souvent
avec succŤs. Le duc l'ťcoutait d'autant plus volontiers qu'il le
savait dans sa dťpendance par l'ťvťnement de 1815 dont j'ai dťjŗ rendu
compte.
Les nťgociations pour l'emprunt avaient ťtť reprises et tout ťtait
conclu; on devait signer le lendemain. J'allai passer la soirťe chez
la duchesse d'Escars, aux Tuileries (son mari ťtait premier maÓtre
d'hŰtel). Je fus frappťe, en arrivant, de voir un groupe nombreux au
milieu du salon. Un homme y pťrorait.
C'ťtait un certain Rubichon, espŤce de mauvais fou, qui avait fait des
banqueroutes ŗ peu prŤs frauduleuses dans plusieurs contrťes, mais qui
n'en ťtait pas moins l'oracle du parti ultra et le financier du
pavillon de Marsan. Pour se mieux faire entendre, il ťtait montť sur
les barreaux d'une chaise et dominait la foule de la moitiť de sa
longue et maigre personne. Il prophťtisait malheur au gouvernement du
Roi, accumulait argument sur argument pour prouver le dťsordre des
finances, l'impossibilitť de payer l'impŰt et la banqueroute
immanquable avant quinze jours. Pour complťter le scandale de cette
parade, dans le palais mÍme du Roi et ŗ la clartť des bougies qu'il
payait, monsieur Rubichon avait pour auditeurs monsieur Baring et
monsieur LabouchŤre.
Je remarquai en cette occasion l'attitude diffťrente de ces deux
hommes. Baring haussait les ťpaules et, au bout de peu d'instants,
s'ťloigna. Monsieur LabouchŤre ťcoutait avec une grande attention,
hochait la tÍte, sa physionomie se rembrunissait et il ťprouvait ou
feignait de l'anxiťtť. Je sus que le lendemain, lorsqu'il s'agit de
signer, il voulut faire valoir les inquiťtudes de Rubichon pour
aggraver les conditions; mais la franche loyautť de Baring s'y opposa,
et il combattit lui-mÍme les arguments de son associť.
Il n'en restait pas moins vrai que les plus intimes serviteurs du Roi
avaient fait tout ce qui dťpendait d'eux pour augmenter les embarras
de la position. Ils continuŤrent leurs manoeuvres. Ils avaient, la
veille, dťclarť l'emprunt impossible ŗ aucun taux; le lendemain, ils
le trouvŤrent trop onťreux; et, aprŤs avoir proclamť l'augmentation
imminente de l'armťe d'occupation qui devait, selon eux, s'emparer de
nos places fortes, ils se plaignirent amŤrement que la conclusion de
l'emprunt n'amen‚t qu'une rťduction de trente mille hommes. Voilŗ le
langage des soi-disant amis.
L'opposition, de son cŰtť, faisait des phrases sur ce qu'on ne devait
pas expulser les ťtrangers avec de l'_or_ mais avec du _fer_.
C'ťtaient autant de nouveaux Camilles. Cela ťtait assurťment d'un fort
beau patriotisme; mais, hťlas! il y avait autour de nos frontiŤres un
million de _Brennus_ tout prÍts ŗ leur rťpondre: _Malheur aux
vaincus!_
ņ la Bourse, les mÍmes gens, qui se riaient de pitiť quand monsieur
Corvetto avait annoncť le dťsir de faire un emprunt et le dťclaraient
impossible ŗ aucun prix, se plaignaient de n'en Ítre pas chargťs et
protestaient qu'ils l'auraient pris ŗ des termes moins onťreux, de
maniŤre que ce succŤs inespťrť fut tellement attťnuť par les haines de
parti qu'il n'en resta presque rien au gouvernement du Roi.
J'en fus aussi surprise que dťsappointťe. Depuis plusieurs mois, je
voyais nťgocier cette affaire; je l'avais sue faite et manquťe
plusieurs fois. J'avais suivi les craintes et les espťrances de tous
ces bons esprits, de tous ces coeurs patriotiques. Je savais les
insomnies qu'ils avaient ťprouvťes, les anxiťtťs avec lesquelles on
avait attendu un courrier de Berlin..., un assentiment de Vienne....
Je voyais l'emprunt fait ŗ un taux supportable par des capitalistes
ťtrangers inspirant assez de confiance aux puissances pour qu'elles
consentissent ŗ des termes de payements qui le rendaient possible.
Elles nous donnaient un tťmoignage immťdiat de leur bonne foi en
retirant trente mille hommes de l'armťe d'occupation. Il ťtait
prťsumable, dŤs lors, que l'ťvacuation complŤte du territoire suivrait
prochainement, et la suite l'a prouvť.
C'ťtait assurťment le plus beau succŤs qu'une administration, placťe
dans une position aussi difficile, pŻt obtenir; mais il lui fallait
interroger sa propre conscience pour en jouir, car, amis et ennemis,
tout le monde l'avait si bien escomptť par avance que l'effet en fut
fort attťnuť.
Le duc de Richelieu ťtait un des hommes qui pouvait le mieux se
replier sur son noble coeur et se trouver suffisamment payť par les
services qu'il rendait. Je dis _lui_, particuliŤrement, parce que la
confiance inspirťe par sa loyautť avait contribuť plus qu'aucune autre
chose au succŤs de la nťgociation; mais ses collŤgues avaient partagť
ses veilles et ses travaux; ils mťritaient une part de reconnaissance
si les nations savaient en avoir quand elles souffrent.
Pour moi, qui ne me piquais pas d'autant de philosophie, je fus
indignťe de cette ingratitude; Pozzo en rugissait.
CHAPITRE VIII
Madame la duchesse de Berry. -- La duchesse de Reggio. -- Le
mariage de mon frŤre avec mademoiselle DestilliŤres est convenu.
-- ScŤne aux Tuileries. -- Le Roi est malade. -- Le _Manuscrit de
Sainte-HťlŤne_. -- Lectures chez mesdames de Duras et d'Escars.
-- SuccŤs de cette publication apocryphe.
J'avais fait ma cour en arrivant, mais je n'avais pas vu madame la
duchesse de Berry qu'un commencement de grossesse retenait chez elle.
Je l'aperÁus pour la premiŤre fois au bal chez le duc de Wellington;
elle me parut infiniment mieux que je ne m'y attendais.
Sa taille, quoique petite, ťtait agrťable; ses bras, ses mains, son
col, ses ťpaules d'une blancheur ťclatante et d'une forme gracieuse;
son teint beau et sa tÍte ornťe d'une forÍt de cheveux blond cendrť
admirables. Tout cela ťtait portť par les deux plus petits pieds qu'on
pŻt voir. Lorsqu'elle s'amusait ou qu'elle parlait et que sa
physionomie s'animait, le dťfaut de ses yeux ťtait peu sensible; je
l'aurais ŗ peine remarquť si je n'en avais pas ťtť prťvenue.
Son ťtat l'empÍchait de danser; mais elle se promena plusieurs fois
dans le bal donnant le bras ŗ son mari. Elle n'avait ni gr‚ce, ni
dignitť.
Elle marchait mal et les pieds en dedans; mais ils ťtaient si jolis
qu'on leur pardonnait, et son air d'excessive jeunesse dissimulait sa
gaucherie. ņ tout prendre, je la trouvai bien. Son mari en paraissait
fort occupť ainsi que Monsieur (le comte d'Artois) et madame la
duchesse d'AngoulÍme. Quant ŗ monsieur le duc d'AngoulÍme, il s'y
trouvait si mal ŗ son aise que, dŤs qu'il entrait dans un salon, sa
seule pensťe ťtait le dťsir d'en sortir et qu'il n'y restait jamais
plus d'un quart d'heure, se contentant de faire acte de prťsence quand
cela ťtait indispensable.
Madame la duchesse de Berry ťtait arrivťe en France complŤtement
ignorante sur tout point. Elle savait ŗ peine lire. On lui donna des
maÓtres. Elle aurait pu en profiter, car elle avait de l'esprit
naturel et le sentiment des beaux-arts; mais personne ne lui parla
raison, et, si on chercha ŗ lui faire apprendre ŗ ťcorcher un clavier
ou ŗ barbouiller une feuille de papier, on ne pensa guŤre, en
revanche, ŗ lui enseigner son mťtier de princesse.
Son mari s'amusait d'elle comme d'un enfant et se plaisait ŗ la g‚ter.
Le Roi ne s'en occupait pas sťrieusement. Monsieur y portait sa
facilitť accoutumťe. Madame la duchesse d'AngoulÍme, seule, aurait
voulu la diriger, mais elle y mettait des formes acerbes et
dominatrices.
Madame la duchesse de Berry commenÁa par la craindre, et bientŰt la
dťtesta. Madame la duchesse d'AngoulÍme ne fut pas longtemps en reste
sur ce sentiment que monsieur le duc de Berry combattit faiblement;
car, tout en rendant justice aux vertus de sa belle-soeur, il n'avait
aucun goŻt pour elle. Menant, d'ailleurs, une vie plus que lťgŤre, il
ne se souciait pas de contrarier sa femme et lui soldait en
complaisances les torts qu'il avait d'un autre cŰtť.
C'ťtait un bien mauvais calcul pour tous deux, car la petite princesse
avait fini par devenir aussi exigeante que maussade. Son mari lui
rťpťtait sans cesse qu'elle ne devait faire que ce qui l'amusait et
lui plaisait, ne se gÍner pour personne et se moquer de ce qu'on en
dirait. De toutes les leÁons qu'on lui prodiguait, c'ťtait celle dont
elle profitait le plus volontiers et dont elle ne s'est guŤre ťcartťe.
Il ťtait curieux de lui voir tenir sa Cour, ricanant avec ses dames et
n'adressant la parole ŗ personne. Il n'y a pas de pensionnaire qui ne
s'en fŻt mieux tirťe, et pourtant, je le rťpŤte, il y avait de
l'ťtoffe dans madame la duchesse de Berry. Une main habile en aurait
pu tirer parti. Rien de ce qui l'entourait n'y ťtait propre, exceptť
peut-Ítre la duchesse de Reggio, sa dame d'honneur; mais elle n'avait
aucun crťdit. Cette nomination avait fait honneur au bon jugement de
monsieur le duc de Berry et ŗ la sagesse du Roi.
Madame la marťchale Oudinot, duchesse de Reggio, reprťsentait le
rťgime impťrial ŗ la nouvelle Cour d'une faÁon si convenable et si
digne que personne n'osait se plaindre de la situation oý on l'avait
placťe, quoique les charges de Cour excitassent particuliŤrement
l'envie du parti royaliste qui les regardait comme sa propriťtť
exclusive.
Il avait fallu ŗ la duchesse beaucoup de tact et d'esprit pour fonder
sa position dans un monde tout nouveau et tout hostile. Elle y avait
rťussi sans aucune assistance, car le marťchal Oudinot, brave soldat
s'il en fut, ne savait que jouer, fumer, courir les petites filles et
faire des dettes. Il fallait donc que sa femme eŻt de la considťration
pour deux et elle y rťussissait. Ajoutons que le marťchal avait de
grands enfants d'une premiŤre femme dont elle avait su se faire
adorer.
Il aurait ťtť bien heureux qu'elle prit de l'ascendant sur madame la
duchesse de Berry; cela n'arriva pas. La duchesse de Reggio lui
inspirait du respect; elle avait recours ŗ elle pour rťparer ses
gaucheries, mais elle la gÍnait: elle n'avait pas de confiance en elle
et, ŗ proportion que sa conduite est devenue plus lťgŤre, elle s'en
est ťloignťe davantage.
Je ne comptais rester que peu de semaines ŗ Paris; un ťvťnement de
famille m'y retint plus longtemps que je n'avais prťsumť. J'avais
trouvť mon frŤre en grande coquetterie avec mademoiselle DestilliŤres.
Nous l'avions connue dans sa trŤs petite enfance. Elle ťtait
ravissante et ma mŤre en raffolait. Il paraÓt que, dŤs lors, elle
disait ne vouloir ťpouser que monsieur d'Osmond.
La mort de ses parents l'avait laissťe hťritiŤre d'une immense fortune
et maÓtresse de son sort. Sa main ťtait demandťe par les premiers
partis de France, et mon frŤre ne songeait point ŗ se mettre sur les
rangs; mais elle lui fit de telles avances qu'il en devint sincŤrement
ťpris et s'engagea, quoique avec rťticence, dans le bataillon des
prťtendants. Elle ne l'y laissa pas longuement dans la foule. Au bout
de peu de temps, elle l'autorisa ŗ charger mon pŤre de la demander en
mariage, pour la forme, ŗ son oncle qui ťtait son tuteur mais dont
elle ne dťpendait en aucune faÁon.
Cet oncle s'ťtait accoutumť ŗ l'idťe qu'elle resterait fille et qu'il
continuerait ŗ disposer de sa fortune. Ce sort lui paraissait assez
doux pour en souhaiter la prolongation indťfinie. Ainsi, loin de
combattre les rťpugnances de mademoiselle DestilliŤres ŗ accepter les
partis qu'on lui avait jusqu'alors proposťs, il cherchait ŗ les
accroÓtre en lui faisant insinuer, par des personnes ŗ sa dťvotion,
que sa santť, trŤs dťlicate, lui rendait le cťlibat nťcessaire.
Lors donc que la lettre _officielle_ de mon pŤre lui fut remise, par
un ami commun, monsieur de Bongard articula trŤs poliment un refus
absolu et alla rendre compte ŗ sa niŤce de la demande et de la
rťponse, fondťe, comme ŗ l'ordinaire, sur ce qu'elle ne voulait pas se
marier.
ęVous vous Ítes trompť, mon oncle, je ne voulais pas ťpouser les
autres; mais je veux ťpouser monsieur d'Osmond.Ľ
Monsieur de Bongard pensa tomber ŗ la renverse. Il fallut bien
reprendre ses paroles, mais tous ses soins furent employťs ŗ retarder
le mariage. Soit qu'il se flatt‚t de quelque circonstance qui pŻt le
faire rompre, soit qu'il eŻt besoin d'un long intervalle pour
rťgulariser l'illťgalitť de la gestion de sa tutelle, portťe ŗ un
point fabuleux autant, je crois, par incurie que par malversation, il
ťpuisait tous les prťtextes pour gagner du temps.
Les jeunes gens, en revanche, ťtaient trŤs pressťs et me demandaient
de rester de jour en jour, prťtendant que mon dťpart fournirait un
argument de plus ŗ monsieur de Bongard pour ťloigner la noce. Il en
vint pourtant ŗ ses fins, car le mariage, arrangť au mois de fťvrier
et qui devait, s'accomplir le premier, le dix, le vingt de chaque
mois, n'eut lieu qu'en dťcembre.
Quoique le mariage de mademoiselle DestilliŤres fŻt de toutes les
nouvelles du jour celle qui m'intťressait le plus, je m'occupais
encore cependant des ťvťnements publics; et je fus trŤs consternťe, un
matin, en apprenant que le roi Louis XVIII ťtait trŤs mal. Il donna de
vives inquiťtudes pendant un moment.
La loi d'ťlection se discutait ŗ la Chambre des dťputťs. Les princes
ťtaient en opposition directe au gouvernement, car alors le cabinet
ťtait composť de gens raisonnables. Monsieur le duc de Berry ameutait
contre la loi et, dans une soirťe chez lui, cabala tout ouvertement
pour grossir l'opposition. Le Roi en fut informť, le fit appeler, et
le tanÁa vertement.
Monsieur le duc de Berry se plaignit ŗ son pŤre et ŗ sa belle-soeur.
Ils mirent en commun leurs griefs, s'ťchauffŤrent les uns les autres,
et enfin, le soir aprŤs le dÓner, Monsieur, portant la parole, les
exposa durement au Roi. Le Roi rťpondit vivement. Madame et le duc de
Berry s'en mÍlŤrent; la querelle s'exalta ŗ tel point que Monsieur dit
qu'il quitterait la Cour avec ses enfants.
Le Roi rťpondit qu'il y avait des forteresses pour les princes
rebelles. Monsieur rťpliqua que la charte n'admettait pas de prison
d'…tat (car cette pauvre charte est invoquťe par ceux qui l'aiment le
moins) et on se quitta sur ces termes amicaux. Monsieur le duc
d'AngoulÍme avait seul gardť un complet silence. Le respect dŻ au pŤre
rachetait en lui le respect dŻ au Roi, de faÁon qu'il se serait fait
scrupule de donner tort ou raison ŗ aucun des deux.
La colŤre une fois passťe, tous furent f‚chťs de la violence des
paroles. Le pauvre Roi pleurait le soir en en parlant ŗ ses ministres;
mais cette scŤne l'avait tellement ťprouvť qu'elle avait arrÍtť la
digestion de son dÓner. La goutte dans l'estomac s'y ajouta; il pensa
ťtouffer dans la nuit et, pendant plusieurs jours consťcutifs, il fut
assez mal.
Ce fut une occasion pour sa famille de lui tťmoigner une affection ŗ
laquelle il feignait de croire pour acquťrir un peu de repos, mais
dont il faisait peu d'ťtat. Le public savait aussi bien que le Roi
l'opposition des princes; et la plaisanterie du moment ťtait d'appeler
les boules noires mises au scrutin les _prunes de Monsieur_.
Je m'applique ŗ ne point parler des ťvťnements connus sur lesquels je
ne sais aucun dťtail particulier. Ainsi je ne dirai rien de la
reprťsentation de _Germanicus_, tragťdie de monsieur Arnault, alors
proscrit de France, qui exalta au dernier degrť les passions des
partis impťrialiste et royaliste.
Les sages prťcautions prises par l'autoritť pour empÍcher une
collision entre les jeunes gens de l'ancienne armťe et les gardes du
corps leur parurent ŗ tous entachťes de partialitť, et les deux partis
se proclamŤrent lťsťs et persťcutťs par l'autoritť. On pourrait
peut-Ítre en conclure qu'elle avait ťtť seulement sage et paternelle;
mais les hommes, quand ils sont animťs par la passion, ne jugent pas
si froidement et la fermentation ťtait restťe grande.
C'est dans ce moment que je reÁus de Londres le premier exemplaire du
_Manuscrit de Sainte-HťlŤne_. Je le lus avec un extrÍme intťrÍt; mais
je me rappelle avoir mandť ŗ ma mŤre qu'il arrivait trop ŗ propos et
rťpondait trop bien aux passions du moment pour me permettre de croire
ŗ son authenticitť. C'ťtait le manifeste du parti bonapartiste tel
qu'il existait en ce moment ŗ Paris, et il ťtait presque impossible de
penser que, tracť au delŗ de l'Atlantique, il pŻt arriver prťcisťment
ŗ l'instant opportun. Au reste, il me parut tellement propre ŗ servir
de mŤche que je ne voulus prendre aucune part ŗ faciliter l'explosion.
Ce livre, renfermť sous clef, ne sortit pas de chez moi et je n'en
soufflai mot.
Le surlendemain, madame de Duras me demanda si mes lettres de Londres
parlaient d'un ťcrit de l'Empereur. Je rťpondis hardiment que non. Au
bout d'une dizaine de jours, je reÁus un petit billet d'elle pour me
recommander de ne pas manquer ŗ venir passer la soirťe chez elle. J'y
trouvai une cinquantaine de personnes rťunies, la table, les bougies,
le verre d'eau sucrťe de rigueur pour le lecteur; on allait commencer.
Quoi? le _Manuscrit de Sainte-HťlŤne_! La mÍme reprťsentation se
renouvela le lendemain chez la duchesse d'Escars.
Pendant ces soirťes, j'ťtais poursuivie d'une idťe que je ne pouvais
chasser. Je voyais Bonaparte apprenant que, chez le marťchal Duroc,
une troupe de chambellans et de dames du palais ťtaient rťunis pour
entendre et se passionner du rťcit bien pathťtique de l'expulsion de
Louis XVIII de Mitau, des gardes du corps pleurant sur ses mains, de
Madame leur distribuant ses diamants pour les empÍcher de mourir de
faim, de leur vieux Roi les bťnissant, de l'abbť Marie quittant
volontairement un monde oý l'injustice seule triomphait, etc., et
toute la sociťtť impťrialiste, ťmue jusqu'aux larmes, surprise par
l'entrťe de l'Empereur au milieu d'elle!
Quelles auraient ťtť ses frayeurs! Comme Vincennes aurait ťtť peuplť
le lendemain! Au reste, personne ne s'y serait risquť. Gr‚ce au ciel,
et honneur en soit rendu ŗ la Restauration, la lecture, chez les dames
que je viens de citer, pouvait Ítre dťplacťe, inconvenante, dangereuse
mÍme pour le pays; mais elle ne pouvait troubler la sťcuritť de ceux
qui y assistaient.
Jamais aucune publication, de mon temps, n'a fait autant d'effet. Il
n'ťtait plus permis d'ťlever un doute sur son authenticitť, et, plus
on avait approchť l'Empereur, plus on soutenait l'ouvrage de lui.
Monsieur de Fontanes reconnaissait chaque phrase. Monsieur Molť
entendait le son de sa voix disant ces mÍmes paroles. Monsieur de
Talleyrand le voyait les ťcrire. Le marťchal Marmont retrouvait des
expressions de leur mutuelle jeunesse dont lui seul avait pu se
servir, etc. Et tous et chacun ťtaient ťlectrisťs par cette ťmanation
directe du grand homme.
Je finis par me laisser persuader, tout en conservant mon ťtonnement
de l'ŗ-propos de la publication: tant de gens plus compťtents
affirmaient reconnaÓtre l'auteur qu'il y aurait eu de l'obstination ŗ
en douter.
Je restais persuadťe de l'inopportunitť de ces lectures. Toutefois,
les gens qui s'y prÍtaient ťtaient de nature ŗ lever tous les
scrupules que j'avais conÁus.
Je possťdais deux exemplaires de la brochure, et je trouvai qu'il n'y
avait plus que de la dťsobligeance ŗ les tenir enfermťs. Je les prÍtai
donc et ne tardai pas ŗ m'en repentir, car chaque matin je recevais
vingt billets qui me les demandaient. On se faisait inscrire ŗ tour de
rŰle pour les obtenir.
Aucune mystification n'a eu un succŤs plus complet ni plus utile ŗ un
parti. La semi-publicitť ajoutait tout le prix de la mode et du fruit
dťfendu ŗ un ouvrage devenu une sorte de manifeste; et les lectures
faites en commun, appelant cette espŤce d'ťlectricitť que les hommes
rťunis exercent les uns sur les autres, le rendaient d'autant plus
propre ŗ exciter toutes les passions. Je n'ai jamais assistť ŗ une de
ces reprťsentations dans une sociťtť impťrialiste; mais, ŗ en juger
par l'effet qu'elles faisaient dans nos salons bourbonniens, on peut
supposer qu'elles remuaient profondťment les ‚mes, exaltaient toutes
les haines et tous les regrets.
Le manuscrit de Sainte-HťlŤne restera au moins fameux dans les
cabinets des bibliophiles comme contrefaÁon. Il est de monsieur
Bertrand de Novion qui n'a aucune autre rťputation littťraire, n'a
jamais vu l'Empereur de prŤs et n'a eu de rapports avec lui que
pendant les Cent-Jours.
Je sais bien que, depuis que l'auteur est connu, on a beaucoup dit
qu'il ťtait impossible de s'y mťprendre; mais, au moment oý cette
brochure parut, il ťtait encore plus impossible d'ťlever un doute sans
se faire lapider.
(_Note de 1841_).--AprŤs avoir profitť vingt-cinq ans du succŤs de
cette publication et en avoir mÍme reÁu le salaire, monsieur Bertrand
de Novion vient d'en restituer l'honneur ŗ son vťritable auteur,
monsieur de Ch‚teauvieux. J'avais eu rťvťlation de son nom dans le
temps; mais les habitudes, les relations, les opinions de monsieur de
Ch‚teauvieux, toutes hostiles ŗ l'Empire, m'avaient ťloignťe d'y
attacher aucune importance. Il faut son assertion, la reproduction du
manuscrit ťcrit de sa main et l'aveu de monsieur Bertrand de Novion
pour y croire ŗ l'heure qu'il est.
CHAPITRE IX
Monsieur de VillŤle. -- Intrigue de Cour pour ramener monsieur de
Blacas. -- La duchesse de Narbonne. -- Martin et la soeur
Rťcolette. -- Arrivťe de monsieur de Blacas. -- Dťjeuner aux
Tuileries. -- La petite chienne de Madame. -- Sagesse de monsieur
le duc d'AngoulÍme. -- Agitation des courtisans. -- Trouble de
monsieur Molť. -- Bonne contenance de monsieur Decazes. -- Dťlais
multipliťs de monsieur de Blacas. -- Il est congťdiť par le Roi.
L'exaltation des bonapartistes, loin de calmer, servait mÍme de
stimulant ŗ celle des ultras. Ils accusaient la longanimitť du Roi et
la modťration du ministŤre. Selon eux, de sťvŤres rťpressions, des
procŤs, des condamnations, des ťchafauds, mais surtout des
destitutions auraient assis la Restauration sur des bases bien
autrement solides.
Monsieur de Chateaubriand avait, depuis longtemps, fait paraÓtre sa
_Monarchie selon la charte_ ou il ne demandait que sept hommes dťvouťs
par dťpartement, au nombre desquels il plaÁait le grand prťvŰt, et la
libertť de la presse avec la peine de mort largement affectťe ŗ ses
dťlits. Ces concessions paraissaient encore trop libťrales aux ultras,
et il ťtait obligť de modifier ses doctrines pour rester un de leurs
chefs. ņ plus petit bruit, il s'en ťlevait un autre bien moins
brillant mais plus habile, monsieur de VillŤle.
Son humble origine, ses formes vulgaires, sa tournure hťtťroclite, sa
voix nasillarde le tenaient encore ťloignť des salons; mais il
commenÁait ŗ avoir une grande influence ŗ la Chambre des dťputťs et ŗ
grouper autour de lui le bataillon de l'opposition ultra. Toutefois,
la Cour n'ťtait pas d'humeur ŗ attendre les rťsultats des manoeuvres
constitutionnelles et elle en prťpara une pour son compte.
Depuis le mariage de madame la duchesse d'AngoulÍme, madame de Sťrent
et ses deux filles, les duchesses de Damas et de Narbonne, ťtaient
restťes constamment auprŤs d'elle. Madame de Narbonne avait tout
l'esprit que sa soeur croyait possťder. Le roi Louis XVIII n'avait pas
manquť de saisir la diffťrence qui existait entre le prťtentieux bel
esprit de madame de Damas et la distinction de bon aloi de madame de
Narbonne. Il avait pris ŗ Hartwell l'habitude de causer assez
confidentiellement avec cette derniŤre. Il aimait la sociťtť des
femmes spirituelles; madame de Balbi lui en avait donnť le goŻt.
Les deux soeurs ťtaient, quoique ŗ des degrťs diffťrents, liťes avec
monsieur de Blacas. Son absence affligeait l'une et dťplaisait ŗ
l'autre qui se voyait privťe du crťdit qu'elle exerÁait pendant son
ministŤre. Tant que monsieur de Blacas avait ťtť tout-puissant prŤs du
Roi, Monsieur et Madame l'avaient en horreur. Son expulsion les avait
charmťs. Mais _mal passť n'est que songe_; on dťtestait encore plus
les ministres prťsents.
Le favoritisme du bourgeois et impťrialiste Decazes fit regretter le
noble et ťmigrť Blacas. Avec celui-lŗ du moins, on s'entendait sur
bien des points et la langue ťtait commune. Madame de Narbonne n'eut
donc pas grand'peine ŗ faire reconnaÓtre aux princes qu'ils avaient
beaucoup perdu au change. Restait ŗ ramener le Roi ŗ ses anciennes
prťfťrences; elle entreprit de l'accomplir.
Louis XVIII, homme du temps de sa jeunesse, ťtait, en matiŤre de
religion, philosophe du dix-huitiŤme siŤcle. Les pratiques auxquelles
il s'astreignait trŤs exactement n'ťtaient pour lui que de pure
ťtiquette. Toutefois, malgrť son scepticisme ťtabli, il ne manquait
pas d'une sorte de superstition. Il croyait, assez volontiers, que, si
le bon Dieu existait et qu'il s'occup‚t de quelque chose, ce devait
Ítre sans aucun doute du chef de la maison de Bourbon.
Madame de Narbonne profita de l'accŤs qu'elle avait auprŤs de lui pour
lui parler d'une certaine soeur Marthe, religieuse, et d'un
cultivateur des environs de Paris, nommť Martin, qui, tous deux,
avaient des visions tellement ťtranges par leur importance et leur
similitude qu'elle se faisait un devoir d'en avertir le Roi.
Dťjŗ, selon elle, toutes les consciences timorťes ťtaient bouleversťes
par ces dťnonciations de l'abÓme vers lequel on s'avanÁait. Elle
revint plusieurs fois ŗ la charge; le Roi consentit ŗ voir la soeur
Marthe. Bien stylťe, probablement par les entours immťdiats du Roi,
elle lui fit des rťvťlations intimes sur son passť, et parla comme il
le fallait, pour le prťsent et l'avenir. Le Roi fut ťbranlť.
Madame de Narbonne manda ŗ monsieur de Blacas, alors ambassadeur ŗ
Rome, de venir sur-le-champ n'importe sous quel prťtexte; elle ťtait
autorisťe ŗ lui promettre l'appui des princes et elle ne doutait pas
de son succŤs auprŤs du Roi.
En consťquence, un beau matin un valet de chambre du Roi, trŤs dťvouť
ŗ monsieur de Blacas, remit ŗ Sa Majestť, en entrant dans sa chambre,
un billet de monsieur de Blacas. Ne pouvant plus rťsister au besoin de
son coeur, il ťtait arrivť ŗ Paris uniquement pour voir le Roi, le
regarder, entendre sa voix, se prosterner ŗ ses pieds et repartir,
ayant fait provision de bonheur pour quelques mois.
Monsieur de Blacas avait trop spťculť sur la faiblesse qu'il
connaissait ŗ Louis XVIII du besoin d'Ítre aimť pour lui-mÍme. Le Roi
rťpondit sŤchement et verbalement:
ęJe ne reÁois les ambassadeurs que conduits par le ministre des
affaires ťtrangŤres.Ľ
Monsieur de Blacas se trouva donc forcť d'aller d'abord chez le duc de
Richelieu. Fort ťtonnť de voir entrer un ambassadeur qu'il croyait ŗ
Rome, il ne douta pas que Louis XVIII ne l'eŻt mandť. Il lui demanda
s'il avait vu le Roi.
ęMais non, reprit monsieur de Blacas, vous pensez bien que je ne m'y
serais pas prťsentť sans vous.Ľ
Cette dťfťrence inattendue parut singuliŤre au duc qui, malgrť toute
sa loyautť, dťmÍlait bien une intrigue au fond de ce retour inopinť.
Il fut confirmť dans cette opinion lorsqu'en arrivant le Roi ne
tťmoigna aucune surprise de voir monsieur de Blacas, et la froideur
qu'il lui montra ne lui parut qu'un jeu concertť entre eux. Monsieur
de Blacas, en jugea autrement, et comprit, dŤs lors, qu'il avait ťtť
mal conseillť.
Le Roi dÓnait toujours exclusivement avec la famille royale; mais les
dťjeuners se passaient plus sociablement aux Tuileries, hormis pour
Monsieur qui prenait seul, chez lui, sa tasse de chocolat. Monsieur le
duc d'AngoulÍme dťjeunait avec son service du jour, le duc de Damas et
le duc de Guiche. Monsieur le duc de Berry ajoutait aux personnes de
sa maison celles de sa familiaritť et souvent mÍme faisait des
invitations de politesse.
Le Roi avait tous les matins une table de vingt couverts. En outre du
service du jour, les grandes charges de la maison y assistaient quand
elles voulaient, toujours sans invitation. Madame la duchesse
d'AngoulÍme, accompagnťe de la dame de service, dťjeunait chez son
oncle. Messieurs de Richelieu et de Blacas avaient le droit de
s'asseoir ŗ cette table, en leur qualitť, de premier gentilhomme de la
chambre et de premier maÓtre de la garde-robe; car, comme ministre et
ambassadeur, ils n'y auraient pas ťtť admis, et le Roi aurait passť
dans la salle ŗ manger sans leur dire de le suivre.
Leur audience avait eu lieu peu avant l'heure du dťjeuner; ils
accompagnaient le Roi lorsqu'il entra dans le salon oý les convives se
trouvaient assemblťs. La surprise ťgala le malaise en voyant monsieur
de Blacas qu'on croyait ŗ Rome. On cherchait ŗ lire sur la figure du
Roi l'accueil qu'il lui fallait faire, mais sa physionomie ťtait
impassible. La prťsence de monsieur de Richelieu gÍnait aussi ceux qui
auraient voulu montrer les espťrances que peut-Ítre ils ressentaient.
Tout le monde, selon l'usage, ťtait rťuni lorsque Madame arriva
prťcťdťe d'une petite chienne que monsieur de Blacas lui avait
autrefois donnťe; celle-ci sauta autour de son ancien protecteur et le
combla de caresses.
ęCette pauvre Thisbť, dit le Roi, je lui sais grť de si bien vous
reconnaÓtre.Ľ
Le duc d'Havrť se pencha ŗ l'oreille de son voisin et lui dit:
ęIl faut faire comme Thisbť, il n'y a pas ŗ hťsiter.Ľ
Et monsieur de Blacas fut entourť des plus affectueuses
dťmonstrations. Madame ne montra pas plus de surprise que le Roi, mais
accueillit monsieur de Blacas avec grande bienveillance. Il y a ŗ
parier qu'elle n'ignorait pas l'intrigue qui se manoeuvrait.
Monsieur le duc d'AngoulÍme dťjeunait plus tard que le Roi, et la
princesse en sortant de chez son oncle venait toujours assister ŗ la
fin de son repas oý elle mangeait, toute l'annťe, une ou deux grappes
de raisin.
Ce jour-lŗ elle raconta l'arrivťe de monsieur de Blacas. ęTant pisĽ,
rťpondit sŤchement monsieur le duc d'AngoulÍme. Elle ne rťpliqua pas.
Mon frŤre, qui, en sa qualitť d'aide de camp, dťjeunait chez son
prince, fut frappť de l'idťe qu'il y avait dissidence dans le royal
mťnage sur cet ťvťnement.
Au reste, cela arrivait trŤs habituellement. Monsieur le duc
d'AngoulÍme rendait une espŤce de culte ŗ sa femme qui avait pour lui
la plus tendre affection, mais ils ne s'entendaient pas en politique.
Sous ce rapport, Madame ťtait bien plus en sympathie avec Monsieur, et
ni l'un ni l'autre n'exerÁaient d'influence sur monsieur le duc
d'AngoulÍme.
Lorsque Madame commenÁait une de ses diatribes d'ultra-royalisme, il
l'arrÍtait tout court:
ęMa chŤre princesse (c'est ainsi qu'il l'appelait) ne parlons pas de
cela; nous ne pouvons nous entendre ni nous persuader rťciproquement.Ľ
Aussi toutes les intrigues du parti s'arrÍtaient-elles devant la
sagesse de monsieur le duc d'AngoulÍme qui refusait constamment de
tťmoigner aucune opposition au gouvernement du Roi. Elles trouvaient,
en revanche, des auxiliaires bien actifs dans les autres princes et
leurs entours, y compris ceux du Roi.
La nouvelle de l'arrivťe de monsieur de Blacas fit grand bruit, comme
on peut penser. Je sus promptement le peu d'ťtonnement tťmoignť par le
Roi, l'histoire de Thisbť et le _tant pis_ de monsieur le duc
d'AngoulÍme. Selon le parti auquel on appartenait, on brodait le fond
de diverses couleurs.
Les courtisans avaient remarquť qu'aprŤs le dťjeuner monsieur de
Blacas ayant parlť bas au Roi, il avait rťpondu tout haut de sa voix
sťvŤre:
ęC'est de droit, vous n'avez pas besoin de permission.Ľ
On sut qu'il s'agissait de s'installer dans l'appartement du premier
maÓtre de la garde-robe aux Tuileries. Cet appartement, arrangť pour
monsieur de Blacas dans le plus fort de sa faveur, communiquait avec
celui du Roi par l'intťrieur.
On se rappela que le major gťnťral de la garde y avait ťtť logť
provisoirement pendant qu'on travaillait ŗ son appartement, mais que
les rťparations avaient ťtť poussťes avec un redoublement d'activitť
depuis quelque temps; et que, deux jours avant, il avait pu
s'installer [chez lui] et laisser libre l'appartement de monsieur de
Blacas. J'avoue que cette circonstance, de la facilitť des
communications, me parut grave. La franchise du monarque n'ťtait pas
assez bien ťtablie pour que la froideur de la rťception sembl‚t tout ŗ
fait rassurante.
Monsieur de Blacas affecta de passer la matinťe tout entiŤre au Salon
du Louvre oý il y avait alors exposition de tableaux; il ne parla pas
d'autre chose pendant le dÓner chez le duc d'Escars. Il jeta en avant
quelques phrases qui indiquaient le projet d'un prompt dťpart pour
Rome.
TrŤs anxieuse de savoir ce qui se passait, j'allai le soir chez
monsieur Decazes. Le mÍme sentiment y avait amenť quelques personnes,
la malice quelques autres, la curiositť encore davantage, si bien
qu'il y avait foule. Tous les esprits y paraissaient fort agitťs,
hormis celui du maÓtre de la maison. Lui semblait dans son assiette
naturelle.
Je n'en pourrais dire autant de monsieur Molť, alors ministre de la
marine; il ťtait dans un trouble impossible ŗ dissimuler. Je le vois
encore assis sur un petit sopha, dans le recoin d'une cheminťe, et
avanÁant un ťcran sous prťtexte de se dťfendre de la lumiŤre, mais
ťvidemment pour ťviter les regards ŗ sa figure renversťe.
Ordinairement monsieur Decazes n'allait pas faire sa visite
quotidienne au Roi les jours de ses rťceptions; cette fois il
s'ťchappa de son salon. Peu aprŤs, quelqu'un (monsieur de Boisgelin,
je crois), arrivant de l'ordre, me raconta que monsieur de Blacas,
reprenant ses anciennes habitudes, avait suivi le Roi dans son
intťrieur lorsqu'il y ťtait rentrť.
L'absence du ministre de la police ne fut pas longue; son attitude
ťtait parfaitement calme au retour; et je fis la remarque qu'avec
moins d'esprit de conversation et bien moins d'ťlťgance de formes que
monsieur Molť il avait, dans cette occasion, beaucoup plus le maintien
d'un homme d'…tat. Le monde s'ťtant ťcoulť, je m'approchai de lui et
je lui dis:
ęQue dois-je mander demain ŗ mon pŤre? le courrier part.
--Que je suis son plus dťvouť serviteur, aussi bien que le vŰtre.
--Vous savez bien que ce n'est pas vaine curiositť qui me fait faire
cette demande. Les gazettes ultras vont entonner la trompette;
rťpondez-moi sťrieusement ce qu'il convient de dire ŗ l'ambassadeur.
--Hť bien, sťrieusement, mandez-lui que monsieur de Blacas est arrivť
aujourd'hui vendredi de Rome ŗ Paris et qu'il repartira jeudi de Paris
pour Rome.
--Jeudi! et pourquoi pas demain?
--Parce que ce serait faire un ťvťnement de ce voyage et qu'il vaut
infiniment mieux qu'il reste un ridicule.
--Je comprends la force de cet argument, mais ne craignez-vous pas de
voir prolonger la facilitť de ces communications entre les deux
appartements?
--Je ne crains rien; faites comme moi.Ľ
Et il accompagna ces derniers mots d'un sourire pas mal arrogant.
J'avoue que j'ťtais loin de partager sa sťcuritť, connaissant la
faiblesse du Roi et la cabale qui l'entourait. Toutefois, monsieur
Decazes avait raison. Le Roi ťtait capable d'intriguer contre ses
ministres, mais il se serait fait scrupule de faire infidťlitť ŗ ses
favoris. Toutes les fois qu'ils lui ont ťtť enlevťs, c'est par force
majeure et jamais il n'en avait ťtť complice.
Au dťjeuner du lendemain, le Roi affecta de parler du dťsir qu'il
avait que le temps s'adoucÓt pour rendre le retour de monsieur de
Blacas [plus agrťable]. Au moment oý on allait se sťparer, il lui dit
tout haut:
ęComte de Blacas, si vous avez ŗ me parler ce soir, venez avant
l'ordre; aprŤs, c'est l'heure du ministre de la police.Ľ
Or, la famille royale quittait le Roi ŗ huit heures; l'ordre ťtait ŗ
huit heures un quart, ainsi le tÍte-ŗ-tÍte ne pouvait se prolonger
d'une faÁon bien intime.
Monsieur de Blacas s'inclina profondťment, mais on sentit le coup et,
dans ce moment, Thisbť l'aurait caressť sans trouver d'imitateurs.
Nťanmoins le parti dit du pavillon de Marsan, toujours prompt ŗ se
flatter, affirmait et croyait peut-Ítre qu'il y avait un dessous de
carte, que les froideurs n'ťtaient qu'apparentes, qu'une faveur intime
en dťdommageait et ferait prochainement explosion.
Je le croyais un peu, et surtout lorsque, la veille du jour fixť pour
son dťpart, monsieur de Blacas se dťclara malade. Il garda sa chambre
quarante-huit heures, puis reparut avec une extinction de voix qui ne
permettait pas d'entreprendre un grand voyage. Il gagna une dizaine de
jours par divers prťtextes. Le dernier qu'il employa fut le dťsir
d'accompagner le Roi dans la promenade du 3 mai, anniversaire de son
entrťe ŗ Paris. Il parcourait les rues en calŤche, sous la seule
escorte de la garde nationale; cela plaisait ŗ la population.
Monsieur de Blacas espťrait que le droit de sa charge le placerait
dans la voiture du Roi; mais celui-ci fit un grand travail d'ťtiquette
pour lui enlever cette satisfaction. Je ne me rappelle plus quelle en
fut la manoeuvre, mais monsieur de Blacas ne figura que dans une
voiture de suite. En rentrant, le Roi s'arrÍta ŗ la porte de son
appartement, et, la tenant lui-mÍme ouverte, ce qui ťtait sans
exemple, il dit bien haut:
ęAdieu, mon cher Blacas, bon voyage, ne vous fatiguez pas en allant
trop vite; je recevrai avec plaisir de vos nouvelles de Rome.Ľ
Et _pan_, il frappa la porte ŗ la figure du comte qui s'apprÍtait ŗ le
suivre. Monsieur de Blacas, trŤs dťconcertť de la briŤvetť de ce congť
amical, partit le soir.
Le rťsultat de ce voyage fut de faire nommer un ministre de la maison
du Roi. Sans en Ítre prťcisťment titulaire, monsieur de Blacas en
touchait les appointements, en conservait le patronage; et la charge
ťtait faite par un homme ŗ sa dťvotion, monsieur de Pradel. En
revanche, quelque temps aprŤs, il fut fait duc et premier gentilhomme
de la chambre.
L'intrigue ayant manquť, on ne s'occupa plus alors de Martin, d'autant
que le Roi l'avait fait remettre entre les mains de monsieur Decazes.
Il passa quelques semaines ŗ Charenton sans que les mťdecins osassent
affirmer dans son exaltation un ťtat de folie constatťe.
On le renvoya dans son village d'oý la Congrťgation l'a ťvoquť
plusieurs fois depuis. Une de ses principales visions portait sur
l'existence de Louis XVII dont, de temps en temps, on voulait effrayer
la famille royale. Il ŗ ťtť question de lui pour la derniŤre fois
pendant le sťjour de Charles X ŗ Rambouillet, en 1830.
Je ne sais si ce fut tout ŗ fait volontairement que la duchesse de
Narbonne alla rejoindre son mari qu'elle avait fait nommer ambassadeur
ŗ Naples. Le rŰle actif qu'elle venait de jouer dans cette intrigue
Blacas avait dťplu au Roi, plus encore ŗ monsieur Decazes; et,
quoiqu'il n'y eŻt plus d'exil sous le rťgime de la Charte, on sut
gťnťralement qu'elle avait reÁu l'ordre de ne point paraÓtre ŗ la Cour
et le conseil de s'ťloigner.
CHAPITRE X
Faveur de monsieur Decazes. -- Son genre de flatterie. --
Affaires de Lyon. -- Le duc de Raguse apaise les esprits. --
Discours de monsieur Laffitte. -- Monsieur le duc d'Orlťans
revient ŗ Paris. -- Histoire inventťe sur ma mŤre. -- Ma colŤre.
-- Arrivťe de toute la famille d'Orlťans. -- Dťjeuner au
Palais-Royal. -- Calomnies absurdes.
Le favoritisme de monsieur Decazes se trouva mieux ťtabli que jamais.
Le Roi ne voyait que par ses yeux, n'entendait que par ses oreilles,
n'agissait que par sa volontť.
Les souverains ne se gouvernent guŤre que par la flatterie. Louis
XVIII ťtait trop accoutumť ŗ celles des courtisans d'origine pour y
prendre grand goŻt; il en avait besoin pour lui servir d'atmosphŤre et
y respirer ŗ l'aise, mais elles ne suffisaient pas ŗ son imagination.
Sa fantaisie ťtait d'Ítre aimť pour lui-mÍme; c'ťtait le moyen employť
par tous les favoris prťcťdents, exceptť par madame de Balbi, je
crois, qui se contentait de se laisser adorer et ne se piquait que
d'Ítre aimable et d'amuser, sans feindre un grand sentiment.
Monsieur Decazes inventa un nouveau moyen de soutenir sa faveur; il se
reprťsenta comme l'ouvrage du Roi, non seulement socialement mais
politiquement. Il feignit d'Ítre son ťlŤve bien plus que son ministre.
Il passait des heures ŗ se faire endoctriner par lui. Il apprenait,
sous son royal professeur, les langues anciennes aussi bien que les
modernes, le droit, la diplomatie, l'histoire et surtout la
littťrature.
L'ťlŤve ťtait d'autant plus perspicace qu'il savait mieux que le
maÓtre ce qu'on lui enseignait; mais son ťtonnement de tout ce qu'on
lui dťcouvrait dans les sciences et les lettres ne tarissait jamais et
ne cťdait qu'ŗ la reconnaissance qu'il ťprouvait. De son cŰtť, le Roi
s'attachait chaque jour davantage ŗ ce brillant ťcolier qui, ŗ la fin
de la classe, lui faisait signer et approuver tout le contenu de son
portefeuille ministťriel; aprŤs avoir bien persuadť ŗ S. M. T. C. que
d'elle seule en ťmanaient toutes les volontťs.
L'espŤce de sentiment que le Roi portait ŗ monsieur Decazes
s'exprimait par les appellations qu'il lui donnait. Il le nommait
habituellement _mon enfant_, et les derniŤres annťes de sa faveur _mon
fils_. Monsieur Decazes aurait peut-Ítre supportť cette ťlťvation,
sans en avoir la tÍte trop tournťe, s'il n'avait ťtť excitť par les
impertinences des courtisans. Le besoin de rendre insolence pour
insolence lui avait fait prendre des formes hautaines et
dťsobligeantes qui, jointes ŗ sa lťgŤretť et ŗ sa distraction, lui ont
fait plus d'ennemis qu'il n'en mťritait.
On signala vers ce temps une conspiration ŗ Lyon qui donna de vives
inquiťtudes. L'agitation ťtait notoire dans la ville et les environs,
et les dťsordres imminents. On y envoya le marťchal Marmont muni de
grands pouvoirs. Les royalistes l'ont accusť d'avoir montrť trop de
condescendance pour les bonapartistes. Je n'en sais pas les dťtails.
En tout cas, il souffla sur ce fantŰme de conspiration; car, trois
jours aprŤs son arrivťe, tout ťtait rentrť dans la tranquillitť et il
n'en fut plus question.
Les troubles mieux constatťs de Grenoble avaient rapportť l'annťe
prťcťdente de si grands avantages au gťnťral Donnadieu que les
autoritťs de Lyon furent soupÁonnťes d'avoir fomentť les dťsordres
pour obtenir de semblables rťcompenses. La rťputation du gťnťra Canuel
rendait cette grave accusation possible ŗ croire; il pouvait aspirer ŗ
se montrer digne ťmule du gťnťral Donnadieu. Le prťfet de police,
homme peu estimť, s'ťtait rťuni ŗ lui pour entourer et ťpouvanter
monsieur de Chabrol, prťfet du dťpartement, qui n'agissait plus que
sous leur bon plaisir.
La vťritť sur la conspiration de Lyon est restťe un problŤme
historique. Les uns l'ont complŤtement niťe; les autres l'ont montrťe
tout ŗ fait flagrante. Probablement ni les uns ni les autres n'ont
complŤtement raison. Les opinions toujours vives dans cette ville, et
encore exaltťes depuis les Cent-Jours, ťtaient disposťes ŗ faire
explosion. Quelques excitations des chefs de parti, ou quelques
gaucheries de l'administration, pouvaient ťgalement amener des
catastrophes. Dans cette occasion, elles furent conjurťes par la
prťsence du marťchal.
Il recueillit pour salaire l'animadversion des deux partis et mÍme le
mťcontentement du gouvernement. Il le mťrita un peu par la publicitť
intempestive qu'il laissa donner aux ťvťnements dont il avait ťtť
tťmoin, en rejetant tout le bl‚me sur l'administration. Il crut mÍme
devoir personnellement certifier de leur exactitude. Au reste, j'ťtais
absente lorsque cela eut lieu; je ne sais qu'en gros les circonstances
de cet ťvťnement.
Les gťnťraux Donnadieu, Canuel et surtout Dupont, qui ont ťtť triťs
sur le volet par la Restauration comme gens de haute confiance,
ťtaient sous l'Empire trŤs peu considťrťs. Leur faveur a toujours fait
un fort mauvais effet dans l'armťe.
Les nťgociations pour le retour de monsieur le duc d'Orlťans avaient
rťussi; le prince ťtait venu seul t‚ter le terrain. Cette course avait
ťtť assez mal prťparťe par un discours d'un dťputť de l'opposition,
monsieur Laffitte, oý il avait fait entrer trŤs inconvenablement le
nom de Guillaume III d'Orange, de maniŤre ŗ soulever les clameurs de
tout le parti royaliste.
Malheureusement, monsieur le duc d'Orlťans s'ťtait dťjŗ annoncť et il
y aurait eu encore plus d'inconvťnient ŗ reculer devant ces cris qu'ŗ
les braver. Il arriva donc. Le Roi le reÁut avec sa maussaderie
accoutumťe, madame la dauphine poliment, Monsieur et ses deux fils
amicalement et madame la duchesse de Berry, qui se souvenait de
Palerme et ne l'avait pas vu depuis son mariage, avec une joie et une
affection (l'appelant _mon cher oncle_ ŗ chaque instant) qui la firent
gronder dans son intťrieur.
Elle pleura beaucoup ŗ la suite de cette visite et, depuis, ses faÁons
ont tout ŗ fait changť avec le prince qu'elle n'a plus appelť que:
Monseigneur. Elle avait toujours conservť le _ma tante_ pour madame la
duchesse d'Orlťans.
La conduite toute simple du prince fit tomber les mauvais bruits qui
ne trouvaient nulle part plus d'ťcho que chez la duchesse sa mŤre. Son
entourage ťtait bruyamment hostile et elle ťtait trop faible pour s'y
opposer, ou trop sotte pour s'en apercevoir.
ņ mon retour d'Angleterre, j'avais ťtť lui faire ma cour, et, parce
que j'avais cherchť ŗ la distraire des inquiťtudes que lui causait la
maladie de l'ťpagneul de monsieur de Follemont en lui parlant de ses
petits-enfants que je venais de quitter ŗ Twickenham, le noyau
d'ultras qui formaient sa commensalitť m'avait dťclarťe _orlťaniste_
et avait rťpandu ce bruit qui m'impatientait fort, non pour moi,
j'ťtais de trop peu de consťquence, mais pour mon pŤre.
Il importait aussi, dans l'intťrÍt de monsieur le duc d'Orlťans, que
l'impartialitť de l'ambassadeur fŻt reconnue. Cette accusation tomba
comme tant d'autres. Il n'y en avait pas de moins fondťe, car, si
monsieur le duc d'Orlťans avait voulu lier quelque intrigue ŗ cette
ťpoque en Angleterre, il aurait trouvť mon pŤre trŤs peu disposť ŗ lui
montrer la moindre indulgence.
Pendant le peu de jours que monsieur le duc d'Orlťans passa ŗ Paris,
il vint deux fois chez moi. Quelque honorťe que je fusse de ces
visites, je craignais qu'elles ne fissent renouveler les propos de
l'hiver, mais cela ťtait usť.
La malveillance excitťe au plus haut point par le succŤs obtenu par
mon frŤre auprŤs de la jeune hťritiŤre, courtisťe par beaucoup et
enviťe par tous, avait trouvť un autre texte.
Pensant probablement que la situation de mon pŤre avait influť sur ce
mariage, on raconta qu'ŗ la suite d'une espŤce d'orgie oý ma mŤre
s'ťtait _grisťe_ avec le prince rťgent, il avait voulu prendre des
libertťs auxquelles elle avait rťpondu par un soufflet, que les autres
femmes s'ťtaient levťes de table; que le prince s'ťtait plaint ŗ notre
Cour, que depuis ce temps mon pŤre et ma mŤre n'ťtaient point sortis
de chez eux et qu'ils allaient Ítre remplacťs ŗ Londres.
Cette charmante anecdote, inventťe et colportťe ŗ Paris, fut renvoyťe
ŗ Londres. Quelques gazettes anglaises y firent allusion et il y eut
recrudescence de cabale ŗ Paris. Tous mes excellents amis venaient ŗ
tour de rŰle me demander ce qui en ťtait au _juste_ ... sur quoi
l'histoire ťtait fondťe ... quel ťtait le canevas sur lequel on avait
brodť, etc.; et, lorsque je rťpondais, conformťment ŗ la plus exacte
vťritť, qu'il n'y avait jamais eu que des politesses, des obligeances
et des respects ťchangťs entre le prince et ma mŤre et que rien
n'avait pu donner lieu ŗ cette ťtrange histoire, on faisait un petit
sourire d'incrťdulitť qui me transportait de fureur. J'ai peu ťprouvť
d'indignation plus vive que dans cette occasion.
Ma mŤre ťtait le modŤle non seulement des vertus, mais des convenances
et des bonnes maniŤres. Inventer une pareille absurditť sur une femme
de soixante ans, pour se venger d'un succŤs de son fils, m'a toujours
paru une l‚chetť dont, encore aujourd'hui, je ne parle pas de
sang-froid.
Le prince rťgent fut d'une extrÍme bontť. Il rencontra mon pŤre au
Parc, le retint prŤs de lui pendant toute sa promenade, s'arrÍta
longuement dans un groupe nombreux de seigneurs anglais ŗ cheval et ne
s'ťloigna qu'aprŤs avoir donnť un amical _shake-hand_ ŗ l'ambassadeur.
Mon pŤre s'expliqua ces faveurs inusitťes en apprenant plus tard les
sots bruits rťpandus ŗ Paris et rťpťtťs obscurťment ŗ Londres.
Le dťgoŻt que j'en ťprouvais me donna un vif dťsir de m'ťloigner. Le
mariage de mon frŤre ťtant dťcidťment reculť jusqu'ŗ l'automne, je me
dťcidai ŗ retourner ŗ Londres pour en attendre l'ťpoque.
Pendant que cette odieuse histoire s'inventait et se propageait, toute
la famille d'Orlťans vint s'ťtablir au Palais-Royal. Elle arriva tard
le soir; j'y allai le lendemain matin. Le dťjeuner attendait les
princes; ils avaient ťtť faire leur cour ŗ la famille royale. Je les
vis revenir, et il ne me fut pas difficile de voir que cette visite
avait ťtť pťnible.
Madame la duchesse d'Orlťans avait l'air triste, son mari sťrieux;
mademoiselle se trouva mal en entrant dans la salle ŗ manger. Elle
venait d'Ítre extrÍmement malade et ŗ peine remise.
Nous nous empress‚mes autour d'elle; elle revint ŗ elle et me dit en
me serrant la main:
ęMerci, ma chŤre, ce n'est rien, je vais mieux; mais je suis encore
faible et cela m'ťprouve toujours.Ľ
Le nuage rťpandu sur les visages se dissipa ŗ l'entrťe d'un grand plat
d'ťchaudťs tout fumants: ęAh! des ťchaudťs du Palais-Royal!Ľ
s'ťcria-t-on; et l'amour du sol natal, la joie de la patrie, effaÁa
l'impression qu'avait laissťe la rťception des Tuileries.
Je passai une grande partie du peu de journťes que je restai encore ŗ
Paris auprŤs de ces aimables princesses qui m'accueillaient avec une
extrÍme bontť et partageaient mon indignation des fables dťbitťes sur
ma mŤre. Au reste, elles connaissaient par expťrience toute la
fťconditť des inventions calomnieuses.
On rťpandait alors le bruit du mariage secret de Mademoiselle avec
Raoul de Montmorency dont elle aurait facilement pu Ítre mŤre, tant la
disproportion d'‚ge ťtait grande. Lorsqu'il ťpousa madame Thibaut de
Montmorency, il fallut bien renoncer ŗ ce conte.
Je ne sais pas si on remplaÁa immťdiatement Raoul par monsieur
Athalin; ce n'est que longtemps aprŤs que j'en ai entendu parler. La
seconde version n'a pas plus de vťritť que la premiŤre; elles sont
ťgalement absurdes et calomnieuses.
CHAPITRE XI
Tom Pelham. -- Inauguration du pont de Waterloo. -- DÓner ŗ
Claremont. -- Maussaderie de la princesse Charlotte. -- Son
obligeance. -- Un nouveau caprice. -- Conversation avec elle. --
Mort de cette princesse. -- Affliction gťnťrale. -- CaractŤre de
la princesse Charlotte. -- Ses goŻts, ses habitudes. -- Suicide
de l'accoucheur. -- Singulier conseil de lord Liverpool. --
Maxime de lord Sidmouth.
Quelque horreur que j'aie pour la mer, je fus amplement payťe des
fatigues du voyage par le bonheur que mon retour ŗ Londres causa ŗ mes
parents. Je trouvai grande joie ŗ me reposer prŤs d'eux des petites
tracasseries d'un monde toujours disposť ŗ faire payer, argent
comptant, le genre de succŤs qu'il apprťcie le plus, parce qu'il est ŗ
la portťe de toutes les intelligences.
Il n'y a personne qui ne comprenne vite combien il eŻt ťtť agrťable
pour son fils, son frŤre, ou son ami d'ťpouser une riche hťritiŤre, et
qui ne trouve la prťfťrence accordťe ŗ un autre une espŤce de
passe-droit. J'ai remarquť depuis, lorsque cela me touchait de moins
prŤs, qu'aucune circonstance ne dťveloppe davantage l'envie et
l'animadversion de la sociťtť. Ce que tout le monde veut, c'est de la
fortune. Il n'y a guŤre de faÁon moins pťnible et plus prompte d'en
acquťrir; chacun regrette de voir un autre l'ťlu du sort.
Je me rappelle, ŗ ce propos, les projets d'un de mes camarades
d'enfance, le jeune Pelham. Il ťtait cadet, avait atteint sa seiziŤme
annťe et rentrait ŗ la maison paternelle pour la derniŤre fois avant
de quitter le collŤge. Le lendemain de son arrivťe, son pŤre, lord
Yarborough, petit homme sec, le plus froid, le plus sťrieux, le plus
empesť que j'aie connu, le fit entrer dans son cabinet et lui dit:
ęTom, le moment est arrivť oý vous devez choisir une profession;
quelle qu'elle soit, je vous y soutiendrai de mon mieux. Je ne cherche
pas ŗ vous influencer; mais, si vous prťfťriez l'…glise, je dois vous
avertir que j'ai ŗ ma disposition des bťnťfices qui vous mettront tout
de suite dans une grande aisance. Je le rťpŤte, je vous laisse une
entiŤre libertť; seulement je vous prťviens que, lorsque vous aurez
dťcidť, je n'admettrai pas de fantasque changement. Songez-y donc
bien. Ne me rťpondez pas ŗ prťsent; je vous questionnerai la veille de
votre retour au collŤge. Soyez prÍt alors ŗ m'apprendre votre choix.
--Oui, monsieur.Ľ
ņ la fin des vacances oý Tom s'ťtait trŤs bien diverti et oý son pŤre
ne lui avait peut-Ítre pas adressť une seule fois la parole, il
l'appela derechef ŗ cette confťrence de cabinet, effroi de toute la
famille, et, de la mÍme faÁon solennelle, il l'interrogea de nouveau:
ęHť bien, Tom, avez-vous mŻrement rťflťchi ŗ votre sort futur?
--Oui, monsieur.
-- tes-vous dťcidť?
--Oui, monsieur.
--Songez que je n'admettrai pas de caprice et qu'il vous faudra suivre
rigoureusement la profession que vous adopterez.
--Je le sais, monsieur.
--Hť bien, donc parlez.
--S'il vous plaÓt, monsieur, j'ťpouserai une hťritiŤre.Ľ
Tout le flegme de lord Yarborough ne put rťsister ŗ cette rťponse,
faite avec un sťrieux imperturbable. Il ťclata de rire. Au reste, mon
ami Tom n'ťpousa pas une hťritiŤre; il entra dans la marine et mourut
bien jeune de la fiŤvre jaune dans les Antilles. C'ťtait un fort beau,
bon et aimable garÁon. Mais je raconte lŗ une aventure de l'autre
siŤcle; je reviens au dix-neuviŤme.
Le 18 juin 1817, deuxiŤme anniversaire de la bataille de Waterloo, on
fit avec grande pompe l'inauguration du pont, dit de Waterloo. Le
prince rťgent, ayant le duc de Wellington prŤs de lui, suivi de tous
les officiers ayant pris part ŗ la bataille et des rťgiments des
gardes, y passa le premier. On avait fait ťlever des tribunes pour les
principaux personnages du pays.
Sachant qu'on prťparait une tribune diplomatique, mon pŤre avait fait
prťvenir qu'il dťsirait n'Ítre pas invitť ŗ cette cťrťmonie ŗ laquelle
il avait dťcidť de ne point assister. Ses collŤgues du corps
diplomatique dťclarŤrent qu'ils ne voulaient pas se sťparer de lui
dans cette circonstance et que cette cťrťmonie, ťtant purement
nationale, ne devait point entraÓner d'invitation aux ťtrangers. Le
cabinet anglais se prÍta de bonne gr‚ce ŗ cette interprťtation. Mon
pŤre fut trŤs sensible ŗ cette dťfťrence de ses collŤgues, d'autant
qu'il n'aurait pas manquť de gens aux Tuileries mÍme pour lui faire un
tort de la manifestation de ses sentiments franÁais. Il ťtait pourtant
bien dťcidť ŗ ne point sacrifier ses rťpugnances patriotiques ŗ leur
malignes interprťtations.
Ce fut le prince Paul Esterhazy qui, spontanťment, ouvrit l'avis de
refuser la tribune prťparťe. Il ne rencontra aucune difficultť et vint
annoncer ŗ mon pŤre la dťcision du corps diplomatique et le
consentement du cabinet anglais.
C'est en 1817 que je dois placer mes rapports avec la princesse
Charlotte de Galles. Sous prťtexte que sa maison n'ťtait pas
arrangťe, elle s'ťtait dispensťe de venir ŗ Londres, et, quoique ce
fŻt le moment de la rťunion du grand monde, elle restait sous les
frais ombrages de Claremont qu'elle disait plus salutaires ŗ un ťtat
de grossesse assez avancť.
Je fus comprise dans une invitation adressťe ŗ mes parents pour aller
dÓner chez elle. La curiositť que m'inspirait cette jeune souveraine
d'un grand pays ťtait encore excitťe par de frťquents dťsappointements.
J'avais toujours manquť l'occasion de la voir.
Nous fŻmes reÁus ŗ Claremont par lady Glenlyon, dame de la princesse,
et par un baron allemand, aide de camp du prince, qui, seul, ťtait
commensal du ch‚teau. Une partie des convives nous avaient prťcťdťs,
d'autres nous suivirent. Le prince Lťopold fit une apparition au
milieu de nous et se retira.
AprŤs avoir attendu fort longtemps, nous entendÓmes dans les piŤces
adjacentes un pas lourd et retentissant que je ne puis comparer qu'ŗ
celui d'un tambour-major. On dit autour de moi: ęVoilŗ la princesseĽ.
En effet, je la vis entrer donnant le bras ŗ son mari. Elle ťtait trŤs
parťe, avait bon air; mais ťvidemment il y avait de la prťtention _ŗ
la grande …lisabeth_ dans cette marche si bruyamment dťlibťrťe et ce
port de tÍte hautain. Comme elle entrait dans le salon d'un cŰtť, un
maÓtre d'hŰtel se prťsentait d'un autre pour annoncer le dÓner.
Elle ne fit que traverser sans dire un mot ŗ personne. Arrivťe dans la
salle ŗ manger, elle appela ŗ ses cŰtťs deux ambassadeurs; le prince
se plaÁa vis-ŗ-vis, entre deux ambassadrices. AprŤs avoir vainement
cherchť ŗ le voir en se penchant de droite et de gauche du plateau, la
princesse prit bravement son parti et fit enlever l'ornement du
milieu. Les nuages qui s'ťtaient amoncelťs sur son front
s'ťclaircirent un peu. Elle sourit gracieusement ŗ son mari, mais elle
n'en fut guŤre plus accorte pour les autres. Ses voisins n'en tirŤrent
que difficilement de rares paroles. J'eus tout le loisir de l'examiner
pendant que dura un assez mauvais dÓner.
Je ne puis parler de sa taille, sa grossesse ne permettait pas d'en
juger. On voyait seulement qu'elle ťtait grande et fortement
construite. Ses cheveux ťtaient d'un blond presque filasse, ses yeux
bleu porcelaine, point de sourcils, point de cils, un teint d'une
blancheur ťgale sans aucune couleur. On doit s'ťcrier: ęQuelle fadeur!
elle ťtait donc d'une figure bien insipide?Ľ Pas du tout. J'ai
rarement rencontrť une physionomie plus vive et plus mobile; son
regard ťtait plein d'expression. Sa bouche vermeille, et ornťe de
dents comme des perles, avait les mouvements les plus agrťables et les
plus variťs que j'aie jamais vus, et l'extrÍme jeunesse des formes
compensant de manque de coloris de la peau lui donnait un air de
fraÓcheur remarquable.
Le dÓner achevť, elle fit un lťger signal de dťpart aux femmes et
passa dans le salon; nous l'y suivÓmes. Elle se mit dans un coin avec
une de ses amies d'enfance, nouvellement mariťe et grosse comme elle,
dont j'oublie le nom. Leur chuchotage dura jusqu'ŗ l'arrivťe du
prince, restť ŗ table avec les hommes.
Il trouva toutes les autres femmes ŗ une extrťmitť du salon et la
princesse ťtablie dans son tÍte-ŗ-tÍte de pensionnaire. Il chercha
vainement ŗ la remettre en rapport avec ses convives. Il rapprocha des
fauteuils pour les ambassadrices et voulut ťtablir une conversation
qu'il t‚cha de rendre gťnťrale; mais cela fut impossible. Enfin la
comtesse de Lieven, fatiguťe de cette exclusion, alla s'asseoir, sans
y Ítre appelťe, sur le mÍme sopha que la princesse et commenÁa ŗ voix
basse une conversation qui, apparemment, lui inspira quelque intťrÍt
car elle en parut entiŤrement absorbťe.
Les efforts du prince pour lui faire distribuer ses politesses un peu
plus ťgalement restŤrent complŤtement infructueux. Chacun attendait
avec impatience l'heure du dťpart. Enfin on annonÁa les voitures et
nous partÓmes, aussi lťgŤrement congťdiťs que nous avions ťtť
accueillis. Quant ŗ moi, je n'avais pas mÍme reÁu un signe de tÍte
lorsque ma mŤre m'avait prťsentťe ŗ la princesse.
En montant en voiture, je dis: ęJ'ai voulu voir, j'ai vu. Mais j'en ai
plus qu'assez.Ľ Ma mŤre m'assura que la princesse ťtait ordinairement
plus polie; je dus convenir que l'agitation du prince en faisait foi.
Probablement il lui reprocha sa maussaderie; car, peu de jours aprŤs,
lorsque nous mťditions, ŗ regret, notre visite de remerciements de
l'obligeant accueil qu'elle nous avait fait, nous reÁŻmes une nouvelle
invitation.
Cette fois, la princesse fit mille frais; elle distribua ses gr‚ces
plus ťgalement entre les convives; cependant les prťfťrences furent
pour nous. Elle nous retint jusqu'ŗ minuit, causant familiŤrement de
tout et de tout le monde, de la France et de l'Angleterre, de la
rťception des Orlťans ŗ Paris, de leurs rapports avec les Tuileries,
des siens avec Windsor, des faÁons de la vieille Reine, de cette
ťtiquette qui lui ťtait insupportable, de l'ennui qui l'attendait
lorsqu'il faudrait enfin avouer sa maison de Londres prÍte et aller y
passer quelques mois.
Ma mŤre lui fit remarquer qu'elle serait bien mieux logťe que dans
l'hŰtel oý elle avait ťtť au moment de son mariage:
ęC'est vrai, dit-elle; mais, quand on est aussi parfaitement heureuse
que moi, on craint tous les changements, mÍme pour Ítre mieux.Ľ
La pauvre princesse comptait pourtant bien sur ce bonheur! Elle
disait, ce mÍme soir, qu'elle ťtait bien sŻre d'avoir un garÁon, car
rien de ce qu'elle dťsirait ne lui avait jamais manquť.
On vint ŗ parler de Claremont et de ses jardins. Je les connaissais
d'ancienne date; monsieur de Boigne avait ťtť sur le point d'acheter
cette habitation. La princesse Charlotte assura qu'elle ťtait bien
changťe depuis une douzaine d'annťes, et nous engagea fort ŗ venir un
matin pour nous la montrer en dťtail. Le jour fut pris _s'il faisait
beau_, sinon pour la premiŤre fois que le temps et les affaires de mon
pŤre le permettraient. Elle ne sortait plus que pour se promener ŗ
pied dans le parc et, de deux ŗ quatre heures, nous la trouverions
toujours enchantťe de nous voir.
Nous nous sťpar‚mes aprŤs des shake-hand rťitťrťs et d'une violence ŗ
dťmettre le bras, accompagnťs de protestations d'affection exprimťs
d'une voix qui aurait ťtť naturellement douce si les mťmoires du
seiziŤme siŤcle ne nous avaient appris que la reine …lisabeth avait le
verbe haut et bref.
Je ne nie pas que la princesse Charlotte ne me parut infiniment plus
aimable et mÍme plus belle qu'au dÓner prťcťdent. Le prince Lťopold
respirait plus ŗ l'aise et semblait jouir du succŤs de ses sermons.
Le matin fixť pour la visite du parc de Claremont, il plut ŗ torrent.
Il fallut la retarder de quelques jours; aussi, lorsque nous
arriv‚mes, la fantaisie de la princesse Charlotte ťtait changťe. Elle
nous reÁut plus que froidement, s'excusa sur ce que son ťtat lui
permettait ŗ peine de faire quelques pas, fit appeler l'aide de camp
allemand pour nous accompagner dans ces jardins qu'elle devait prendre
tant de plaisir ŗ nous montrer, et eut ťvidemment grande presse ŗ se
dťbarrasser de notre visite.
Lorsque nous fŻmes tout ŗ l'extrťmitť du parc, nous la vÓmes de loin
donnant le bras au prince Lťopold et dťtalant comme un lťvrier. Elle
fit une grande pointe, puis arriva vers nous. Cette recherche
d'impolitesse, presque grossiŤre nous avait assez choquťs pour Ítre
disposťs ŗ lui rendre froideur pour froideur. Mais le vent avait
tournť. Lťopold, nous dit-elle, l'avait forcťe ŗ sortir, l'exercice
lui avait fait du bien et mise plus en ťtat de jouir de la prťsence de
_ses amis_. Elle fut la plus gracieuse et la plus obligeante du monde.
Elle s'attacha plus particuliŤrement ŗ moi qui marchais plus
facilement que ma mŤre, me prit par le bras et m'entraÓnant ŗ la suite
de ses grands pas, se mit ŗ me faire des confidences sur le bonheur de
son mťnage et sur la profonde reconnaissance qu'elle devait au prince
Lťopold d'avoir consenti ŗ ťpouser l'hťritiŤre d'un royaume.
Elle fit avec beaucoup de gaietť, de piquant et d'esprit, la peinture
de la situation du _mari de la reine_; mais, ajouta-t-elle en
s'animant:
ęMon Lťopold ne sera pas exposť ŗ cette humiliation, ou mon nom n'est
pas CharlotteĽ, et elle frappa violemment la terre de son pied (assez
gros par parenthŤse) ęsi on voulait m'y contraindre, je renoncerais
plutŰt au trŰne et j'irais chercher une chaumiŤre oý je puisse vivre,
selon les lois naturelles, sous la domination de mon mari. Je ne veux,
je ne puis rťgner sur l'Angleterre qu'ŗ condition qu'il rťgnera sur
nous deux. Il sera roi, roi reconnu, roi indťpendant de mes caprices;
car, voyez-vous, madame de Boigne, je sais que j'en ai, vous m'en avez
vu, et c'ťtait bien pire autrefois.... Vous souriez.... Cela vous
paraÓt impossible....; mais, sur mon honneur, c'ťtait encore pire
avant que mon Lťopold eŻt entrepris la t‚che assez difficile, de me
rendre une bonne fille (a good girl), bien sage et bien raisonnable,
dit-elle avec un sourire enchanteur. Ah! oui, il sera roi oý je ne
serai jamais reine, souvenez-vous de ce que je vous dis en ce moment
et vous verrez si Charlotte est fidŤle ŗ sa parole.Ľ
Elle s'appelait volontiers Charlotte en parlant d'elle-mÍme, et
prononÁait ce nom avec une espŤce d'emphase, comme s'il avait dťjŗ
acquis la cťlťbritť qu'elle lui destinait.
Hťlas! la pauvre princesse! ses rÍves d'amour et de gloire ont ťtť de
bien courte durťe! C'est dans cette conversation, dont la fin se
tenait sous la colonnade du ch‚teau oý nous ťtions arrivťes avant le
reste de la sociťtť, qu'elle me dit cette phrase que j'ai dťjŗ citťe
sur le bonheur parfait dont Claremont ťtait l'asile et qu'elle
m'engageait ŗ venir souvent visiter.
Je ne l'ai jamais revue. Lŗ se sont terminťes mes relations avec la
brillante et spirituelle hťritiŤre des trois royaumes.
J'avais dťjŗ quittť l'Angleterre lorsque, peu de semaines aprŤs, la
mort vint enlever en une seule heure deux gťnťrations de souverains:
la jeune mŤre et le fils qu'elle venait de mettre au monde. Ils
pťrirent victimes des caprices de la princesse.
Le prince Lťopold avait rťussi ŗ la raccommoder avec son pŤre le
prince rťgent, mais toute son influence avait ťchouť devant
l'animositť qu'elle ťprouvait contre sa grand'mŤre et ses tantes. Dans
la crainte qu'elles ne vinssent assister ŗ ses couches, elle voulut
tenir ses douleurs cachťes le plus longtemps possible.
Cependant, le travail fut si pťnible qu'il fallut bien qu'on en fŻt
informť. La vieille Reine, trompťe volontairement par les calculs de
la princesse, ťtait ŗ Bath, le Rťgent chez la marquise d'Hertford ŗ
cent milles de Londres. La princesse n'avait auprŤs d'elle que son
mari auquel l'accoucheur Crofft persuada qu'il n'y avait rien ŗ
craindre d'un travail qui durait depuis soixante heures.
La facultť, rťunie dans les piŤces voisines, demandait ŗ entrer chez
la princesse. Elle s'y refusait pťremptoirement, et l'inexpťrience du
prince, trompť par Crofft, l'empÍcha de l'exiger. Enfin, elle mit au
monde un enfant trŤs bien constituť et mort uniquement de fatigue;
l'ťpuisement de la mŤre ťtait extrÍme. On la remit au lit. Crofft
assura qu'elle n'avait besoin que de repos; il ordonna que tout le
monde quitt‚t sa chambre. Une heure aprŤs, sa garde l'entendit
faiblement appeler:
ęFaites venir mon mari,Ľ dit-elle, et elle expira.
Le prince, couchť sur un sopha dans la piŤce voisine, put douter s'il
avait reÁu son dernier soupir. Sa dťsolation fut telle qu'on peut le
supposer; il perdait tout.
Je ne sais si, par la suite, le caractŤre de la princesse Charlotte
lui prťparait un avenir bien doux; mais elle ťtait encore sous
l'influence d'une passion aussi violente qu'exclusive pour lui, et lui
en prodiguait toutes les douceurs avec un charme que ses habitudes un
peu farouches rendaient encore plus grand.
Il l'apprivoisait, s'il est permis de se servir de cette expression;
et les soins qu'il lui fallait prendre pour adoucir cette nature
sauvage, vaincue par l'amour, devaient, tant qu'ils ťtaient
accompagnťs de succŤs, paraÓtre trŤs piquants. On voyait cependant
qu'il lui fallait prendre des prťcautions pour ne pas l'effaroucher et
qu'il craignait que le jeune tigre ne se souvÓnt qu'il avait des
griffes.
La princesse aurait-elle toujours invoquť cette loi de droit naturel,
qui soumet la femme ŗ la domination de son mari? Je me suis permis
d'en douter; mais, au moment oý elle me l'assurait, elle le croyait
tout ŗ fait, et peut-Ítre le prince le croyait aussi. Probablement,
aprŤs l'avoir perdue, il n'a retrouvť dans sa mťmoire que les belles
qualitťs de sa noble ťpouse.
Il est sŻr que, lorsqu'elle voulait plaire, elle ťtait parfaitement
sťduisante. Avec tout ses travers, rien ne peut donner l'idťe de la
popularitť dont elle jouissait en Angleterre: c'ťtait la fille du
pays. Depuis sa plus petite enfance, on l'avait vue ťlever comme
l'hťritiŤre de la couronne; et elle avait tellement l'instinct de ce
qui peut plaire aux peuples que les prťjugťs nationaux ťtaient comme
incarnťs en elle.
Dans son application ŗ faire de l'opposition ŗ son pŤre, elle avait
pris l'habitude d'une grande rťgularitť dans ses dťpenses et une
extrÍme exactitude dans ses payements. Lorsqu'elle allait dans une
boutique ŗ Londres et que les marchands cherchaient ŗ la tenter par
quelque nouveautť bien dispendieuse, elle rťpondait:
ęNe me montrez pas cela, c'est trop cher pour moi.Ľ
Cent gazettes rťpťtaient ces paroles, et les louaient d'autant plus
que c'ťtait la critique du dťsordre du Rťgent.
Claremont faisait foi de la simplicitť dont la princesse affectait de
donner l'exemple. Rien n'ťtait moins recherchť que son mobilier. Il
n'y avait d'autre glace dans tout l'appartement que son miroir de
toilette et une petite glace ovale, de deux pieds sur trois, suspendue
en biais dans le grand salon. Les meubles ťtaient ŗ l'avenant du
dťcor.
Je vois d'ici le grand lit, ŗ quatre colonnes, de la princesse. Les
rideaux pendaient tout droit sans draperies, sans franges, sans
ornements; ils ťtaient de toile ŗ ramages doublťs de percale rose. Nul
dťgagement ŗ cette chambre oý des meubles, plus utiles qu'ťlťgants,
deux fois rťpťtťs, prouvaient les habitudes les plus conjugales, selon
l'usage du pays.
Cette extrÍme simplicitť, dans l'habitation d'une jeune et charmante
femme, contrastait trop avec les magnificences, les recherches, le
luxe presque exagťrť dont le Rťgent ťtait entourť ŗ Carlton House et ŗ
Brighton pour ne pas lui dťplaire, d'autant qu'on savait, d'autre
part, la princesse gťnťreuse et donnant au mťrite malheureux ce
qu'elle refusait ŗ ses fantaisies.
Elle avait assurťment de trŤs belles qualitťs et un amour de la gloire
bien rare ŗ son ‚ge et dans sa position. Sa mort jeta l'Angleterre
dans la consternation, et, lorsque j'y revins au mois de dťcembre, la
population entiŤre, jusqu'aux postillons de poste, jusqu'aux balayeurs
des rues, portait un deuil qui dura six mois. L'accoucheur Crofft
ťtait devenu l'objet de l'exťcration publique, au point qu'il finit
par en perdre la raison et se brŻler la cervelle.
Je me rappelle deux propos de genre divers qui me furent tenus par des
ministres anglais.
Cette annťe, ma mŤre ťtait souffrante le jour de la Saint-Louis; je
fis les honneurs du dÓner donnť ŗ l'ambassade pour la fÍte du Roi.
Milord Liverpool ťtait ŗ cŰtť de moi. Un petit chien que j'aimais
beaucoup, ayant ťchappť ŗ sa consigne, vint se jeter tout ŗ travers du
dÓner officiel ŗ ma grande contrariťtť. Les gens voulaient l'emporter
mais il se rťfugiait sous la table. Afin de faciliter sa capture, je
l'attirai en lui offrant ŗ manger. Lord Liverpool arrÍta mon bras et
me dit:
ęNe le trahissez pas, vous pervertiriez ses principes (You will spoil
its morals).Ľ
Je levai la tÍte en riant, mais je trouvai une expression si
solennelle sur la physionomie du noble lord que j'en fus dťconcertťe.
Le chien _trahi_ fut emportť, et je ne sais encore ŗ l'heure actuelle
quel degrť de sťrieux il y avait dans la remarque du ministre, car il
ťtait mťthodiste jusqu'au puritanisme.
On ne saurait imaginer, lorsqu'on n'a pas ťtť a mÍme de l'apprťcier, ŗ
quel point, dans l'esprit d'un anglais, l'homme privť sait se sťparer
de l'homme d'…tat. Tandis que l'un se refuse avec indignation ŗ la
moindre dťmarche qui blesse la dťlicatesse la plus susceptible,
l'autre se jette sans hťsiter dans l'acte le plus machiavťlique et
propre ŗ troubler le sort des nations, s'il peut en rťsulter la chance
d'un profit quelconque pour la vieille Angleterre.
De la mÍme main dont lord Liverpool arrÍtait la mienne dans ma
trahison du petit chien, il aurait signť hardiment la reddition de
Parga, au risque de la tragťdie qui s'en est suivie.
L'autre propos me fut tenu par lord Sidmouth, assis ŗ ma gauche le
mÍme jour; il m'est souvent revenu ŗ la mťmoire et mÍme m'a fait rŤgle
de conduite. Nous parlions de je ne sais quel jeune mťnage auquel un
petit accroissement de revenu serait nťcessaire pour Ítre ŗ son aise.
ęCela se peut dire, rťpondit lord Sidmouth, cependant je leur
conseillerais volontiers de se contenter de ce qu'ils ont; car ils n'y
gagneraient rien s'ils obtenaient davantage. Je n'ai jamais connu
personne, dans aucune circonstance ni dans aucune position, qui n'eŻt
besoin d'un peu plus pour en avoir assez (A little more to make
enough).Ľ
Cette morale pratique m'a paru trŤs ťminemment sage et bonne ŗ se
rappeler pour son compte. Toutes les fois que je me suis surprise ŗ
regretter la privation de quelque fantaisie, je me suis rťpťtť que
tout le monde rťclamait ęa little more to make enoughĽ et me suis
tenue pour _satisfaite_.
CHAPITRE XII
Le roi de Prusse veut ťpouser Georgine Dillon. -- Rupture de ce
mariage. -- Dťsobligeance du roi Louis XVIII pour les Orlťans. --
Il la tťmoigne en diverses occasions. -- Irritation qui en
rťsulte. -- Le comte de La Ferronnays. -- Son attachement pour
monsieur le duc de Berry. -- Madame de Montsoreau et la layette.
-- ScŤne entre monsieur le duc de Berry et monsieur de La
Ferronnays. -- Irritation de la famille royale. -- Madame de
Gontaut nommťe gouvernante. -- Conseils du prince de
Castelcicala. -- Madame de Noailles.
Mon frŤre sollicitait vivement mon retour qu'il croyait devoir h‚ter
l'ťpoque de son mariage. J'en jugeais autrement, mais je cťdai ŗ ses
voeux et ne tardai guŤre ŗ m'en repentir.
J'arrivai ŗ Paris vers le milieu de septembre. C'est le moment oý la
ville est la plus dťserte, car c'est l'ťpoque de l'annťe oý les
personnes qui ne la quittent jamais en sortent en foule et oý ceux qui
habitent longuement la campagne se gardent bien d'y revenir. Mon
sťjour en ťtait d'autant plus remarquable; et je m'aperÁus bientŰt que
ma prťsence ne servirait qu'ŗ faire mieux apprťcier des longueurs qui
devenaient un ridicule lorsqu'il s'agissait d'ťpouser une riche
hťritiŤre ne dťpendant en apparence que d'elle seule.
Quelque dťserte que fŻt la ville, je trouvais encore de bons amis pour
me rťpťter:
ęPrenez-y garde, la petite est capricieuse. Dťjŗ plusieurs mariages
ont ťtť arrangťs par elle, elle les a fait traÓner et les a rompus ŗ
la veille de se faire. Pour celui de monsieur de Montesquiou, la
corbeille ťtait achetťe, etc.Ľ
J'avais au service de tout le monde la rťponse banale que, si elle
devait se repentir d'ťpouser mon frŤre, il valait mieux que ce fŻt la
veille que le lendemain. Mais ces propos, auxquels des retards qu'il
ťtait impossible d'expliquer et qui se renouvelaient de quinze jours
en quinze jours, donnaient une apparence de fondement quoiqu'ils n'en
eussent aucun et que la jeune personne fŻt aussi contrariťe que nous,
me firent prendre la rťsolution de vivre en ermite. MÍme lorsque la
sociťtť commenÁa ŗ se reformer pour l'hiver, ma porte ťtait
habituellement fermťe et je n'allai nulle part.
Ma famille occupait aussi le public par un autre bruit de mariage qui
ne m'ťtait guŤre plus agrťable. Le roi de Prusse ťtait devenu trŤs
amoureux de ma cousine Georgine Dillon fille d'…douard Dillon, jeune
personne charmante de figure et de caractŤre. Il voulait ŗ toute force
l'ťpouser.
Madame Dillon avait la tÍte tournťe de cette fortune; mon oncle en
ťtait assez flattť. Georgine seule, qui, avec peu de brillant dans
l'esprit, avait un grand bon sens et tout le tact qui peut venir du
coeur le plus simple, le plus naÔf, le plus honnÍte, le plus ťlevť, le
plus gťnťreux que j'aie jamais rencontrť, sentait ŗ quel point la
position qu'on lui offrait ťtait fausse et repoussait l'honneur que le
prince Radziwill ťtait chargť de lui faire accepter.
Elle devait Ítre duchesse de Brandebourg et avoir un brillant
ťtablissement pour elle et ses enfants. Mais enfin cette main royale
qu'on lui prťsentait ne pouvait Ítre que la gauche; ses enfants du Roi
mariť ne seraient pas des enfants lťgitimes. Sa position personnelle,
au milieu de la famille royale, ne serait jamais simple, et elle
avait trop de candeur pour Ítre propre ŗ la soutenir.
Le Roi obtint cependant qu'elle vÓnt passer huit jours ŗ Berlin avec
ses parents. Ils furent admis deux fois au souper de famille et les
princes les comblŤrent de caresses. Le mariage paraissait imminent;
ils retournŤrent ŗ Dresde oý mon oncle ťtait ministre de France.
Tout ťtait rťglť. Le Roi demanda que la duchesse de Brandebourg se fit
luthťrienne; Georgine refusa pťremptoirement. Il se rabattit ŗ ce
qu'elle suivit les cťrťmonies extťrieures du culte rťformť; elle s'y
refusa encore. Du moins, elle ne serait catholique qu'en secret et ne
pratiquerait pas ostensiblement, nouveau refus de la sage Georgine,
malgrť les voeux secrets de sa mŤre, trop pieuse pour oser insister
formellement. Son pŤre la laissait libre.
Les nťgociations traÓnŤrent en longueur; la fantaisie que le Roi avait
eue pour elle se calma. On lui dťmontra l'inconvťnient d'ťpouser une
ťtrangŤre, une franÁaise, une catholique; et, aprŤs avoir fait jaser
toute l'Europe avec assez de justice comme on voit, ce projet de
mariage tomba sans querelle et sans rupture. La petite ne donna pas un
soupir ŗ ces fausses grandeurs; sa mŤre qui l'adorait se consola en la
voyant contente. Mon oncle demanda ŗ quitter Dresde pour ne pas se
trouver exposť ŗ des relations directes avec le roi de Prusse. Cela
aurait ťtť gauche pour tout le monde aprŤs ce qui s'ťtait passť.
Sa Majestť Prussienne avait l'habitude de venir tous les ans ŗ
Carlsbad, et une nouvelle rencontre aurait pu amener une reprise de
passion dont personne ne se souciait. Mon oncle sollicita et obtint de
passer de Dresde ŗ Florence. Cette rťsidence lui plaisait; elle
convenait ŗ son ‚ge, ŗ ses goŻts et elle ťtait favorable pour achever
l'ťducation de sa fille; car cette Reine ťlue n'avait pas encore
dix-sept annťes accomplies.
Je trouvais les Orlťans trŤs irritťs de leur situation ŗ la Cour. Le
Roi ne perdait pas une occasion d'Ítre dťsobligeant pour eux. Il
cherchait ŗ ťtablir une diffťrence de traitement entre madame la
duchesse d'Orlťans, son mari et sa belle-soeur, fondťe en apparence
sur le titre d'Altesse Royale qu'elle portait, mais destinťe au fond ŗ
choquer les deux derniers qu'il n'aimait pas.
Tant qu'avait durť l'ťmigration, il avait protťgť monsieur le duc
d'Orlťans contre les haines du parti royaliste, mais, depuis sa
rentrťe en France, lui-mÍme en avait adoptť toutes les exagťrations,
et, surtout depuis ce qui s'ťtait passť ŗ Lille en 1815, il
poursuivait le prince avec une animositť persťvťrante.
La famille d'Orlťans avait ťtť successivement exclue de la tribune
royale ŗ la messe du ch‚teau, de la loge au spectacle dans les jours
de reprťsentation, enfin de toute distinction princiŤre, ŗ ce point
qu'ŗ une cťrťmonie publique ŗ Notre-Dame, Louis XVIII fit enlever les
carreaux sur lesquels monsieur le duc d'Orlťans et Mademoiselle
ťtaient agenouillťs pour les faire mettre en dehors du tapis sur
lequel ils n'avaient pas droit de se placer.
Il faut Ítre prince pour apprťcier ŗ quel point ces petites avanies
blessent. Monsieur le duc d'Orlťans me raconta lui-mÍme ce qui lui
ťtait arrivť ŗ l'occasion de la naissance d'un premier enfant de
monsieur le duc de Berry qui ne vťcut que quelques heures.
On dressa l'acte de naissance. Il fut apportť par le chancelier dans
le cabinet du Roi oý toute la famille et une partie de la Cour se
trouvaient rťunies. Le chancelier donna la plume au Roi pour signer,
puis ŗ Monsieur, ŗ Madame, ŗ messieurs les ducs d'AngoulÍme et de
Berry. Le tour de monsieur le duc d'Orlťans arrivť, le Roi cria du
plus haut de cette voix de tÍte qu'il prenait quand il voulait Ítre
dťsobligeant:
ęPas le chancelier, pas le chancelier, les cťrťmonies.Ľ
Monsieur de Brťzť, grand maÓtre des cťrťmonies, qui ťtait prťsent
s'avanÁa:
ęPas monsieur de Brťzť, les cťrťmonies.Ľ
Un maÓtre des cťrťmonies se prťsenta.
ęNon, non, s'ťcria le Roi de plus en plus aigrement, un aide des
cťrťmonies, un aide des cťrťmonies!Ľ
Monsieur le duc d'Orlťans restait devant la table, la plume devant
lui, n'osant pas la prendre, ce qui aurait ťtť une incongruitť, et
attendant la fin de ce maussade ťpisode. Il n'y avait pas d'aide des
cťrťmonies prťsent; il fallut aller en chercher un dans les salons
adjacents. Cela dura un temps qui parut long ŗ tout le monde. Les
autres princes en ťtaient eux-mÍmes trŤs embarrassťs. Enfin l'aide des
cťrťmonies arriva et la signature, qui avait ťtť si gauchement
interrompue, s'acheva, mais non sans laisser monsieur le duc d'Orlťans
trŤs ulcťrť.
En sortant, il dit ŗ monsieur le duc de Berry:
ęMonseigneur, j'espŤre que vous trouverez bon que je ne m'expose pas
une seconde fois ŗ un pareil dťsagrťment.
--Ma fois, mon cousin, je vous comprends si bien que j'en ferais
autant ŗ votre place.Ľ
Et ils ťchangŤrent une cordiale poignťe de main.
Monsieur le duc d'Orlťans disait ŗ juste titre que, si telle ťtait
l'ťtiquette et que le Roi tÓnt autant ŗ la faire exťcuter dans toute
sa rigueur, il fallait avoir la prťcaution de la faire rťgler
d'avance. Il lui importait peu que ses carreaux fussent sur le tapis,
ou que la plume lui fŻt donnťe par l'un ou par l'autre, mais cela
avait l'air de lui prťparer volontairement des humiliations publiques.
C'est par ces petites tracasseries, sans cesse renouvelťes, qu'en
aliťnant les Orlťans on se les rendait hostiles.
Je suis trŤs persuadťe que jamais ils n'ont sťrieusement conspirť;
mais, lorsqu'ils rentraient chez eux, blessťs de ces procťdťs qui, je
le rťpŤte, sont doublement sensibles ŗ des princes et qu'ils se
voyaient entourťs des hommages et des voeux de tous les mťcontents,
certainement ils ne les repoussaient pas avec la mÍme vivacitť qu'ils
l'eussent fait si le Roi et la famille royale les avaient accueillis
comme des parents et des amis.
D'un autre cŰtť, les gens de l'opposition affectaient d'entourer
monsieur le duc d'Orlťans et de le proclamer comme leur chef, et, ŗ
mon sens, il ne refusait pas assez hautement ce dangereux honneur.
…videmment ce rŰle lui plaisait. Y voyait-il le chemin de la couronne?
Peut-Ítre en perspective, mais de bien loin, pour ses enfants, et
seulement dans la pensťe d'accommoder la lťgitimitť avec les besoins
du siŤcle.
L'existence ťphťmŤre de la petite princesse de Berry donna lieu ŗ une
autre aventure trŤs f‚cheuse. Je ne me souviens plus si, dans ces
pages dťcousues, le nom de monsieur de La Ferronnays s'est dťjŗ trouvť
sous ma plume, cela est assez probable, car j'ťtais liťe avec lui
depuis de longues annťes.
Il avait toujours accompagnť monsieur le duc de Berry, lui ťtait
tendrement et sincŤrement dťvouť, savait lui dire la vťritť,
quelquefois avec trop d'emportement, mais toujours avec une franchise
d'amitiť que le prince ťtait capable d'apprťcier. Les relations entre
eux ťtaient sur le pied de la plus parfaite intimitť.
Monsieur de La Ferronnays, aprŤs avoir reprochť ses sottises ŗ
monsieur le duc de Berry, aprŤs lui en avoir ťvitť le plus qu'il
pouvait, employait sa vie entiŤre ŗ pallier les autres et ŗ chercher ŗ
en dťrober la connaissance au public. Il avait vainement espťrť
qu'aprŤs son mariage le prince adopterait un genre de vie plus
rťgulier; loin de lŗ, il semblait redoubler le scandale de ses
liaisons subalternes.
Jamais monsieur de La Ferronnays n'avait prÍtť la moindre assistance
aux goŻts passagers de monsieur le duc de Berry; mais, ŗ prťsent, il
en tťmoignait hautement son mťcontentement, tout en veillant jour et
nuit ŗ sa sŻretť, et les relations ťtaient devenues hargneuses entre
eux.
Monsieur de La Ferronnays ťtait premier gentilhomme de la chambre
ostensiblement et de fait maÓtre absolu de la maison oý il commandait
plus que le prince. Sa femme ťtait dame d'atour de madame la duchesse
de Berry; ils habitaient un magnifique appartement ŗ l'…lysťe et y
semblaient ťtablis ŗ tout jamais.
Lors de la grossesse de madame la duchesse de Berry, on s'occupa du
choix d'une gouvernante. Monsieur le duc de Berry demanda et obtint
que ce fŻt madame de Montsoreau, la mŤre de madame de La Ferronnays.
L'usage ťtait que le Roi donnait la layette des enfants des Fils de
France; elle fut envoyťe et d'une grande magnificence. La petite
princesse n'ayant vťcu que peu d'heures, la liste civile rťclama la
layette. Madame de Montsoreau fit valoir les droits de sa place qui
lui assuraient les _profits de la layette_. On rťpliqua qu'elle
n'appartenait ŗ la gouvernante que si elle avait servi. Il y eut
quelques lettres ťchangťes.
Enfin on en ťcrivit directement ŗ monsieur le duc de Berry (je crois
mÍme que le Roi lui en parla). Il fut transportť de fureur, envoya
chercher madame de Montsoreau et la traita si durement qu'elle remonta
chez elle en larmes. Elle y trouva son gendre et eut l'imprudence de
se plaindre de faÁon ŗ exciter sa colŤre. Il descendit chez le prince.
Monsieur le duc de Berry vint ŗ lui en s'ťcriant:
ęJe ne veux pas que cette femme couche chez moi.
--Vous oubliez que cette femme est ma belle-mŤre.Ľ
On n'en entendit pas davantage; la porte se referma sur eux. Trois
minutes aprŤs, monsieur de La Ferronnays sortit de l'appartement, alla
dans le sien, ordonna ŗ sa femme de faire ses paquets et quitta
immťdiatement l'…lysťe oý il n'est plus rentrť.
Je n'ai jamais su prťcisťment ce qui s'ťtait passť dans ce court tÍte
ŗ tÍte; mais la rupture a ťtť complŤte et il en est restť dans tous
les membres de la famille royale une animadversion contre monsieur de
La Ferronnays qui a survťcu ŗ monsieur le duc de Berry, et mÍme au
bouleversement des trŰnes. Je n'ai jamais pu tirer de monsieur de La
Ferronnays ni de monsieur le duc de Berry d'autre rťponse, si ce n'est
qu'il ne fallait pas leur en parler. Si monsieur de La Ferronnays
perdait une belle existence, monsieur le duc de Berry perdait un ami
vťritable, et cela ťtait bien irrťparable.
Monsieur de La Ferronnays tint une conduite parfaite, modeste et digne
tout ŗ la fois. Il ťtait sans aucune fortune et chargť d'une nombreuse
famille. Monsieur de Richelieu, toujours accessible ŗ ce qui lui
paraissait honorable, s'occupa de son sort et le nomma ministre en
SuŤde.
Lorsqu'il en prťvint monsieur le duc de Berry, il se borna ŗ rťpondre:
ęJe ne m'y oppose pas.Ľ Les autres princes en furent trŤs mťcontents
et cette nomination accrut encore le peu de goŻt qu'ils avaient pour
monsieur de Richelieu, d'autant que bientŰt aprŤs monsieur de La
Ferronnays fut nommť ambassadeur ŗ Pťtersbourg. La joie de son
ťloignement compensait un peu le chagrin de sa fortune. Nous le
retrouverons ministre des affaires ťtrangŤres et toujours dans la
disgr‚ce des Tuileries.
Une nouvelle grossesse de madame la duchesse de Berry ayant forcť ŗ
remplacer madame de Montsoreau, monsieur le duc de Berry demanda
madame de Gontaut pour gouvernante de ses enfants. Ce choix ne laissa
pas de surprendre tout le monde et de scandaliser les personnes qui
avaient ťtť tťmoins des jeunes annťes de madame de Gontaut, mais il
faut se presser d'ajouter qu'elle l'a pleinement justifiť.
L'ťducation de Mademoiselle a ťtť aussi parfaite qu'il a dťpendu
d'elle, et il aurait ťtť bien heureux pour monsieur le duc de Bordeaux
qu'elle eŻt ťtť son unique instituteur.
Madame de Gontaut ťtait depuis bien longtemps dans l'intimitť de
Monsieur et de son fils, cependant elle n'a jamais ťtť ni exaltťe ni
intolťrante en opinion politique. L'habitude de vivre presque
exclusivement dans la sociťtť anglaise, un esprit sage et ťclairť,
l'avaient tenue ŗ l'ťcart des prťjugťs de l'ťmigration. Sa grande
faveur du moment auprŤs de monsieur le duc de Berry venait de ce
qu'elle ťloignait de sa jeune ťpouse les rapports indiscrets qui
troublaient leur mťnage.
Madame la duchesse de Berry ťtait fort jalouse et, quoique le prince
ne voulŻt rien cťder de ses habitudes, il ťtait trop bon homme dans le
fond pour ne pas attacher un grand prix ŗ rendre sa femme heureuse et
ŗ avoir la paix ŗ la maison. Il savait un grť infini ŗ madame de
Gontaut, qui pendant un moment remplaÁa madame de La Ferronnays comme
dame d'atour, de chercher ŗ y maintenir le calme.
Le prince de Castelcicala avait amorti les premiŤres colŤres de madame
la duchesse de Berry. Il racontait, avec ses gestes italiens et ŗ
faire mourir de rire, la conversation oý, en rťponse ŗ ses plaintes et
ŗ ses fureurs, il lui avaient assurť d'une faÁon si pťremptoire que
tous les hommes avaient des maÓtresses, que leurs femmes le savaient
et en ťtaient parfaitement satisfaites, qu'elle n'avait plus osť se
rťvolter contre une situation qu'il affirmait si gťnťrale et ŗ
laquelle il ne faisait exception absolument que pour monsieur le duc
d'AngoulÍme.
Or, la princesse napolitaine aurait eu peu de goŻt pour un pareil
ťpoux. Elle s'ťtait particuliŤrement enquise de monsieur le duc
d'Orlťans, et le prince Castelcicala n'avait pas manquť de rťpondre de
lui:
ęIndubitablement, madame, pour qui le prenez-vous?
--Et ma tante le sait?
--Assurťment, madame; madame la duchesse d'Orlťans est trop sage pour
s'en formaliser.Ľ
Malgrť ces bonnes instructions de son ambassadeur, la petite princesse
reprenait souvent des accŤs de jalousie, et madame de Gontaut ťtait
ťgalement utile pour les apaiser et pour ťcarter d'elle les
rťvťlations que l'indiscrťtion ou la malignitť, pouvait faire
pťnťtrer. Elle continua ŗ jouer ce rŰle tant que dura la vie de
monsieur le duc de Berry.
Madame la comtesse Juste de Noailles fut nommťe dame d'atour; monsieur
le duc de Berry vint lui-mÍme la prier d'accepter. Ce choix rťunit
tous les suffrages; personne n'ťtait plus propre ŗ remplir une
pareille place avec convenance et dignitť.
L'ťminent savoir-vivre de madame de Noailles lui tient lieu d'esprit
et sa politesse l'a toujours rendue trŤs populaire, quoiqu'elle ait
ťtť successivement dame des impťratrices Josťphine et Marie-Louise et
dame d'atour de madame la duchesse de Berry dont elle n'a jamais ťtť
favorite mais qui l'a toujours traitťe avec beaucoup d'ťgards.
CHAPITRE XIII
Je refuse d'aller chez une devineresse. -- Aventure du chevalier
de Mastyns. -- …lections de 1817. -- Le parti royaliste sous
l'influence de monsieur de VillŤle. -- Le duc de Broglie et
Benjamin Constant. -- Monsieur de Chateaubriand appelle
l'opposition de gauche _les libťraux_. -- Mariage de mon frŤre.
-- Visite ŗ Brighton. -- Soigneuse hospitalitť du prince rťgent.
-- Usages du pavillon royal. -- Rťcit d'une visite du Rťgent au
roi George III. -- Dťjeuner sur l'escalier. -- Le grand-duc
Nicolas ŗ Brighton.
Le mariage de mon frŤre se remettait de jour en jour. J'ťtais au plus
fort de l'impatience de ces retards incomprťhensibles, lorsqu'un soir
une comtesse de Schwitzinoff, dame russe avec laquelle madame de Duras
s'ťtait assez liťe, nous parla d'une visite qu'elle avait faite ŗ
mademoiselle Lenormand, la devineresse, et de toutes les choses
extraordinaires qu'elle lui avait annoncťes.
J'avais bien quelque curiositť d'apprendre si le mariage de mon frŤre se
ferait enfin cette annťe; mais la duchesse en avait encore beaucoup
davantage de se faire dire si elle rťussirait ŗ empÍcher le mariage de
sa fille, la princesse de Talmont, avec le comte de La Rochejacquelein,
car la seule pensťe de cette union faisait le tourment de sa vie.
Elle me pressa fort de l'accompagner chez l'habile sibylle, en nous
donnant parole de ne lui adresser qu'une seule question. J'aurais
peut-Ítre cťdť sans la promesse que j'avais faite ŗ mon pŤre de
n'avoir jamais recours ŗ la nťcromancie, sous quelque forme qu'elle
se prťsent‚t. Le motif qui lui avait fait exiger cet engagement est
assez curieux pour que je le rapporte ici.
Lorsque mon pŤre entra au service, il eut pour mentor le
lieutenant-colonel de son rťgiment, le chevalier de Mastyns, ami de sa
famille, qui le traitait paternellement. C'ťtait un homme d'une
superbe figure; il avait fait la guerre avec distinction et son
caractŤre bon et indulgent sans faiblesse le rendait cher ŗ tout le
rťgiment.
Dans un cantonnement d'une petite ville en Allemagne, pendant une des
campagnes de la guerre de Sept Ans, une bohťmienne s'introduisit dans
la salle oý se tenait le repas militaire. Sa prťsence offrit quelques
distractions ŗ l'oisivetť du corps d'officiers dont le chevalier de
Mastyns, fort jeune alors, faisait partie. Il ťprouva d'abord de la
rťpugnance contre elle et fit quelques remontrances ŗ ses camarades,
puis il cťda et finit par livrer sa main ŗ l'inspection de la
bohťmienne.
Elle l'examina attentivement et lui dit:
ęVous avancerez rapidement dans la carriŤre militaire; vous ferez un
mariage au-dessus de vos espťrances; vous aurez un fils que vous ne
verrez pas, et vous mourrez d'un coup de feu avant d'avoir atteint
quarante ans.Ľ
Le chevalier de Mastyns n'attacha aucune importance ŗ ces pronostics.
Cependant, lorsqu'en peu de mois il obtint deux grades consťcutifs,
dus ŗ sa brillante conduite ŗ la guerre, il rappela les paroles de la
diseuse de bonne aventure ŗ ses camarades. Elles lui revinrent aussi ŗ
la mťmoire quand il ťpousa, quelques annťes plus tard, une jeune fille
riche et de bonne maison. Sa femme ťtait au moment d'accoucher; il
avait obtenu un congť pour aller la rejoindre. La veille du jour oý il
devait partir, il dit:
ęMa foi, la sorciŤre n'a pas dit toute la vťritť, car j'aurai quarante
ans dans cinq jours, je pars demain et il n'y a guŤre d'apparence d'un
coup de feu en pleine paix.Ľ
La chaise de poste dans laquelle il devait partir ťtait arrÍtťe devant
son logis, une charrette l'accrocha, brisa l'essieu; il fallait
plusieurs heures pour le raccommoder. Le chevalier de Mastyns se
dťsolait devant sa porte; quelques officiers de la garnison passŤrent
en ce moment; ils allaient ŗ la chasse ŗ l'affŻt. Le chevalier
l'aimait beaucoup; il se dťcida ŗ les suivre pour employer le temps
qu'il lui fallait attendre.
On se plaÁa; la chasse commenÁa, le chevalier ťtait seul en habit
brun. Un des chasseurs l'oubliant, ou l'ignorant, et se fiant sur le
vÍtement blanc de ses camarades, tira sur quelque chose de foncť qu'il
vit remuer dans un buisson. Le chevalier de Mastyns reÁut plusieurs
chevrotines dans les reins; on le transporta ŗ la ville.
La blessure quoique trŤs grave n'ťtait pas mortelle; on le saigna
plusieurs fois; il se rťtablit assez pour que le chirurgien rťpondÓt
de sa guťrison et fix‚t mÍme le jour oý il pourrait partir, ŗ une
ťpoque assez rapprochťe. On lui apporta les lettres arrivťes pour lui
pendant son ťtat de souffrance. Il en ouvrit une de sa mŤre; elle lui
annonÁait que sa femme ťtait accouchťe, plutŰt qu'on ne comptait, d'un
fils bien portant:
ęAh! s'ťcria-t-il, la maudite sorciŤre aura eu raison! Je ne verrai
pas mon fils!Ľ
Soudain les convulsions le prirent; le tťtanos suivit, et, douze
heures aprŤs, il expira dans les bras de mon pŤre.
Les mťdecins dťclarŤrent que l'impression morale avait seule causť une
mort que l'ťtat de sa blessure ne donnait aucun lieu d'apprťhender.
Cette aventure, dont mon pŤre avait ťtť presque acteur dans sa
premiŤre jeunesse, lui avait laissť une impression trŤs vive du danger
de fournir ŗ l'imagination une aussi f‚cheuse p‚ture.
Le chevalier de Mastyns ťtait homme de coeur et d'esprit, plein de
raison dans l'habitude de la vie. En bonne santť, il se riait des
dťcrets de la bohťmienne; mais, affaibli par les souffrances, il
succomba devant cette prťvention fatale. Mon pŤre avait donc exigť de
nous de ne jamais nous exposer ŗ courir le risque de cette dangereuse
faiblesse.
Mon sťjour forcť ŗ Paris me rendit spectatrice des ťlections de 1817.
C'ťtaient les premiŤres depuis la nouvelle loi; elles ne furent pas de
nature ŗ rassurer. Les mťcontents, qu'ŗ cette ťpoque nous qualifiions
de jacobins, se montrŤrent trŤs actifs et eurent assez de succŤs pour
donner de vives inquiťtudes au gouvernement. Il appela ŗ son secours
les royalistes de toutes les observances afin de combattre les
difficultťs que leurs propres extravagances avaient amenťes. Comme ils
avaient peur, ils ťcoutŤrent un moment la voix de la sagesse et se
conduisirent suffisamment bien ŗ ces ťlections pour conjurer le plus
fort du danger.
J'avais quelquefois occasion de rencontrer monsieur de VillŤle: il
s'exprimait avec une modťration qui lui faisait grand honneur dans mon
esprit. On l'a depuis accusť de souffler en dessous les feux qu'il
semblait vouloir apaiser. Je n'ai lŗ-dessus que des notions vagues,
venant de ses ennemis. Ce qu'il y a de sŻr c'est qu'il commenÁait ŗ
prendre l'attitude de chef. Il tenait un langage aussi et peut-Ítre
plus modťrť qu'on ne pouvait l'attendre d'un homme qui aspirait ŗ
diriger un parti soumis ŗ des intťrÍts passionnťs. Il influa beaucoup
sur la bonne conduite des royalistes aux ťlections. L'opposition
n'eut pas tous les succŤs dont elle s'ťtait flattťe; mais elle ťtait
redevenue fort menaÁante.
Monsieur Benjamin Constant rťpondait au duc de Broglie qui, avec sa
candeur accoutumťe, quoique trŤs avant dans l'opposition, faisait
l'ťloge du Roi et disait que, tout considťrť, peut-Ítre serait-il
difficile d'en trouver un d'un caractŤre plus appropriť aux besoins du
pays:
ęJe vous accorderai lŗ-dessus tout ce que vous voudrez; oui, Louis
XVIII est un monarque qui peut convenir ŗ la France telle qu'elle est,
mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Voyez-vous, messieurs, nous
devons vouloir un roi qui rŤgne par nous, un roi de notre faÁon qui
tombe nťcessairement si nous l'abandonnons et qui en ait la
conscience.Ľ
Le duc de Broglie lui tourna le dos, car lui ne voulait pas de
rťvolution; mais il ťtait bien jeune. Il ťtait et sera toujours trop
honnÍte, pour Ítre chef de parti. Malheureusement, il y avait plus de
gens dans sa sociťtť pour propager les doctrines de monsieur Constant
que celles toutes spťculatives et d'amťliorations progressives de
monsieur de Broglie.
Ce fut vers cette ťpoque que monsieur de Chateaubriand, dans je ne
sais quelle brochure, honora les hommes de la gauche du beau nom de
_libťraux_. Ce parti rťunissait trop de gens d'esprit pour qu'il
n'apprťci‚t pas immťdiatement toute la valeur du prťsent; il l'accepta
avec empressement, et il a fort contribuť ŗ son succŤs.
Bien des personnes honorables, qui auraient rťpugnť ŗ se ranger d'un
parti dťsignť sous le nom de jacobin, se jetŤrent tÍte baissťe, en
sŻretť de conscience, parmi les libťraux et y conspirŤrent sans le
moindre scrupule. C'est surtout en France, oý la puissance des mots
est si grande, que les qualifications exercent de l'influence.
Ma prťsence n'ayant pas suffi pour amener la cťlťbration du mariage
dťcidť depuis huit mois, les jeunes gens rťclamŤrent celle de mon
pŤre. Il obtint un congť de quinze jours. AprŤs des tracasseries et
des ennuis qui durŤrent encore cinq semaines, tous les prťtextes de
retard ťtant enfin ťpuisťs, il assista le 2 dťcembre 1817 au mariage
de son fils avec mademoiselle DestilliŤres.
Huit jours aprŤs, il conduisit le nouveau mťnage ŗ Londres oý ma mŤre
ťtait restťe et nous attendait avec impatience.
Le deuil de la princesse Charlotte ťtait portť par toutes les classes
et ajoutait encore ŗ la tristesse de Londres ŗ cette ťpoque de l'annťe
oý la sociťtť y est toujours fort peu animťe. Ma jeune belle-soeur n'y
prit pas grand goŻt et fŻt charmťe, je pense, de revenir au bout d'un
mois retrouver sa patrie et ses habitudes avec un mari qu'elle aimait
et qui la chťrissait.
Je prolongeai quelque peu mon sťjour en Angleterre, promettant d'aller
la rejoindre pour lui faire faire ses visites de noces et la prťsenter
ŗ la Cour et dans le monde.
Mes parents avaient dťjŗ ťtť deux fois ŗ Brighton pendant mes
frťquentes absences. Me trouvant ŗ Londres cette annťe, je fus
comprise dans l'invitation. ņ la premiŤre visite qu'ils y avaient
faite, un maÓtre d'hŰtel du prince ťtait venu ŗ l'ambassade s'informer
des habitudes et des goŻts de ses habitants, pour que rien ne leur
manqu‚t au _pavillon_.
Il est impossible d'Ítre un maÓtre de maison plus soigneux que le
Rťgent et de prodiguer plus de coquetteries quand il voulait plaire.
Lui-mÍme s'occupait des plus petits dťtails. ņ peine avait-on dÓnť
trois fois ŗ sa table qu'il connaissait les goŻts de chacun et se
mettait en peine de les satisfaire. On est toujours sensible aux
attentions des gens de ce parage, surtout les personnes qui font grand
bruit de leur indťpendante indiffťrence. Je n'en ai jamais rencontrť
aucune qui n'en fŻt trŤs promptement sťduite.
Le deuil encore rťcent pour la princesse Charlotte ne permettait pas
les plaisirs bruyants ŗ Brighton, mais les regrets, si toutefois le
Rťgent en avait eu de bien vifs, ťtaient passťs, et le pavillon royal
se montrait plus noir que triste.
Ce pavillon ťtait un chef-d'oeuvre de mauvais goŻt. On avait, ŗ frais
immenses, fait venir des quatre parties du monde toutes les
magnificences les plus hťtťroclites pour les entasser sous les huit ou
dix coupoles de ce bizarre et laid palais, composť de piŤces de
rapports ne prťsentant ni ensemble ni architecture. L'intťrieur
n'ťtait pas mieux distribuť que l'extťrieur et assurťment l'art avait
tout ŗ y reprendre; mais lŗ s'arrÍtait la critique. Le confortable y
ťtait aussi bien entendu que l'agrťment de la vie, et, aprŤs avoir,
pour la conscience de son goŻt, bl‚mť l'amalgame de toutes ces
ťtranges curiositťs, il y avait fort ŗ s'amuser dans l'examen de leur
recherche et de leur dispendieuse ťlťgance.
Les personnes logťes au pavillon ťtaient invitťes pour un certain
nombre de jours qui, rarement, excťdaient une semaine. On arrivait de
maniŤre ŗ faire sa toilette avant dÓner. On trouvait ses appartements
arrangťs avec un soin qui allait jusqu'ŗ la minutie des habitudes
personnelles de chaque convive. Presque toujours l'hŰte royal se
trouvait le premier dans le salon. S'il ťtait retardť par quelque
hasard et que les femmes l'y eussent prťcťdť, il leur en faisait une
espŤce d'excuse.
La sociťtť du dÓner ťtait nombreuse. Elle se composait des habitants
du palais et de personnes invitťes dans la ville de Brighton, trŤs
brillamment habitťe pendant les mois d'hiver. Le deuil n'admettait ni
bals, ni concerts. Cependant le prince avait une troupe de musiciens,
sonnant du cor et jouant d'autres instruments bruyants, qui faisaient
une musique enragťe dans le vestibule pendant le dÓner et toute la
soirťe. L'ťloignement la rendait supportable mais trŤs peu agrťable
selon moi. Le prince y prenait grand plaisir et s'associait souvent au
gong pour battre la mesure.
AprŤs le dÓner, il venait des visites. Vers onze heures, le prince
passait dans un salon oý il y avait une espŤce de petit souper froid
prťparť. Il n'y ťtait suivi que par les personnes qu'il y engageait,
les dames ŗ demeure dans la maison et deux ou trois hommes de
l'intimitť. C'ťtait lŗ que le prince se mettait ŗ son aise.
Il se plaÁait sur un sopha, entre la marquise de Hertford et une autre
femme ŗ qui il voulait faire politesse, prenait et conservait le dť
dans la conversation. Il savait merveilleusement toutes les aventures
galantes de la Cour de Louis XVI, aussi bien que celles d'Angleterre
qu'il racontait longuement. Ses rťcits ťtaient semťs parfois de petits
madrigaux, plus souvent de gravelures. La marquise prenait l'air
digne, le prince s'en tirait par une plaisanterie qui n'ťtait pas
toujours de bien bon goŻt.
Somme toute, ces soirťes, qui se prolongeaient jusqu'ŗ deux ou trois
heures du matin, auraient paru assommantes si un particulier en avait
fait les frais; mais le parfum de la couronne tenait toute la sociťtť
ťveillťe et la renvoyait enchantťe des gr‚ces du prince.
Je me rappelle pourtant avoir ťtť trŤs intťressťe un soir par une de
ces causeries. Le Rťgent nous raconta sa derniŤre visite au Roi son
pŤre; il ne l'avait pas vu depuis plusieurs annťes. La Reine et le duc
d'York, chargťs du soin de sa personne, ťtaient seuls admis ŗ le
voir. Je me sers du mot propre en disant _le voir_, car on ne lui
parlait jamais. Le son d'une voix, connue ou ťtrangŤre, le mettait
dans une agitation qu'il fallait des jours et quelquefois des semaines
pour calmer.
Le vieux Roi avait eu des accŤs tellement violents que, par
prťcaution, tous ses appartements ťtaient matelassťs. Il ťtait servi
avec un extrÍme soin, mais dans un silence profond; on ťtait ainsi
parvenu ŗ lui procurer assez de tranquillitť. Il ťtait complŤtement
aveugle.
Une maladie de la Reine l'ayant empÍchťe d'accomplir son pieux devoir,
le Rťgent la supplťa. Il nous dit qu'on l'avait fait entrer dans un
grand salon oý, sťparť par une rangťe de fauteuils, il avait aperÁu
son vťnťrable pŤre trŤs proprement vÍtu, la tÍte entiŤrement chauve et
portant une longue barbe blanche qui lui tombait sur la poitrine. Il
tenait conseil en ce moment et s'adressait ŗ monsieur Pitt en termes
fort raisonnables. On lui fit apparemment des objections, car il eut
l'air d'ťcouter et, aprŤs quelques instants de silence, reprit son
discours en insistant sur son opinion. Il donna ensuite la parole ŗ un
autre qu'il ťcouta de mÍme, puis ŗ un troisiŤme conseiller, le
dťsignant par son nom que j'ai oubliť. Enfin il avertit dans les
termes officiels que le conseil ťtait levť, appela son page et alla
faire des visites ŗ ses enfants, causant avec eux longuement, surtout
avec la princesse Amťlie, sa favorite (dont la mort inopinťe avait
contribuť ŗ cette derniŤre crise de sa maladie). En la quittant, il
lui dit:
ęJe m'en vais parce que la Reine, vous savez, n'aime pas que je
m'absente trop longtemps.Ľ
En effet, il suivit cette idťe et revint chez la Reine. Toutes ces
promenades se faisaient appuyť sur le bras d'un page et sans sortir du
mÍme salon. AprŤs un bout de conversation avec la Reine, il se leva
et alla tout seul, bien que suivi de prŤs, au piano oý il se mit ŗ
improviser et ŗ jouer de souvenir de la musique de Hśndel en la
chantant d'une voix aussi touchante que sonore. Ce talent de musique
(il l'avait toujours passionnťment aimťe) ťtait singuliŤrement
augmentť depuis sa cruelle maladie.
On prťvint le prince que la sťance au piano se prolongeait
ordinairement au delŗ de trois heures, et, en effet, aprŤs l'avoir
longuement ťcoutť, il l'y laissa. Ce qu'il y avait de remarquable
c'est que ce respectable vieillard, que rien n'avertissait de l'heure,
pas mÍme la lumiŤre du jour, avait un instinct d'ordre qui le poussait
ŗ faire chaque jour les mÍmes choses aux mÍmes heures, et les devoirs
de la royautť passaient toujours avant ceux de famille. Sa complŤte
cťcitť rendait possible le silence dont on l'environnait et que les
mťdecins, aprŤs avoir essayť de tous les traitements, jugeaient
indispensable.
Je dois au Rťgent la justice de dire qu'il avait les larmes aux yeux
en nous faisant ce rťcit, un soir bien tard oý nous n'ťtions plus que
quatre ou cinq, et qu'elles coulaient le long de ses joues en nous
parlant de cette voix, chantant ces beaux motets de Hśndel, et de la
violence qu'il avait dŻ se faire pour ne pas serrer dans ses bras le
vťnťrable musicien.
Le roi George III ťtait aussi aimť que respectť en Angleterre. Son
cruel ťtat pesait sur le pays comme une calamitť publique. Il est ŗ
remarquer que, dans un pays oý la presse se permet toutes les licences
et ne se fait pas faute d'appeler un _chat_ un _chat_, jamais aucune
allusion dťsobligeante n'a ťtť faite ŗ la position du Roi, et, jusqu'ŗ
Cobbet, tout le monde en a parlť avec convenance et respect. Les
vertus privťes servent ŗ cela, mÍme sur le trŰne, lorsqu'on n'est pas
en temps de rťvolution. Toutefois ce respect n'a pas empÍchť sept
tentatives d'assassinat sur George III.
Les invitťs du pavillon avaient l'option de dťjeuner dans leur
intťrieur ou de prendre part ŗ un repas en commun dont sir Benjamin et
lady Bloomfield faisaient les honneurs.
ņ moins d'indisposition, on prťfťrait ce dernier parti, exceptť,
toutefois, quelques-unes des anciennes amies du prince qui, cherchant
encore ŗ cacher du temps l'_irrťparable outrage_, ne paraissaient
jamais qu'ŗ la lumiŤre, soin fort superflu et sacrifice trŤs mal
rťcompensť. La marquise d'Hertford en donnait l'exemple.
Je fus trŤs ťtonnťe en sortant de mon appartement de trouver le
couvert mis sur le palier de l'escalier. Mais quel palier et quel
couvert! tous les tapis, tous les fauteuils, toutes les tables, toutes
les porcelaines, toutes les vaisselles, toutes les recherches de tout
genre que le luxe et le bon goŻt peuvent offrir ŗ la magnificence y
ťtaient dťployťs. Le prince mettait d'autant plus d'importance ŗ ce
que ce repas fŻt extrÍmement soignť qu'il n'y assistait jamais, et
qu'aucune dťlicatesse de bon goŻt pour ses hŰtes ne lui ťchappait.
Il menait ŗ Brighton ŗ peu prŤs la mÍme vie qu'ŗ Londres, restait dans
sa chambre jusqu'ŗ trois heures et montait ŗ cheval ordinairement
seul. Si, avant de commencer sa promenade, il rencontrait quelques
nouveaux dťbutants au pavillon, il se plaisait ŗ le leur montrer
lui-mÍme et surtout ses cuisines entiŤrement chauffťes ŗ la vapeur sur
un plan, tout nouveau ŗ cette ťpoque, dont il ťtait enchantť.
En rentrant, le prince descendait de cheval ŗ la porte de lady
Hertford qui habitait une maison sťparťe mais communiquant ŗ couvert
avec le pavillon royal. Il y restait jusqu'au moment oý commenÁait la
toilette du dÓner.
Pendant la semaine que nous pass‚mes ŗ Brighton, la mÍme vie se
renouvela chaque jour. C'ťtait l'habitude.
Je m'y retrouvai l'annťe suivante avec le grand-duc, devenu depuis
empereur Nicolas. Il ťtait trop jeune pour que le Rťgent se gÍn‚t
beaucoup pour lui. La seule diffťrence que je remarquai, c'est qu'au
lieu de laisser chacun libre de sa matinťe en mettant chevaux et
voitures ŗ sa disposition, le Rťgent faisait arranger une _partie_
tous les jours pour le jeune prince, ŗ laquelle, hormis lui, tous les
habitants du pavillon se rťunissaient.
On visitait ainsi les lieux un peu remarquables ŗ quinze milles ŗ la
ronde. Je me rappelle que, dans une de ces promenades, le grand-duc
adressa une question ŗ l'amiral sir Edmund Nagle que le rťgent avait
spťcialement attachť ŗ sa personne. Celui-ci Űta son chapeau pour
rťpondre:
ęMettez donc votre chapeau.Ľ
Et, en disant ces mots, le grand-duc donna un petit coup de cravache
au chapeau. L'amiral le tenait mal apparemment; il lui ťchappa et le
vent bien carabinť sur la falaise ťlevťe de Brighton l'emporta en
tourbillonnant dans un champ voisin, sťparť de nous par une haie et
une haute barriŤre devant laquelle nous ťtions arrÍtťs pour examiner
un point de vue.
Avant que l'amiral, gros, court et assez ‚gť, eŻt pu descendre de
cheval, l'Altesse Impťriale ťtait sautťe ŗ terre, avait deux fois
franchi lestement et gracieusement la barriŤre et rapportait le
chapeau ŗ sir Edmund en lui adressant ses excuses. Cette prouesse de
bonne gr‚ce et de bonne compagnie donna beaucoup de popularitť au
grand-duc dans notre coterie de Brighton qui rťunissait ŗ cette ťpoque
le corps diplomatique presque en entier.
L'ťtiquette plaÁa ma mŤre constamment auprŤs du grand-duc Nicolas
pendant tout son voyage. Avec ses habitudes de Cour et sa vocation
pour les princes, elle ne tarda pas ŗ lui plaire. Ils ťtaient trŤs
joliment ensemble; il l'appelait sa gouvernante et la consultait plus
volontiers que la comtesse de Lieven dont il avait peur. Ma mŤre en
ťtait, de son cŰtť, toute affolťe et nous le vantait beaucoup. Pour
moi, qui ne partage pas son goŻt pour les princes en gťnťral, il me
faut plus de temps pour m'apprivoiser aux personnes de cette espŤce
que ne dura le sťjour du grand-duc.
Je le trouvai trŤs beau; mais sa physionomie me semblait dure, et
surtout il me dťplut par la faÁon dont il parlait de son frŤre,
l'empereur Alexandre. Son enthousiasme, portť jusqu'ŗ la dťvotion,
s'exprimait en vťritables tirades de mťlodrame et d'un ton si exagťrť
que la faussetť en sautait aux yeux.
Je n'ai guŤre vu de jeune homme plus complŤtement privť de naturel que
le grand-duc Nicolas; mais aurait-il ťtť raisonnable d'en exiger d'un
prince et du frŤre d'un souverain absolu? Je ne le crois pas. Aussi ne
prťtends-je pas lui en faire reproche, seulement je m'explique
pourquoi, malgrť sa belle figure, ses belles faÁons, sa politesse et
les ťloges de ma mŤre, il n'est pas restť gravť d'un burin fort
admirateur dans mon souvenir.
CHAPITRE XIV
Je fais naufrage sur la cŰte entre Boulogne et Calais. -- Effet
de cet accident. -- Excellent propos de Monsieur. -- SinguliŤre
conversation de Monsieur avec …douard Dillon. -- Les pairs ayant
des charges chez le Roi votent contre le ministŤre. -- Rťponse de
monsieur Canning ŗ ce sujet. -- Le Pape et monsieur de Marcellus.
Si j'avais l'intention de faire le rťcit des petits ťvťnements de ma
vie privťe, ou plutŰt si j'avais le talent nťcessaire pour les rendre
intťressants, j'aurais dŻ placer en 1800 un combat naval que le
b‚timent sur lequel je revenais d'Hambourg soutint ŗ la hauteur du
Texel et, en 1804, la description d'un orage qui m'assaillit ŗ
l'entrťe de la Meuse. On me fit grand honneur, dans ces deux
occasions, de mon courage. Je suis forcťe de l'expliquer d'une faÁon
excessivement peu poťtique; j'avais abominablement le mal de mer.
Peut-Ítre pourrais-je rťclamer ŗ plus juste titre quelque ťloge pour
avoir montrť du sang-froid dans une position trŤs pťrilleuse qu'amena
la courte traversťe de Douvres ŗ Calais, au mois de fťvrier 1818.
Par la coupable incurie du capitaine, nous ťchou‚mes sur une petite
langue de sable placťe entre deux rochers ŗ un quart de lieue de la
cŰte. Chaque lame nous soulevait un peu, mais nous retombions plus
engravťs que jamais. C'ťtait encore heureux, car, si nous avions
heurtť de cette faÁon sur les rochers dont nous ťtions bien
rapprochťs, peu de secondes auraient suffi ŗ nous dťmolir.
Le b‚timent ťtait encombrť de passagers. La seule petite chaloupe
qu'il pŻt mettre ŗ la mer ne contenant que sept personnes, dont deux
matelots pour la conduire, je compris tout de suite que le plus grand
danger de notre situation pťrilleuse ťtait l'effroi qui pouvait se
mettre parmi nous et l'empressement ŗ se jeter dans cette embarcation.
Ma qualitť de fille d'ambassadeur me donnait d'autant plus
d'importance ŗ bord que j'ťtais accompagnťe d'un courrier de cabinet
pour lesquels les capitaines des paquebots ont des ťgards tout
particuliers.
J'en profitai pour venir au secours du commandant. Il voulait me faire
passer la premiŤre; je l'engageai ŗ placer dans le bateau une mŤre
accompagnťe de cinq petits enfants qui jetaient les hauts cris. Un
monsieur (je suis f‚chťe de dire que c'ťtait un franÁais) s'y
prťcipita sous prťtexte de porter les enfants, et le bateau s'ťloigna.
Je ne nierai pas que les quarante minutes qui s'ťcoulŤrent jusqu'ŗ son
retour ne me parussent fort longues. Toutefois le parti que j'avais
pris m'avait donnť quelque autoritť sur mes compagnons de malheur, et
j'obtins qu'il n'y aurait ni cris, ni mouvement impťtueux. Tout le
monde se conduisit trŤs bien. Les femmes qui restaient, nous ťtions
cinq et deux enfants, devaient s'embarquer au second voyage. Les
hommes tirŤrent au sort pour les suivants. Tout s'exťcuta comme il
avait ťtť convenu.
Le capitaine m'avait expliquť que le moment du plus grand danger
serait celui oý la marťe tournerait. Si alors le vent poussait ŗ
terre, avant que son b‚timent fŻt gouvernable, il y avait fort ŗ
craindre qu'il ne se bris‚t sur les rochers, si, d'un autre cŰtť, il
ťtait assez engravť pour ne pouvoir se relever, il serait rempli par
la marťe montante. Les deux chances ťtaient ťgalement admissibles,
mais nous avions encore un peu de temps devant nous. Au reste, la
nuit s'approchait et il neigeait ŗ gros flocons.
Lorsque je quittai le b‚timent, il ťtait tellement penchť que les
matelots eux-mÍmes ne pouvaient traverser le pont qu'ŗ l'aide d'une
ťchelle qu'on avait couchťe dessus. Notre dťpart se conduisit avec un
grand ordre et un entier silence. Une jeune femme refusa
pťremptoirement de se sťparer de son mari. Il avait tirť un des
derniers numťros, mais un officier qui devait partir par le prochain
bateau fut tellement touchť de ce dťvouement, fait au plus petit bruit
possible, qu'il exigea du mari de prendre sa place.
Je pourrais faire un volume de toutes les circonstances touchantes et
ridicules qui accompagnŤrent cet ťpisode de mes voyages, depuis le
moment oý le b‚timent toucha jusqu'ŗ celui oý, aprŤs une route de sept
heures au milieu de la nuit, de la neige, et par des chemins
impraticables, la charrette qui nous portait pÍle-mÍle sur la paille
nous fit faire notre entrťe dans Calais.
Le capitaine, dťbarrassť de ses passagers, manoeuvra fort
judicieusement. Il lui arriva enfin quelques secours de la cŰte et il
parvint ŗ relever son b‚timent et ŗ l'amener ŗ Calais, quoique trŤs
avariť. Le lendemain, il me fit faire des excuses et de grands
remerciements sur l'exemple que j'avais donnť et qui, assurait-il,
avait tout sauvť. J'ai remarquť que les grands dangers trouvent
toujours du sang froid, et les grandes affaires du secret. Les cris et
les caquets sont pour les petites circonstances.
J'ťtais partie de Londres malade; j'arrivai ŗ Paris trŤs bien
portante. Je payai cher ce faux bien-Ítre; la rťaction ne tarda pas ŗ
se faire sentir. J'eus d'abord un anthrax qui fut prťcurseur d'une
fiŤvre maligne; les mťdecins l'attribuŤrent ŗ avoir eu ce qui
s'appelle vulgairement le _sang tournť_. Plus on prend sur soi dans un
danger ťvident et apprťciť, plus ce rťsultat peut arriver. Toutefois
j'ťtais souffrante depuis fort longtemps et aurais peut-Ítre ťtť
malade sans mon naufrage.
Je prťsentai ma belle-soeur le lendemain de mon arrivťe. Je me
rappelle particuliŤrement ce jour-lŗ parce que c'est le seul mouvement
patriotique que j'aie vu ŗ Monsieur et que j'aime ŗ lui en faire
honneur. On conÁoit qu'un _naufrage_ est un argument trop commode pour
que les princes ne l'exploitent pas ŗ fond. J'avais fait ma cour ŗ ses
dťpens chez le Roi, chez Madame, et mÍme chez monsieur le duc
d'AngoulÍme.
Arrivťe chez Monsieur, aprŤs quelques questions prťliminaires, il me
dit d'un ton assez triste:
ęC'ťtait un paquebot franÁais.
--Non, monseigneur, c'ťtait un anglais.
--Oh! que j'en suis aise!Ľ
Il se retourna ŗ son service qui le suivait, et rťpťta aux dames qui
m'environnaient: ęCe n'ťtait pas un capitaine franÁaisĽ avec un air de
satisfaction dont je lui sus un grť infini. S'il avait souvent exprimť
de pareils sentiments, il aurait ťtť bien autrement populaire.
Je prťcťdai de peu de jours ŗ Paris mon oncle, …douard Dillon, qui y
passait en se rendant de Dresde ŗ sa nouvelle rťsidence de Florence.
Il ťtait de la maison de Monsieur, et, je crois l'avoir dťjŗ dit, dans
des habitudes de familiaritť qui dataient de leur jeunesse ŗ tous
deux. Un matin, oý il quittait Monsieur, il me raconta une
conversation qui venait d'avoir lieu. Elle avait roulť sur
l'inconvenance des propos tenus par l'opposition et plus encore par le
parti ministťriel sur le prince.
On cherchait, selon lui, ŗ le dťjouer parce qu'il ťtait royaliste et
avertissait le Roi des prťcipices oý on entraÓnait la monarchie, etc.
…douard, qui se trouvait une des personnes les plus raisonnables
pouvant l'approcher, combattit ces impressions de Monsieur. Il lui
assura qu'il lui serait bien facile de se faire adorer, s'il voulait
se montrer moins exclusivement chef d'un parti.
ęMais je ne suis pas chef d'un parti.
--Monseigneur, on vous en donne les apparences.
--C'est ŗ tort, mais comment l'ťviter?
--En ťtant moins exclusif.
--Jamais je n'accueillerai les jacobins, c'est pour cela qu'on me
dťteste.
--Mais les gens qui vous servent bien ne sont pas des jacobins.
--C'est selon. Vois-tu, Ned, le vieux levain rťvolutionnaire, cela
reparaÓt toujours, fŻt-ce au bout de vingt ans. Quand on a servi les
autres, on ne vaut rien pour nous.
--Je suis f‚chť d'entendre tenir ce langage ŗ Monseigneur; cela
confirme ce que l'on dit.
--Ah! ah! et que dit-on? conte-moi cela, toi.
--Hť bien, Monseigneur, on dit que vous avez envie de faire Mathieu ou
Jules ministre.Ľ
Monsieur qui se promenait dans son cabinet, s'arrÍta tout court,
partit d'un grand ťclat de rire.
ęAh! parbleu, celui-lŗ est trop amusant, ce n'est pas sťrieusement que
tu me dis cela?
--Sťrieusement, Monseigneur.
--Mais tu connais trop Jules pour que j'aie besoin de te dire ce que
c'est; hť bien, Mathieu c'est la mÍme espŤce tout juste, un peu moins
h‚bleur peut-Ítre, mais pas plus de fond ni de valeur. Puisqu'on veut
bien me prÍter des intentions, il faudrait au moins qu'elles fussent
de nature ŗ ce que quelqu'un pŻt y ajouter foi. Allons, allons, mon
vieil ami, tranquillise-toi; si on ne fait jamais d'autre fable sur
mon compte, cela n'est pas bien alarmant. Mathieu! Jules! Ah! bon
Dieu, quels ministres? on me croit donc extravagant! mais il faudrait
Ítre fou ŗ lier! Il n'est pas possible que qui que ce soit y ait cru
sťrieusement; on s'est moquť de toi.Ľ
…douard lui tťmoigna grande satisfaction des dispositions oý il se
trouvait. Il vint en toute h‚te me conter la sagesse de son prince.
J'ai souvent repensť ŗ cette conversation, sur laquelle je ne puis
avoir aucun doute, lorsque plus tard Mathieu de Montmorency d'abord et
Jules de Polignac ensuite ont ťtť successivement ministres des
affaires ťtrangŤres.
Monsieur avait-il changť d'opinion sur leur compte, ou bien
trompait-il …douard en 1818? Il peut y avoir de l'un et de l'autre.
Il est indubitable que, dŤs lors, Jules ťtait dans sa plus intime
confiance et jouait le rŰle de ministre de la police du gouvernement
occulte.
L'opposition au Roi avait gagnť toute la Cour, et pour conserver un
peu de tranquillitť dans l'intťrieur de sa famille, il n'osait pas en
tťmoigner de ressentiment. La loi de recrutement dťplaisait
particuliŤrement ŗ la noblesse. De tout temps, elle regardait l'armťe
comme son patrimoine. C'ťtait bien ŗ titre onťreux, il faut
l'accorder, car elle l'avait exploitťe, plus honorablement que
lucrativement, pendant bien des siŤcles, mais elle tenait ŗ en jouir
exclusivement et ne voulait pas comprendre combien les temps ťtaient
changťs. Elle s'opposa donc au systŤme d'avancement par l'anciennetť
avec une extrÍme passion.
La loi fut emportťe ŗ la Chambre des dťputťs; on savait qu'elle ne
parviendrait ŗ passer ŗ celle des pairs qu'ŗ une faible majoritť. Le
Roi, n'osant pas se prononcer hautement, emmena ŗ sa promenade
accoutumťe les pairs de service auprŤs de lui qui, tous, devaient
voter contre son gouvernement.
Le Roi ne sortait pas le dimanche ni le mercredi oý il tenait conseil.
Pour les cinq autres jours de la semaine, il avait cinq promenades,
toujours les mÍmes, qui revenaient ŗ jour fixe chaque semaine. Celle
de la matinťe oý l'on devait voter ťtait une des plus courtes et les
pairs y avaient comptť; mais le Roi, ce qui ťtait sans exemple, avait
changť les ordres pour les relais et, de plus, commandť d'aller
doucement.
En gťnťral, il voulait aller excessivement vite et toujours sur le
pavť. Quelque poussiŤre, quelque verglas qu'il pŻt y avoir, il ne
ralentissait jamais son allure. Il en rťsultait des accidents graves
pour les escortes, mais cela le laissait complŤtement impassible.
Quand un homme ťtait tombť on le ramassait; cela ne faisait aucun
ťmoi. Si c'ťtait un officier, on envoyait savoir de ses nouvelles, et,
si son cheval ťtait estropiť, on lui en donnait un. Il n'en n'ťtait
pas davantage.
Il fallait un motif politique pour influer sur les usages ťtablis;
mais la niche du Roi n'eut pas de succŤs. Ses zťlťs serviteurs avaient
eu la prťcaution de demander leur voiture dans la cour des Tuileries.
Ils s'y jetŤrent, en descendant du carrosse royal, et arrivŤrent
encore au Luxembourg ŗ temps pour donner leur _non_ aux demandes des
ministres. Ils n'en furent pas plus mal traitťs dans les grands
appartements, et beaucoup mieux au pavillon de Marsan.
Nous autres, constitutionnels ministťriels, ťtions indignťs; mais les
ultras, et mÍme les courtisans plus raisonnables, ťtaient enchantťs de
cet acte d'indťpendance.
Monsieur Canning se trouvait alors pour quelques jours ŗ Paris. Je me
souviens que, le soir mÍme oý la discussion sur ce procťdť ťtait assez
animťe, il entra chez madame de Duras. Elle l'interpella:
ęN'est-ce pas qu'en Angleterre les personnes attachťes au Roi votent
selon leur conscience et ne sont nullement forcťes de soutenir le
ministŤre?
--Je ne comprends pas bien.
--Mais, par exemple, si le grand chambellan trouve une loi mauvaise,
il est libre de voter contre?
--Assurťment, trŤs libre, chacun est complŤtement indťpendant dans son
vote.Ľ
Madame de Duras triomphait.
ęMais, ajouta monsieur Canning, il enverrait sa dťmission avant de
prendre ce parti; sans cela on la lui demanderait tout de suite.Ľ
Le triomphe fut un peu moins agrťable. Toutefois, comme elle avait de
l'esprit, elle se rabattit sur ce que notre ťducation constitutionnelle
n'ťtait pas assez faite pour appeler cela de l'indťpendance, et,
ramenant la discussion ŗ une thŤse gťnťrale, tourna le terrain oý elle
s'ťtait engagťe si malencontreusement.
Le parti soi-disant royaliste ťtait tombť dans une telle aberration
d'idťes que, lorsque monsieur de Marcellus, alors dťputť, fut nommť de
la commission pour examiner la loi qui devait accompagner le concordat
et garantir les libertťs de l'…glise gallicane, il n'imagina rien de
mieux que d'en rťfťrer au Pape en lui envoyant la copie du projet de
loi et de tous les documents confiťs ŗ la commission.
Le Pape lui rťpondit qu'il fallait s'opposer ŗ la promulgation de
cette loi par tous les moyens possibles, l'autorisant mÍme
textuellement ŗ employer en sŻretť de conscience la _ruse_ et
l'_astuce_.
Monsieur de Marcellus, plus bon que mťchant dans le fond, profita mal
du conseil car il alla porter ce singulier bref au duc de Richelieu
qui entra dans une fureur extrÍme. Il le menaÁa de le traduire devant
les tribunaux pour avoir rťvťlť le secret d'…tat ŗ une Cour
ťtrangŤre, lui dit que, si cet ancien rťgime, qu'il affectait de
regretter, subsistait encore, on le ferait pourrir dans une prison
d'…tat et, par gr‚ce encore, pour ťviter que le Parlement ne le
dťcrťt‚t de prise de corps et ne lui fÓt un plus mauvais parti, etc.
Monsieur de Marcellus fut tout ťbahi d'une scŤne si bien carabinťe; il
comprit mÍme son tort; mais le parti jťsuite, trŤs puissant et tout
ultramontain, lui donna de grands ťloges. Monsieur le prit sous sa
protection spťciale et le bruit s'apaisa.
Seulement, il me semble que les nťgociations ŗ Rome furent retirťes ŗ
monsieur de Blacas, soupÁonnť d'avoir eu connaissance de cette
intrigue, et qu'on y envoya monsieur Portalis. Celui-ci parvint ŗ
faire signer un concordat oý les libertťs gallicanes ťtaient aussi
bien mťnagťes que les circonstances le permettaient. Le roi Louis
XVIII n'y tenait pas assez pour les dťfendre vivement contre son
frŤre.
CHAPITRE XV
Coup de pistolet tirť au duc de Wellington. -- On trouve
l'assassin. -- Inquiťtude de Monsieur sur la retraite des
ťtrangers. -- Agitation dans les esprits. -- TťnŤbres ŗ la
chapelle des Tuileries. -- Le duc de Rohan ŗ Saint-Sulpice. --
Ses ridicules. -- Le duc de Rohan se fait prÍtre. -- Une aventure
ŗ Naples. -- Faveur du prince de Talleyrand. -- Bal chez le duc
de Wellington. -- Testament de la reine Marie-Antoinette. -- Mort
de la petite princesse d'Orlťans, nťe ŗ Twickenham. -- Mort de
monsieur le prince de Condť. -- Son oraison funŤbre.
Peu de jours aprŤs mon arrivťe ŗ Paris, nous fŻmes tous mis en grand
ťmoi par une tentative d'assassinat commise sur la personne du duc de
Wellington. Un coup de pistolet avait ťtť tirť sur sa voiture au
milieu de la nuit, comme il rentrait dans son hŰtel de la rue des
Champs-…lysťes.
Cet ťvťnement pouvait avoir les plus f‚cheuses consťquences. Le duc de
Wellington ťtait le personnage le plus important de l'ťpoque; tout le
monde en ťtait persuadť, mais personne autant que lui. Son
mťcontentement aurait ťtť une calamitť. Tout ce qui tenait au
gouvernement fit donc une trŤs grosse affaire de cet attentat et le
lendemain le duc ťtait d'assez bonne humeur.
Mais on ne dťcouvrait rien. Personne n'avait ťtť blessť; on ne
retrouvait point de balle; le coup avait ťtť tirť en pleine obscuritť
contre une voiture allant grand train. Tout cela paraissait suspect.
L'opposition rťpandit le bruit que le duc, d'accord avec le parti
ultra, s'ťtait fait tirer un coup de pistolet ŗ poudre pour saisir ce
prťtexte de prolonger l'occupation.
Il faut rendre justice au duc de Wellington; il ťtait incapable
d'entrer dans une pareille machination; mais il conÁut beaucoup
d'humeur de ces propos, et, il le faut rťpťter, notre sort dťpendait
en grande partie de ses bonnes dispositions, car, lui seul pouvait
prendre l'initiative et affirmer aux souverains que la prťsence en
France de l'armťe d'occupation, dont il ťtait gťnťralissime, avait
cessť d'Ítre nťcessaire au repos de l'Europe.
Toute la police ťtait en mouvement sans rien dťcouvrir. Les ultras se
frottaient les mains et assuraient que les ťtrangers sťjourneraient
cinq annťes de plus. Enfin on eut des rťvťlations de Bruxelles. Milord
Kinnaird, fort avant dans le parti rťvolutionnaire mais en deÁŗ
pourtant de l'assassinat, dťnonÁa l'envoi d'un nommť Castagnon par le
comitť rťvolutionnaire sťant ŗ Bruxelles oý tous les anciens jacobins,
prťsidťs par les rťgicides expulsťs du royaume, s'ťtaient rťfugiťs. On
acquit la preuve que ce Castagnon avait tirť contre le duc. Il fut
dťfťrť aux tribunaux et sťvŤrement puni et le duc se tint pour
satisfait. Il entrait consciencieusement dans le projet de libťrer la
France des troupes sous ses ordres, mais on pouvait toujours redouter
ses caprices.
La diminution de l'armťe obtenue l'annťe prťcťdente donnait droit ŗ de
grandes espťrances. Toutefois, les traitťs portaient cinq ans de cette
occupation, si onťreuse et si humiliante, et la troisiŤme ťtait ŗ
peine commencťe. Tous les soins du gouvernement ťtaient employťs ŗ
obtenir notre dťlivrance. Il ťtait contrecarrť par le parti ultra qui
ťprouvait, ou feignait, une grande alarme de voir l'armťe ťtrangŤre
quitter la France.
Monsieur avait dit au duc de Wellington, et malheureusement assez
haut pour que cela fŻt entendu et rťpťtť:
ęSi vous vous en allez, je veux m'en aller aussi.
--Oh! que non, Monseigneur, avait rťpondu le duc; vous y penserez
mieux.Ľ
Quelques semaines plus tard, un petit ťcrit professant la convenance
de prolonger l'occupation, loin de chercher ŗ l'abrťger, fut distribuť
ŗ profusion; il ťtait anonyme, mais l'enveloppe portait pour timbre:
_Chambre de Monsieur_.
On l'attribua ŗ monsieur de Bruges. C'ťtait le prťcurseur de la
fameuse _Note secrŤte_. Toutes ces petites circonstances fondaient
l'immense impopularitť sous laquelle Charles X a succombť en trois
jours, quelques annťes aprŤs.
Ces intrigues agissaient mÍme sur les personnes qui n'y prenaient
aucune part. Il rťgnait une inquiťtude gťnťrale qui ne paraissait pas
justifiťe par la situation oý nous nous trouvions. DŤs en arrivant,
j'avais eu les oreilles rabattues par l'annonce de la _grande
conspiration_. Je demandais qui en faisait partie, on me rťpondait:
ęJe n'en sais rienĽ, mais on ajoutait avec un air capable: ęTenez pour
sŻr que nous marchons sur un volcan, et certes ce n'est pas monsieur
Decazes qui nous sauvera!Ľ
Il ťtait, de plus en plus, en butte ŗ la haine du parti de la Cour.
ņ force d'entendre rťpťter ces paroles, je finissais par Ítre ťbranlťe
ŗ mon tour, lorsqu'une circonstance puťrile me rťtablit dans mon
assiette en me montrant sur quels fondements fragiles on ťchafaudait
les nouvelles. J'assistais ŗ tťnŤbres ŗ la chapelle des Tuileries; on
frappe un coup lťger ŗ la porte de la tribune royale. Une fois; pas de
rťponse; Madame jette un coup d'oeil irritť derriŤre elle. Une
seconde; pas encore de rťponse. Une troisiŤme; le Roi ordonne
d'ouvrir. On lui remet un billet, il le lit, fait signe au major
gťnťral de la garde royale, lui dit quelques mots tout bas. Celui-ci
sort et tťnŤbres s'achŤvent au milieu de l'agitation de la
Congrťgation.
Plus de doute, la grande conspiration a ťclatť. Des courtisans
trouvent moyen de sortir de la chapelle pour aller en rťpandre la
nouvelle, mÍme ŗ la Bourse, assure-t-on. Rendu dans ses appartements,
le Roi annonce que la salle de l'Odťon a pris feu et que le ministre
de la police demande des troupes pour maintenir l'ordre. AussitŰt les
dťvots de se rťcrier sur le scandale de troubler le service divin pour
un thť‚tre qui brŻle et les courtisans de s'indigner qu'on vienne
dťranger le Roi pour si mince affaire.
ęComment trouvez-vous monsieur Decazes? Il fait passer ses ordres par
le Roi ŗ prťsent! C'est une nouvelle mťthode assurťment!Ľ
Le soir, il ťtait rťpandu dans la ville que l'incendie de l'Odťon
ťtait le commencement d'exťcution d'une grande conspiration; et, ŗ la
Cour, oý on ťtait un peu mieux informť quoique beaucoup plus bÍte, il
n'ťtait question que de l'insolence de ces coups rťpťtťs frappťs ŗ la
porte de la tribune royale. Il semblait qu'on l'eŻt abattue ŗ coups de
hache. C'ťtait aux Tuileries un bien plus grand ťvťnement que la
destruction d'un des beaux monuments de la capitale.
Cette scŤne de la chapelle me rafraÓchit la mťmoire d'un incident dont
je fus tťmoin ŗ Saint-Sulpice, ce mÍme carÍme, un jour oý l'abbť
Frayssinous y prÍchait. Les sermons ťtaient fort courus et, le
ministre de la police ayant annoncť le projet d'y assister, le banc de
l'oeuvre lui fut rťservť.
Un ťquipage avec plusieurs valets en grande livrťe s'arrÍta au
portail. Un homme en uniforme en sortit, c'ťtait ťvidemment le
ministre. Le suisse arriva en toute h‚te, hallebarde en main, ouvrant
la route ŗ Monseigneur. Le bedeau suivait; il s'adressa ŗ Alexandre de
Boisgelin (passablement gobeur de son mťtier) pour lui demander s'il
ťtait de la suite de Son Excellence.
ęDe quelle Excellence?
--Du ministre de la police.
--Oý est-il?
--Lŗ, le suisse prťcŤde.
--Mais ce n'est pas le comte Decazes, c'est le duc de Rohan.Ľ
AussitŰt voilŗ le bedeau au petit galop courant aprŤs le suisse pour
le ramener ŗ son poste du portail, et le duc de Rohan, dťpouillť de
ses honneurs usurpťs, laissť tout seul au milieu de l'ťglise, obligť
d'ťtablir son habit de pair sur une simple chaise de paille, ŗ nos
cŰtťs, comme le plus humble d'entre nous. Les rieurs furent contre
monsieur de Rohan, en dťpit des prťjugťs aristocratiques qui lui
auraient volontiers donnť prťcťdence sur monsieur Decazes. Ses
ridicules ťtaient trop flagrants.
Auguste de Chabot, jeune homme qui ne manquait ni d'esprit, ni
d'instruction, avait ťtť _presque_ forcť d'Ítre chambellan de
l'Empereur. Il se conduisit avec dignitť, convenance et simplicitť ŗ
la Cour impťriale. ņ la Restauration, il prit le titre de prince de
Lťon et les fumťes de la vanitť lui montŤrent ŗ la tÍte.
Il perdit sa femme, mademoiselle de Sťrent, riche hťritiŤre, par un
horrible accident, et peu de mois avant [l'ťpoque ŗ] laquelle je suis
arrivťe, la mort de son pŤre l'avait mis en possession du titre de duc
de Rohan et de la pairie. Ces honneurs, bien prťvus pourtant,
achevŤrent de l'enivrer d'orgueil. Il devint le vťritable ťmule du
marquis de TuffiŤres.
Il portait ses prťtentions aristocratiques jusqu'ŗ l'extravagance. Son
ch‚teau de la Roche-Guyon fut dťcorť de tous les emblŤmes de la
fťodalitť. Ses gens l'appelaient monseigneur. Il ťtait toujours en
habit de pair, et en avait fait adopter le collet et les parements
brodťs ŗ une robe de chambre dans laquelle il donnait ses audiences le
matin, rappelant ainsi feu le marťchal de Mouchy qui s'ťtait fait
faire un cordon bleu en tŰle pour le porter dans son bain.
Aussi madame de Puisieux disait-elle, en voyant un portrait fort
ressemblant du duc de Rohan:
ęOh! c'est bien Auguste; et puis voyez, ajoutait-elle en indiquant un
ťcusson de ses armes peint dans le coin du tableau, voyez, voilŗ
l'expression de sa physionomie.Ľ
Le duc de Rohan vint ťtaler son importance en Angleterre dans l'espoir
que son titre lui procurerait la main d'une riche hťritiŤre. Celle de
ma belle-soeur avait ťtť demandťe par lui l'annťe prťcťdente et, pour
ennoblir cette alliance qui lui paraissait bien un peu indigne de lui,
il s'ťtait servi de l'intermťdiaire du Roi. Cet auguste nťgociateur
ayant ťchouť auprŤs de mademoiselle DestilliŤres, le duc n'avait plus
vu en France de parti assez riche pour aspirer ŗ l'honneur de partager
son nom et son rang.
Le voyage de spťculation matrimoniale en Angleterre ťtant restť
ťgalement sans succŤs, il se dťcida ŗ embrasser l'ťtat ecclťsiastique.
Il s'entoura de jeunes prÍtres et fit son sťminaire dans les salons de
la Roche-Guyon. Je ne sais comment cela put s'arranger, mais il est
avec le ciel des accommodements.
Les mauvaises langues prťtendaient que le cťlibat n'imposait pas trop
de gÍne ŗ monsieur de Rohan. J'ai su trŤs positivement un fait dont
chacun tirera les consťquences qu'il lui plaira.
En 1813, Auguste de Chabot, alors chambellan de l'Empereur, d'une
jolie figure, plein de talent, dessinant trŤs bien, chantant ŗ ravir,
assez spirituel et surtout franÁais arrivant de Paris, obtint ŗ Naples
de doux regards de la Reine, femme de Murat et rťgente en l'absence de
son mari.
Une vive coquetterie s'ťtablit entre eux. Des apartťs, des promenades
solitaires, des lettres, des portraits s'ensuivirent. La Reine avait
la tÍte tournťe et ne s'en cachait pas. Les choses allŤrent si loin,
quoique monsieur de Chabot profess‚t dŤs lors les principes d'une
certaine dťvotion ostensible, qu'il reÁut la clef d'une porte dťrobťe
conduisant ŗ l'appartement de la Reine. Le moment de l'entrevue fut
fixť ŗ la nuit suivante. Auguste s'y rendit.
Le lendemain matin, il reÁut un passeport pour quitter Naples dans la
journťe. Un messager plus intime vint en mÍme temps lui redemander
l'ťlťgante petite boÓte qui contenait la clef.
Depuis ce jour, la Reine, qui en paraissait sans cesse occupťe
jusque-lŗ, n'a plus prononcť son nom. Monsieur de Chabot n'a jamais pu
comprendre le motif de cette disgr‚ce, car il se rendait la justice
d'avoir ťtť parfaitement respectueux.
Le portrait lui resta, et je l'ai vu entre les mains de la personne
confidente de cette intrigue ŗ laquelle il en fit don au moment oý il
entra dans les ordres.
Quoi qu'il en soit, son choix de l'ťtat ecclťsiastique ne l'empÍcha
pas de conserver toutes les habitudes du _dandysme_ le plus outrť; ses
recherches de toilette ťtaient sans nombre. Il entama avec la Cour de
Rome une longue et vive nťgociation pour faire donner ŗ la chasuble
une coupe nouvelle qui lui paraissait ťlťgante. Au reste, il faut
reconnaÓtre qu'il disait la messe plus gracieusement qu'aucune autre
personne et pourtant trŤs convenablement.
Ces ambitions futiles n'arrÍtaient pas les autres. Il devint
promptement archevÍque et cardinal; je crois qu'au fond c'ťtait lŗ le
secret vťritable de sa vocation. Les carriŤres civiles et militaires
se trouvaient encombrťes; il se croyait de la capacitť, avec raison
jusqu'ŗ un certain point, et s'ťtait jetť dans celle de l'…glise. Mais
j'anticipe; revenons au printemps de 1818.
J'avais laissť monsieur de Talleyrand honni au pavillon de Marsan; je
le retrouvai dans la plus haute faveur de Monsieur et de son monde.
Elle ťclata surtout aux yeux du public ŗ un bal donnť par le duc de
Wellington oý les princes assistŤrent.
Je me le rappelais l'annťe prťcťdente dans cette mÍme salle, se
traÓnant derriŤre les banquettes pour arriver jusqu'ŗ la duchesse de
Courlande; elle lui avait rťservť une place ŗ ses cŰtťs oý personne ne
vint le troubler. Monsieur le duc d'AngoulÍme, seul de tous les
princes, lui adressa quelques mots en passant; mais, cette fois,
l'attitude ťtait bien changťe. Il traversait la foule qui s'ťcartait
devant lui; les poignťes de main l'accueillaient et le conduisaient
droit sur Monsieur; monsieur le duc de Berry s'emparait de cette main
si courtisťe pour ne la cťder qu'ŗ Monsieur. Les entours ťtaient
ťgalement empressťs.
Je n'ai pas suivi le fil de cette intrigue dont le rťsultat se
dťployait avec tant d'affectation sous nos yeux. J'ai peine ŗ croire
que monsieur de Talleyrand eŻt flattť les voeux de Monsieur qui, ŗ
cette ťpoque, dťsirait par-dessus tout le maintien de l'occupation.
Monsieur de Talleyrand ťtait trop habile ŗ t‚ter le pouls du pays
pour ne pas reconnaÓtre que la fiŤvre d'indťpendance s'accroissait
chaque jour et ferait explosion si on ne la prťvenait; mais
certainement il s'unissait ŗ toutes les intrigues pour chasser le duc
de Richelieu, et c'ťtait lŗ un suffisant motif d'alliance.
J'eus encore, ŗ ce bal, occasion de remarquer le peu d'obligeance de
nos princes. Le duc de Wellington vint proposer ŗ Madame, vers le
milieu de la soirťe, de faire le tour des salles. Il ťtait indiquť de
prendre son bras, et tout grand personnage qu'il ťtait il en aurait
ťtť flattť. Mais Madame donna le bras ŗ monsieur le duc de Berry,
madame la duchesse de Berry ŗ Monsieur (monsieur le duc d'AngoulÍme,
selon son usage, ťtait dťjŗ parti) et le duc de Wellington fut rťduit
ŗ marcher devant la troupe royale en ťclaireur.
Elle arriva ainsi jusqu'ŗ un dernier salon oý Comte (le physicien)
faisait des tours. Il lui fallait en ce moment un compŤre
souffre-douleur. Il jeta son dťvolu sur monsieur de Ruffo, fils du
prince Castelcicala, ambassadeur de Naples, dont la figure niaise
prÍtait au rŰle qu'il devait jouer. Il fit trouver des cartes dans ses
poches, dans sa poitrine, dans ses chausses, dans ses souliers, dans
sa cravate; c'ťtait un dťluge.
Les princes riaient aux ťclats, rťpťtant de la voix qu'on leur
connaÓt: c'est monsieur de Ruffo, c'est monsieur de Ruffo. Or, ce
monsieur de Ruffo ťtait presque de leur intimitť, et pourtant, lorsque
le tour fut achevť, ils quittŤrent l'appartement sans lui adresser un
mot de bontť, sans faire un petit compliment ŗ Comte dont la rťvťrence
le sollicitait, enfin avec une maussaderie qui me crucifiait car j'y
prenais encore un bien vif intťrÍt.
Peu de semaines avant, j'avais vu chez mon pŤre, ŗ Londres, le prince
rťgent, qui pourtant aussi ťtait assez grand seigneur, assister ŗ une
reprťsentation de ce mÍme monsieur Comte, et y porter des faÁons bien
diffťrentes.
Je me suis laissť raconter que rien n'ťtait plus obligeant que la
reine Marie-Antoinette. Madame avait repoussť cet hťritage, peut-Ítre
avec intention, car la mťmoire de sa mŤre lui ťtait peu chŤre. Toutes
ses adorations ťtaient pour son pŤre, et, avec ses vertus, elle avait
pris ses formes peu gracieuses.
Il y eut vers ce temps une rťvolution bien frappante des sentiments de
Madame. Monsieur Decazes retrouva dans les papiers de je ne sais quel
terroriste de 1793 le testament autographe de la reine Marie-Antoinette
qui, assurťment, fait le plus grand honneur ŗ sa mťmoire. Il le porta au
Roi qui lui dit de l'offrir ŗ Madame. Elle le lui remit quelques heures
aprŤs, avec la phrase la plus froide possible, sur ce qu'en effet elle
reconnaissait l'ťcriture et l'authenticitť de la piŤce.
Monsieur Decazes en fit faire des fac-similťs et en envoya un paquet ŗ
Madame; elle n'en distribua pas un seul, et tťmoigna plutŰt de
l'humeur dans toute cette occurrence. Toutefois ce testament a ťtť
gravť dans la chapelle expiatoire de la rue d'Anjou qui se
construisait sous son patronage.
Si Madame ťtait sťvŤre ŗ la mťmoire de sa mŤre, elle ťtait
passionnťment dťvouťe ŗ celle de son pŤre et cette corde de son ‚me
vibrait toujours jusqu'ŗ l'exaltation.
Comme je sortais du bal du duc de Wellington, je me trouvai auprŤs du
duc et de la duchesse de Damas-Crux, ultras forcenťs, qui, comme moi,
attendaient leur voiture. …douard de Fitz-James passa; je lui donnai
une poignťe de main, puis monsieur Decazes, encore une poignťe de
main, puis Jules de Polignac, nouvelle poignťe de main, puis Pozzo,
encore plus amicale poignťe de main.
ęVous en connaissez de toutes les couleursĽ, me dit le duc de Damas.
--Oui, rťpondis-je, ceux qui se proclament les serviteurs du Roi; et
ceux qui le servent en effet.Ľ
Il ťtait si bÍte qu'il me fit une mine de reconnaissance; mais la
duchesse me lanÁa un regard furieux et ne me l'a jamais pardonnť.
La famille d'Orlťans, dont les formes affables et obligeantes
faisaient un contraste si marquť ŗ celles de la branche aÓnťe,
n'assistait pas ŗ ce bal, autant qu'il m'en souvient. Elle ťtait dans
la douleur. La petite princesse, nťe en Angleterre, ťtait ŗ toute
extrťmitť et mourut, en effet, peu de jours aprŤs.
La mort frappait ŗ la fois ŗ deux extrťmitťs de la maison de Bourbon.
Le vieux prince de Condť achevait en mÍme temps sa longue carriŤre en
invoquant vainement la prťsence de ses enfants pour lui fermer les
yeux. J'ai dťjŗ dit la vie qui retenait monsieur le duc de Bourbon sur
les trottoirs de Londres.
Madame la princesse Louise se refusa ťgalement ŗ adoucir les derniers
moments de son pŤre, prťtendant ne pouvoir quitter sa maison du Temple
oý elle s'ťtait cloÓtrťe, quoique toutes les autoritťs ecclťsiastiques
l'y autorisassent et que le cardinal de Talleyrand, archevÍque de
Paris, all‚t lui-mÍme la chercher. Ce sont de ces vertus que je n'ai
jamais pu ni comprendre, ni admirer.
Monsieur le prince de Condť mourut dans les bras de madame de Rouilly,
fille naturelle de monsieur le duc de Bourbon; elle lui prodigua les
soins les plus filiaux et les plus tendres.
Monsieur le duc de Bourbon arriva quelques heures aprŤs la mort de son
pŤre: il parut fort malheureux de n'avoir pu le revoir, et d'autant
plus que le vieux prince semblait, dans ses derniers jours, avoir
repris la mťmoire qu'il avait perdue depuis quelques annťes et
regretter amŤrement l'absence de son fils. Monsieur le duc de Bourbon
conserva son nom, disant que celui de Condť ťtait trop lourd ŗ porter.
Il s'ťtablit au Palais-Bourbon et ŗ Chantilly oý il ne tarda pas ŗ
donner de nouveaux scandales.
Le service pour monsieur le prince de Condť ŗ Saint-Denis fut trŤs
magnifique; je ne me rappelle plus en quoi on dťrogea aux usages, mais
il y eut quelque chose de trŤs marquť, en ce genre, pour honorer plus
royalement sa mťmoire. Le roi Louis XVIII affectait de lui rendre plus
qu'il n'ťtait dŻ ŗ son rang, selon l'ťtiquette de la Cour de France,
peut-Ítre pour marquer encore plus la sťvŤre dťsobligeance avec
laquelle il l'imposait ŗ monsieur le duc d'Orlťans.
Je me souviens que cet enterrement fut une grande affaire ŗ la Cour.
Pendant ce temps, le public et le ministŤre se prťoccupaient du
discours. Le pas ťtait glissant; il s'agissait du gťnťral des ťmigrťs.
Il ťtait difficile d'aborder ce sujet de maniŤre ŗ satisfaire les uns
et les autres; car, si _les uns_ ťtaient au pouvoir, _les autres_
c'ťtait le pays.
L'abbť Frayssinous, chargť de l'oraison funŤbre, s'en tira habilement.
Je me rappelle entre autres une phrase qui eut grand succŤs. En
parlant des deux camps franÁais opposťs l'un ŗ l'autre, il dit: ę_La
gloire ťtait partout, le bonheur nulle part_Ľ. En rťsultat, le
discours ne dťplut absolument ŗ aucun parti; c'ťtait le mieux qu'on en
pŻt espťrer.
CHAPITRE XVI
Mort de madame de StaŽl. -- Effet de son ouvrage sur la
Rťvolution. -- Je retourne ŗ Londres. -- Agents du parti ultra.
-- Prťsentation de la note secrŤte. -- Le Roi Űte le commandement
des gardes nationales ŗ Monsieur. -- Fureur de Jules de Polignac.
-- Conspiration du bord de l'eau. -- CongrŤs d'Aix-la-Chapelle.
-- Le duc de Richelieu obtient la libťration du territoire.
J'ai nťgligť de parler dans le temps de la mort de madame de StaŽl.
Elle avait eu lieu, pendant un de mes sťjours en Angleterre, ŗ la
suite d'une longue maladie qu'elle avait traÓnťe le plus tard possible
dans ce monde de Paris qu'elle apprťciait si vivement. Elle y faisait
peine ŗ voir au commencement des soirťes. Elle arrivait ťpuisťe par la
souffrance mais, au bout de quelque temps, l'esprit prenait
complŤtement le dessus de l'instinct, et elle ťtait aussi brillante
que jamais, comme si elle voulait tťmoigner jusqu'au bout de cette
inimitable supťrioritť qui l'a laissťe sans pareille.
La derniŤre fois que je la vis, c'ťtait le matin; je partais le
lendemain. Depuis quelques jours, elle ne quittait plus son sopha; les
taches livides dont son visage, ses bras, ses mains ťtaient couverts
n'annonÁaient que trop la dťcomposition du sang. Je sentais la pťnible
impression d'un adieu ťternel et sa conversation ne roulait que sur
des projets d'avenir. Elle ťtait occupťe de chercher une maison oý sa
fille, la duchesse de Broglie, grosse et prÍte d'accoucher, serait
mieux logťe.
Elle faisait des plans de vie pour l'hiver suivant. Elle voulait
rester plus souvent chez elle, donner des dÓners frťquents. Elle
dťsignait par avance des habituťs. Cherchait-elle ŗ s'ťtourdir
elle-mÍme? Je ne sais; mais le contraste de cet aspect si plein de
mort et de ces paroles si pleines de vie ťtait dťchirant; j'en sortis
navrťe.
Il y avait une trop grande diffťrence d'‚ge et assurťment de mťrite
entre nous pour que je puisse me vanter d'une liaison proprement dite
avec madame de StaŽl, mais elle ťtait extrÍmement bonne pour moi et
j'en ťtais trŤs flattťe. Le mouvement qu'elle mettait dans la sociťtť
ťtait prťcisťment du genre qui me plaisait le plus, parce qu'il
s'accordait parfaitement avec mes goŻts de paresse.
C'ťtait sans se lever de dessus son sopha que madame de StaŽl animait
tout un cercle; et cette activitť de l'esprit m'est aussi agrťable que
celle du corps me paraÓt assommante. Quand il me faut aller chercher
mon plaisir ŗ grands frais, je cours toujours risque de le perdre en
chemin.
Sans Ítre pour moi une peine de coeur, la mort de madame de StaŽl me
fut donc un chagrin. Le dťsespoir de ses enfants fut extrÍme. Ils
l'aimaient passionnťment et la rťvťlation faite sur son lit de douleur
et dont j'ai dťjŗ parlť n'affaiblit ni leur sentiment ni leurs
regrets.
Auguste de StaŽl se rendit l'ťditeur d'un ouvrage auquel elle
travaillait et qui parut au printemps de 1818. Il produisit un effet
dont les rťsultats n'ont pas ťtť sans importance. Pendant l'Empire, la
Rťvolution de 1793 et ceux qui y avaient pris part ťtaient honnis. La
Restauration ne les avait pas rťhabilitťs et personne ne rťclamait le
dangereux honneur d'avoir travaillť ŗ renverser le trŰne de Louis XVI.
On aurait vainement cherchť en France un homme qui voulŻt se
reconnaÓtre ouvrier en cette oeuvre. Les rťgicides mÍmes s'en
dťfendaient; une circonstance fortuite les avait poussťs dans ce
prťcipice, et, somme toute, le _petit chat_ (peut-Ítre encore parce
qu'il ne savait pas s'en expliquer) se trouvait le seul coupable.
Le livre de madame de StaŽl changea tout ŗ coup cette disposition, en
osant parler honorablement de la Rťvolution et des rťvolutionnaires.
La premiŤre, elle distingua les principes des actes, les espťrances
trompťes des honnÍtes gens des crimes atroces qui souillŤrent ces
jours nťfastes et ensevelirent sous le sang toutes les amťliorations
dont ils avaient cru doter la patrie. Enfin elle releva tellement le
nom de rťvolutionnaire que, d'une cruelle injure qu'il avait ťtť
jusque-lŗ, il devint presque un titre de gloire. L'opposition ne le
repoussa plus. Les libťraux se reconnurent successeurs des
rťvolutionnaires et firent remonter leur filiation jusqu'ŗ 1789.
Messieurs de Lafayette, d'Argenson, de Thiard, de Chauvelin, de
Girardin, etc., formŤrent les anneaux de cette chaÓne. Les Lameth,
quoique rťclamant le nom de patriotes de 89, et repoussťs par les
ťmigrťs et la Restauration, ne s'ťtaient pas ralliťs ŗ l'opposition
antiroyaliste. Ils demeuraient libťraux assez modťrťs, aprŤs avoir
servi ŗ l'Empereur avec bien moins de zŤle que ceux dont je viens de
citer les noms.
Je crois que cet ouvrage posthume de madame de StaŽl a ťtť un funeste
prťsent fait au pays et n'a pas laissť de contribuer ŗ rťhabiliter cet
esprit rťvolutionnaire dans lequel la jeunesse s'est retrempťe depuis
et dont nous voyons les funestes effets. DŤs que le livre de madame de
StaŽl en eut donnť l'exemple, les hymnes ŗ la gloire de 1789 ne
tarirent plus. Il y a bien peu d'esprits assez justes pour savoir
n'extraire que le bon grain au milieu de cette sanglante ivraie.
Aussi avons-nous vu depuis encenser jusqu'au nom de Robespierre.
Le troisiŤme volume est presque entiŤrement ťcrit par Benjamin
Constant; la diffťrence de style et surtout de pensťe s'y fait
remarquer. Il est plus amŤrement rťpublicain; les goŻts
aristocratiques qui percent toujours ŗ travers le plťbťisme de madame
de StaŽl ne s'y retrouvent pas.
Une fiŤvre maligne, dont je pensai mourir, me retint plusieurs
semaines dans ma chambre. Je n'en sortis que pour soigner ma
belle-soeur qui fit une fausse couche de quatre mois et demi et ne
laissa pas de nous donner de l'inquiťtude pour elle et beaucoup de
regrets pour le petit garÁon que nous perdÓmes. AussitŰt qu'elle fut
rťtablie, je retournai ŗ Londres.
L'affaire des liquidations, fixťe enfin ŗ seize millions pour les
rťclamations particuliŤres, avait fort occupť mon pŤre. Il avait sans
cesse vu renaÓtre les difficultťs, qu'il croyait vaincues, sans
pouvoir comprendre ce qui y donnait lieu. Une triste dťcouverte
expliqua ces retards.
La loyautť de monsieur de Richelieu avait dŻ se rťsigner aux roueries
inhťrentes aux nťcessitťs gouvernementales. Il s'ťtait apprivoisť
depuis mon aventure au sujet du docteur Marshall. Le _cabinet noir_
lui apporta les preuves les plus flagrantes de la faÁon dont monsieur
Dudon, commissaire de la liquidation, vendait les intťrÍts de la
France aux ťtrangers, ŗ beaux deniers comptants.
Des lettres interceptťes, ťcrites ŗ Berlin, et lues ŗ la poste de
Paris, en faisaient foi. Le duc de Richelieu chassa monsieur Dudon
honteusement; mais, ne pouvant publier la nature des rťvťlations qui
justifiaient sa dťmarche, il se fit de monsieur Dudon un ennemi
insolent. Devenu, immťdiatement, royaliste de la plus ťtroite
observance, monsieur Dudon se donna pour victime de la puretť de ses
opinions et n'a pas laissť d'Ítre incommode par la suite.
DŤs qu'il eut ťtť remplacť par monsieur Mounier, les affaires
marchŤrent. L'intťgritť de celui-ci dťbrouilla ce que l'autre avait
volontairement embrouillť. Les liquidations furent promptement rťglťes
et la conclusion fut un succŤs pour le gouvernement. C'est ŗ cette
occasion que s'est formťe la liaison intime du duc de Richelieu avec
monsieur Mounier.
ņ mesure que les affaires d'argent s'aplanissaient, l'espoir de notre
ťmancipation se rapprochait et les fureurs du parti ultra
s'exaspťraient dans la mÍme proportion. Sa niaiserie ťtait ťgale ŗ son
intolťrance.
Je me souviens qu'avant de quitter Paris j'entendais dťblatťrer contre
le gouvernement qui exigeait des capitalistes franÁais 66 d'un emprunt
nouveau, tandis qu'il n'avait pu obtenir que 54 l'annťe prťcťdente de
messieurs Baring et Cie; faisant crime au ministŤre que le crťdit
public se fŻt, en quelques mois, ťlevť de 12 pour 100 sous son
administration! Il faut avoir vťcu dans les temps de passion pour
croire ŗ de pareilles sottises.
Nous vÓmes arriver successivement ŗ Londres plusieurs envoyťs de
Monsieur, les Crussol, les Fitz-James, les La Ferronnays, les de
Bruges, etc. Mon pŤre ťtait trŤs bien instruit de leur mission; les
ministres anglais en ťtaient indignťs. Le duc de Wellington signalait
d'avance la faussetť de leurs rapports. Tous venaient reprťsenter la
France sous l'aspect le plus sinistre et le plus dangereux pour le
monde et rťclamaient la prolongation de l'occupation ťtrangŤre.
Le duc de Fitz-James forÁa tellement la mesure que lord Castlereagh
lui dit:
ęSi ce tableau ťtait exact, il faudrait sur-le-champ rappeler nos
troupes, former un cordon autour de la France et la laisser se dťvorer
intťrieurement. Heureusement, monsieur le duc, nous avons des
renseignements moins effrayants ŗ opposer aux vŰtres.Ľ
L'expression de ces messieurs, en parlant de mon pŤre, ťtait que
c'ťtait dommage mais qu'il avait passť ŗ l'ennemi. Quel bonheur pour
la monarchie, si elle avait ťtť exclusivement entourťe de pareils
ennemis! Monsieur de Richelieu, selon eux, avait eu de bonnes
intentions mais il ťtait perverti.
Quant aux autres ministres, c'ťtaient des gueux et des scťlťrats:
messieurs Decazes, Lainť, Pasquier, Molť, Corvetto; il n'y avait
rťmission pour personne. ņ mesure que la libťration de la patrie
approchait, l'anxiťtť du parti redoublait. Je crois que c'est ŗ cette
ťpoque que parut le _Conservateur_. Cette publication hebdomadaire
avait pour rťdacteur principal monsieur de Chateaubriand, mais tous
les coryphťes parmi les ultras y dťposaient leur bilieuse ťloquence.
Cet organe a fait bien du mal au trŰne.
Jules de Polignac arriva le dernier en Angleterre; il ťtait porteur de
la fameuse _note secrŤte_, oeuvre avouťe et reconnue de Monsieur,
quoique monsieur de Vitrolles l'eŻt rťdigťe.
Jamais action plus antipatriotique n'a ťtť conseillťe ŗ un prince;
jamais prince hťritier d'une couronne n'en a fait une plus coupable.
Les cabinets ťtrangers l'accueillirent avec mťpris, et le roi Louis
XVIII en conÁut une telle fureur contre son frŤre que cela lui donna
du courage pour lui Űter le commandement des gardes nationales du
royaume.
Depuis longtemps les ministres sollicitaient du Roi de rendre au
ministŤre de l'intťrieur l'organisation des gardes nationales et de
les remettre sous ses ordres; le Roi en reconnaissait la nťcessitť
mais reculait effrayť des cris qu'allait pousser Monsieur.
Il avait ťtť, dŤs 1814, nommť commandant gťnťral des gardes nationaux
de France. Il avait formť un ťtat-major ŗ son image. Des inspecteurs
gťnťraux allaient chaque trimestre faire des tournťes et s'occupaient
des dispositions des officiers qui tous ťtaient nommťs par Monsieur et
ŗ sa dťvotion. La plupart ťtaient membres de la Congrťgation. Leur
correspondance avec Jules de Polignac, premier inspecteur gťnťral,
ťtait journaliŤre et sa police s'exerÁait avec activitť et passion.
C'ťtait un …tat dans l'…tat, un gouvernement dans le gouvernement, une
armťe dans l'armťe. Ce qu'ŗ juste titre on a nommť le _gouvernement
occulte_ ťtait alors ŗ son apogťe. L'ordonnance qui Űtait le
commandement ŗ Monsieur enlevait au parti une grande portion de son
pouvoir en le privant d'une force armťe aussi ťnorme dont il pouvait
disposer et qui ne recevait d'ordres que de lui.
Jules de Polignac en apprit la nouvelle (car cela avait ťtť tenu fort
secret) par ma mŤre qui lui donna le _Moniteur_ ŗ lire. Malgrť sa
retenue habituelle, il fut assez peu maÓtre de lui pour prononcer
quelques mots, trouvťs si coupables par ma mŤre qu'elle lui dit
vouloir aller aussitŰt les rapporter ŗ mon pŤre pour qu'il en donn‚t
avis au Roi. Averti de son imprudence, il chercha ŗ les tourner en
plaisanterie; mais ne pouvant rťussir ŗ faire prendre le change ŗ ma
mŤre, il eut recours ŗ des supplications, qui allŤrent jusqu'aux
larmes et aux gťnuflexions, et obtint enfin la parole qu'elle ne
rťpťterait pas un propos qu'il assurait n'avoir pas l'importance
qu'elle voulait y donner.
Je n'ai jamais su prťcisťment les mots. Seulement le nom de monsieur
de VillŤle y ťtait mÍlť et j'ai eu lieu de croire que la conspiration,
dite du bord de l'eau, dont la rťalitť n'est rťvoquťe en doute par
aucune des personnes instruites des affaires ŗ cette ťpoque, cette
conspiration, qui avait pour but de faire rťgner Charles X avant que
le Ciel eŻt disposť de Louis XVIII, n'ťtait que le commentaire des
paroles ťchappťes ŗ la colŤre de Jules.
Je n'entre pas dans plus de dťtails sur cet ťvťnement, quoique la
plupart des acteurs parmi les conspirateurs, aussi bien que parmi ceux
qu'ils devaient attaquer, fussent des personnes avec lesquelles nos
relations ťtaient intimes; mais j'ťtais absente lors de la dťcouverte,
et le projet remontait si haut que le ministŤre et le Roi ne voulurent
pas aller jusqu'ŗ la source. On se borna ŗ l'ťventer sans donner
aucune suite aux recherches.
Le Roi en conÁut un mortel chagrin et ne laissa pas ignorer ŗ son
frŤre qu'il en ťtait instruit. Je ne sais pas si monsieur le duc de
Berry ťtait dans le secret; j'espŤre que non. Quant ŗ monsieur le duc
d'AngoulÍme, le parti s'en cachait avec plus de soin que d'aucune
autre personne.
Quoique la sagesse du gouvernement eŻt assoupi le bruit de cette
affaire, le parti ultra se trouva un peu gÍnť par cette dťcouverte. Il
ťtait en position de garder des mesures avec le pouvoir; il devint, ou
du moins chercha ŗ paraÓtre, plus modťrť pendant quelque temps.
Cela ne l'empÍcha pas d'avoir au CongrŤs d'Aix-la-Chapelle des agents
occupťs ŗ dťjouer auprŤs des ťtrangers les nťgociations du duc de
Richelieu. Elles rťussirent cependant et il eut la gloire et le
bonheur de signer le traitť qui dťlivrait son pays d'une garnison
ťtrangŤre. Sans doute c'ťtait encore ŗ titre onťreux, mais la France
pouvait payer les charges qu'elle acceptait; ce qu'elle ne pouvait
plus supporter, c'ťtait l'humiliation de n'Ítre pas maÓtresse chez
elle.
Le respect et la confiance qu'inspirait le caractŤre loyal de monsieur
de Richelieu entrŤrent pour beaucoup dans le succŤs de cette
nťgociation qui nous combla de joie.
Je me rappelle que, le jour oý la signature du traitť fut apprise ŗ
Londres, tout le corps diplomatique et les ministres anglais
accoururent chez mon pŤre lui faire compliment et partager notre
satisfaction. Les hommages pour le duc de Richelieu ťtaient dans
toutes les bouches; chacun avait un trait particulier ŗ citer de son
honorable habiletť.
CHAPITRE XVII
Le comte Decazes veut changer de ministŤre. -- Intrigues contre
le duc de Richelieu. -- Il donne sa dťmission. -- Le gťnťral
Dessolle lui succŤde. -- Mariage de monsieur Decazes. -- Le comte
de Sainte-Aulaire. -- Mon pŤre demande ŗ se retirer. -- Il est
remplacť par le marquis de La Tour-Maubourg. -- Le Roi est
mťcontent de mon pŤre. -- Mes idťes sur la carriŤre diplomatique.
-- Une fournťe de pairs. -- Monsieur de Barthťlemy.
On devait croire qu'aprŤs ses succŤs d'Aix-la-Chapelle le prťsident du
conseil reviendrait ŗ Paris tout-puissant. Il en fut autrement. Les
deux oppositions de droite et de gauche se coalisŤrent pour amoindrir
le rťsultat obtenu, et le parti ministťriel, sous l'influence de
monsieur Decazes, ne se donna que peu de soins pour le montrer dans
toute son importance.
Monsieur de Richelieu ťtait personnellement l'homme le moins propre ŗ
exploiter un succŤs, mais monsieur Decazes s'y entendait fort bien.
Dans cette circonstance, il nťgligea de le vouloir. Des intrigues
intťrieures dans le sein du ministŤre en furent cause. Monsieur
Decazes s'ťtait uni ŗ un parti semi-libťral qui, depuis, a produit ce
qu'on a appelť _les doctrinaires_. Ce parti avait longtemps criť
contre le ministŤre de la police et il persuada ŗ monsieur Decazes
qu'en faisant rťformer ce ministŤre au dťpart des ťtrangers il
semblerait n'avoir ťtť crťť que pour un moment de crise et que le Roi
ferait un acte habile dont la popularitť rejaillirait sur lui.
Monsieur Decazes goŻtait cette pensťe mais ŗ condition, bien entendu,
qu'il resterait ministre et ministre influent. Il en parla ŗ monsieur
de Richelieu qui adopta l'idťe. Monsieur Lainť, ministre de
l'intťrieur, professait sans cesse de son dťsintťressement, de son
abnťgation de toute ambition et de son ennui des affaires.
Monsieur de Richelieu, qui avait, ŗ cette ťpoque, parfaite confiance
en lui et en ses paroles, alla avec la candeur de son caractŤre lui
demander de cťder son portefeuille ŗ Decazes qui en avait envie.
Monsieur Lainť se mit en fureur contre une telle proposition, et le
duc de Richelieu, avec la gaucherie habituelle de sa loyale franchise,
s'en alla rapporter ŗ monsieur Decazes qu'il ne fallait plus penser ŗ
son projet parce que monsieur Lainť ne voulait pas y consentir. Il
reconnaissait bien du reste la convenance de renoncer ŗ avoir un
ministŤre spťcial de la police; il avouait tous les inconvťnients que
monsieur Decazes signalait ŗ le maintenir, mais il faudrait aviser ŗ
un autre moyen de le supprimer.
AprŤs avoir donnť ces ťtranges satisfactions ŗ messieurs Decazes et
Lainť, il partit pour Aix-la-Chapelle en complŤte sťcuritť des bonnes
dispositions de ses collŤgues envers lui. Il put en voir la vanitť au
retour.
Je ne sais pas au juste les intrigues qu'on fit jouer ni les dťgoŻts
dont on l'entoura, mais, ŗ la fin de l'annťe, il dut donner sa
dťmission ainsi que messieurs Pasquier, Molť, Lainť et Corvetto. Le
gťnťral Dessolle devint le chef ostensible du nouveau cabinet dont
monsieur Decazes ťtait le directeur vťritable.
Je n'ai jamais pu comprendre que monsieur Decazes n'ait pas senti que
le beau manteau de cristal pur, dont la prťsidence de monsieur de
Richelieu couvrait son favoritisme, ťtait nťcessaire ŗ la durťe de son
crťdit. Il ne pouvait soutenir le poids des haines dirigťes contre
lui que sous cette noble et transparente ťgide.
Monsieur de Richelieu ne lui enviait en aucune faÁon sa faveur et lui
en laissait toute la puissance, toute l'importance, tous les profits
et aussi tous les ennuis; car ce n'ťtait pas tout ŗ fait un bťnťfice
sans charge de devoir amuser un vieux monarque valťtudinaire tourmentť
dans son intťrieur.
Monsieur Decazes avait ťpousť depuis quelques mois mademoiselle de
Sainte-Aulaire, fille de qualitť riche et ayant par sa mŤre,
mademoiselle de Soyecourt, des alliances presque royales. Ces
relations flattaient monsieur Decazes et plaisaient au Roi. Aussi ce
mariage lui avait ťtť assez agrťable pour qu'il s'en mÍl‚t
personnellement, et cette circonstance avait ťtť une occasion de
rapprochement avec une nuance d'opposition hostile ŗ laquelle
appartenait monsieur de Sainte-Aulaire. Je professe pour celui-ci une
amitiť qui dure tantŰt depuis trente ans. Toutefois je dois avouer
que, dans les premiers moments de la Restauration, il s'ťtait conduit,
au moins, avec maladresse.
Il avait successivement reniť Napolťon dont il ťtait chambellan en
1814, et Louis XVIII en 1815, dans les deux villes de Bar-le-Duc et de
Toulouse dont il se trouvait prťfet ŗ ces deux ťpoques, d'une maniŤre
ostensible et injurieuse qui ne convenait pas mieux ŗ sa position qu'ŗ
son caractŤre et ŗ son esprit, un des plus doux et des plus agrťables
que je connaisse. Mais il y a des circonstances si ťcrasantes qu'elles
trouvent bien peu d'hommes ŗ leur niveau, surtout parmi les gens
d'esprit. Les bÍtes s'en tirent mieux parce qu'elles ne les
comprennent pas.
Sa conduite pendant les Cent-Jours avait jetť monsieur de
Sainte-Aulaire dans les rangs de la gauche. Le mariage de monsieur
Decazes avec mademoiselle de Sainte-Aulaire, au lieu de rapprocher le
ministre du parti aristocratique auquel elle appartenait par sa
naissance, l'avait mis dans la sociťtť de l'opposition et lui donnait,
fort ŗ tort, une nuance de couleur rťvolutionnaire que les ultras
enluminaient de leur palette la mieux chargťe.
Je n'oserais pas assurer que leurs cris, sans cesse rťpťtťs, n'eussent
exercť, ŗ notre insu, quelque influence mÍme sur nous ŗ Londres.
La nouvelle de la retraite de monsieur de Richelieu, ŗ laquelle il ne
s'attendait nullement, fut un coup trŤs sensible ŗ mon pŤre. J'ai dťjŗ
dit que les affaires importantes de l'ambassade se traitaient entre
eux, sans passer par les bureaux, dans des lettres confidentielles et
autographes. Mon pŤre n'avait aucun rapport personnel avec monsieur
Dessolle et ne pouvait continuer avec lui une pareille correspondance.
Il reÁut du nouveau ministre une espŤce de circulaire fort polie dans
laquelle, aprŤs force compliments, on l'avertissait que la politique
du cabinet ťtait changťe.
Mon pŤre avait dťjŗ bien bonne envie de suivre son chef; cette lettre
le dťcida. Il rťpondit que sa t‚che ťtait accomplie. Ainsi que le duc
de Richelieu, il avait cru devoir rester ŗ son poste jusqu'ŗ la
retraite complŤte des ťtrangers, les nťgociations entamťes devant,
autant que possible, Ítre conduites par les mÍmes mains, mais qu'une
nouvelle Ťre semblant commencer dans un autre esprit, il profitait de
l'occasion pour demander un repos que son ‚ge rťclamait.
Nous fŻmes charmťes, ma mŤre et moi, de cette dťcision. La vie
diplomatique m'ťtait odieuse, et ma mŤre ne pouvait supporter la
sťparation de mon frŤre. D'ailleurs, nous nous apercevions que le
travail auquel il s'ťtait consciencieusement astreint fatiguait trop
mon pŤre. Sa bonne judiciaire conservait toute sa force primitive,
mais dťjŗ nous remarquions que sa mťmoire faiblissait.
Lorsqu'un homme a ťtť depuis l'‚ge de trente ans jusqu'ŗ soixante hors
des affaires et qu'il y rentre, ou il les fait trŤs mal, ou bien elles
l'ťcrasent. C'est ce qui arrivait ŗ mon pŤre.
Monsieur Dessolle lui rťpondit en l'engageant ŗ revenir sur sa
dťcision, mais il y persista. Ce n'ťtait pas, disait-il, avec
l'intention de refuser son assentiment au gouvernement du Roi, mais
dans la pensťe qu'un ambassadeur nouvellement nommť serait mieux placť
vis-ŗ-vis du cabinet anglais qu'un homme qui semblerait appelť ŗ se
contredire lui-mÍme.
Une nťgociation, par exemple, ťtait ouverte pour obtenir du roi des
Pays-Bas d'expulser de Belgique le nid de conspirateurs d'oý ťmanaient
les brochures et les agitateurs qui troublaient le royaume. Monsieur
Decazes mettait la plus grande importance ŗ son succŤs et en parlait
quotidiennement au duc de Richelieu qui, pressť par lui, rťclamait les
bons offices du cabinet anglais. Un des premiers soins du ministŤre
Dessolle fut d'adresser des remerciements au roi de Hollande pour la
noble hospitalitť qu'il exerÁait envers des rťfugiťs qu'on espťrait
voir bientŰt rapporter leurs lumiŤres et leurs talents dans la patrie.
La copie de cette piŤce fut produite ŗ mon pŤre par lord Castlereagh,
en rťponse ŗ une note qu'il avait passťe d'aprŤs les anciens
documents. Cela ťtait peut-Ítre sage, mais il fallait un nouveau
nťgociateur pour une nouvelle politique.
Il y eut encore une rťponse de monsieur Dessolle qui semblait disposť,
plus qu'il ne se l'ťtait d'abord proposť, ŗ suivre les traces de son
prťdťcesseur; mais mon pŤre avait annoncť ses projets de retraite ŗ
Londres, et, malgrť toutes les obligeantes sollicitations du Rťgent
et de ses ministres, il resta inflexible.
Le marquis de La Tour-Maubourg fut nommť pour le remplacer. Avec la
franchise de son caractŤre, mon pŤre s'occupa tout de suite activement
de lui prťparer les voies, de faÁon ŗ rendre la position du nouvel
ambassadeur la meilleure possible, dans les affaires et dans la
sociťtť.
Monsieur de La Tour-Maubourg, qui est aussi ťminemment loyal,
ressentit vivement ces procťdťs et en a toujours conservť une sincŤre
reconnaissance. Mon pŤre y ajouta un autre service, car, de retour ŗ
Paris et n'y ayant plus d'intťrÍt personnel, il dťmontra clairement
que l'ambassade de Londres n'ťtait pas suffisamment payťe et fit
augmenter de soixante mille francs le traitement de son successeur.
Si monsieur de La Tour-Maubourg ťtait touchť des procťdťs de mon pŤre,
monsieur Dessolle, en revanche, ťtait piquť de son retour, et monsieur
Decazes en ťtait assez blessť pour avoir irritť le roi Louis XVIII
contre lui.
Le favori n'avait pas tout ŗ fait tort. La retraite d'un homme aussi
considťrť que mon pŤre et qui avait jusque-lŗ marchť dans les mÍmes
voies pouvait s'interprťter comme une rupture, et, malgrť l'extrÍme
modťration des paroles de mon pŤre et de sa famille, les ennemis de
monsieur Decazes ne manquŤrent pas de s'emparer de ce prťtexte pour en
profiter contre lui.
Quelques semaines s'ťtaient ťcoulťes dans les pourparlers entre mon
pŤre et le ministre. Quoique sa dťmission eŻt suivi immťdiatement
celle de monsieur de Richelieu, elle ne fut acceptťe qu'ŗ la fin de
janvier 1819. Je partis aussitŰt pour Paris afin d'y prťparer les
logements.
Je trouvai le Roi fort exaspťrť et disant que, jusqu'ŗ cette heure, il
avait cru que les ambassadeurs accrťditťs par lui le reprťsentaient,
mais que le marquis d'Osmond aimait mieux ne reprťsenter que monsieur
de Richelieu. On voit que le pŤre de la Charte n'avait pas encore tout
ŗ fait dťpouillť le petit-fils de Louis XIV et tenait le langage de
Versailles. Il aurait probablement mieux apprťciť la conduite de mon
pŤre si elle avait ťtť agrťable au favori.
Celui-ci, au reste, m'accueillit avec une bienveillance que j'ai eu
lieu de croire peu sincŤre. Non seulement mon pŤre, qu'on avait comblť
d'ťloges pendant tout le cours de son ambassade, ne reÁut aucune
marque de satisfaction, mais il eut mÍme beaucoup de peine ŗ obtenir
la pension de retraite ŗ laquelle il avait un droit acquis et
indisputable, sous prťtexte que les fonds ťtaient absorbťs. Au reste,
il ne fut pas seul ŗ souffrir le _ben servire e non gradire_: les
ministres sortants, et surtout monsieur de Richelieu, firent une riche
moisson d'ingratitude, ŗ la Cour, aux Chambres et jusque dans le
public.
Monsieur et Madame me traitŤrent avec plus de bontť que de coutume
lorsque j'allai faire ma cour ŗ mon arrivťe de Londres. Monsieur le
duc de Berry voulut me faire convenir que mon pŤre quittait la partie
parce qu'enfin il la voyait entre les mains des Jacobins. Je m'y
refusai absolument, me retranchant sur son ‚ge qui rťclamait le repos,
sur la convenance de quitter les affaires lorsque l'oeuvre de la
libťration du territoire ťtait accomplie, et sur la santť de ma mŤre.
Le prince insista vainement et m'en tťmoigna un peu d'humeur, mais
pourtant avec son amitiť accoutumťe.
Quant aux autres, lorsqu'ils virent qu'aucune de nos allures n'ťtait
celles de l'opposition et que, dans la Chambre des pairs, mon pŤre
votait avec le ministŤre, ils renoncŤrent ŗ leurs gracieusetťs et
rentrŤrent dans leur froideur habituelle.
Ma mŤre ťtait tombťe dangereusement malade ŗ Douvres et nous donna de
vives inquiťtudes. Elle put enfin passer la mer et nous nous trouv‚mes
rťunis ŗ Paris ŗ notre trŤs grande joie.
Mon pŤre ne tarda pas ŗ ťprouver un peu de l'ennui qui atteint
toujours les hommes ŗ leur sortie de l'activitť des affaires. Son bon
esprit et son admirable caractŤre en triomphŤrent promptement. Il n'y
a pas de situation plus propre ŗ faire naÓtre ce genre de regret que
celle d'un ambassadeur rentrant dans la vie privťe. Toutes ses
relations sont rompues; il est ťtranger aux personnes influentes de
son pays; il n'est plus au courant de ces petits dťtails qui occupent
les hommes au pouvoir, car, aprŤs tout, le commťrage rŤgne parmi eux
comme parmi nous; il s'est accoutumť ŗ attacher du prix aux
distinctions de sociťtť, et elles lui manquent toutes ŗ la fois.
Il n'y a pas de mťtier plus maussade ŗ mon sens, oý l'on joue plus
complŤtement le rŰle de l'‚ne chargť de reliques et oý les honneurs
qu'on reÁoit soient plus indťpendants de toute estime, de toute
valeur, de toute considťration personnelle.
Je sais qu'il est convenu de regarder cette carriŤre comme la plus
agrťable, surtout lorsqu'on arrive au rang d'ambassadeur. Je ne l'ai
connue que dans cette phase et je la proclame dťtestable. Lorsqu'on a
veillť la nuit pour rendre compte des travaux du jour et qu'on a
rťussi dans une nťgociation difficile, ťpineuse, souvent entravťe par
des instructions maladroites tout l'honneur en revient au ministre
qui, dans la phrase entortillťe de quelque dťpÍche, vous a laissť
deviner ses intentions, prťcisťment assez pour pouvoir vous dťsavouer
si vous ťchouez. En revanche, si l'affaire manque et s'ťbruite, on
hausse les ťpaules et vous Ítes proclamť maladroit d'autant plus
facilement que, le secret ťtant la premiŤre loi du mťtier, vous ne
pouvez rien apporter pour votre justification.
J'ai vu la carriŤre diplomatique sous son plus bel aspect, puisque mon
pŤre, occupant la premiŤre ambassade, y a joui de la confiance entiŤre
de son cabinet et d'une grande faveur prŤs de celui de Londres, et
pourtant je la proclame, je le rťpŤte, une des moins agrťables ŗ
suivre.
Je comprends qu'un homme politique, dans les convenances duquel une
absence peut se trouver entrer momentanťment, aille passer quelques
mois avec un caractŤre diplomatique dans une Cour ťtrangŤre.
Rien n'est plus mauvais pour les affaires du pays que de pareils
ambassadeurs qui s'occupent de toute autre chose; mais j'admets
l'agrťment de cette espŤce d'exil. Il ne faut pas toutefois s'y
rťsigner trop longtemps, car aucun genre d'absence n'enlŤve plus
promptement et plus complŤtement la clientŤle.
Nous avons vu monsieur de Serre, le premier orateur de la Chambre, ne
pouvoir Ítre renommť dťputť aprŤs avoir ťtť deux ans ambassadeur ŗ
Naples et en mourir de chagrin. Certainement, s'il avait passť ces
deux annťes ŗ la campagne chez lui, dans une retraite absolue, son
ťlection n'aurait pas ťtť contestťe et sa carriŤre d'homme politique
serait restťe bien plus entiŤre.
Je parle ici pour les hommes ŗ ambition politique, car ceux qui ne
veulent que des places et des appointements ont ťvidemment avantage ŗ
prťfťrer l'ambassade ŗ la retraite; mais aussi, s'ils prolongent leur
absence, ils reviennent, au bout de leur carriŤre, achever dans leur
patrie une vie dťpourvue de tout intťrÍt, ťtrangers ŗ leur famille,
isolťs de tout intimitť et ne s'ťtant formť aucune des habitudes qui,
dans l'‚ge mŻr, supplťent aux goŻts de la jeunesse.
Plus le pays auquel on appartient prťsente de sociabilitť, plus ces
inconvťnients sont rťels. Cela est surtout sensible pour les franÁais
qui vivent en coteries formťes par les sympathies encore plus que par
les rapports de rang ou les alliances de famille. Rien n'est plus
solide que ces liens et rien n'est plus fragile. Ils sont de verre.
Ils peuvent durer ťternellement, un rien peut les briser. Ils ne
rťsistent guŤre ŗ une absence prolongťe. On s'aime toujours beaucoup,
mais on ne s'entend plus. On croit qu'on aura grande joie ŗ se revoir,
et la rťunion amŤne le refroidissement, car on ne parle plus la mÍme
langue, on ne s'intťresse plus aux mÍmes choses. En un mot, on ne se
devine plus. Le lien est brisť. Les franÁais ont si bien l'instinct de
ce mouvement de la sociťtť que nous voyons nos diplomates empressťs de
venir frťquemment s'y retremper; et, de tous les europťens, ce sont
ceux qui rťsident le moins constamment dans les Cours oý ils sont
accrťditťs.
Ces rťflexions, je les faisais alors aussi bien qu'ŗ prťsent, et j'eus
pleine satisfaction ŗ me retrouver _Gros-Jean comme devant_.
Notre _parti pris_ de n'Ítre point hostiles au nouveau ministŤre reÁut
un ťchec par la dťcision de monsieur Decazes de nommer une fournťe de
soixante pairs (6 mars 1819). Ce n'est pas aprŤs avoir retrempť mon
ťducation britannique, pendant trois annťes, dans les brouillards de
Londres que je pouvais envisager de sang-froid une pareille mesure.
Mon pŤre exigeait mon silence, mais il partageait la pensťe que
c'ťtait un coup mortel ŗ la pairie. Il a portť ses fruits, car il ne
serait pas bien difficile de rattacher la destruction de l'hťrťditť ŗ
la crťation de ces ťnormes fournťes dont Decazes a donnť le premier
exemple. La liste de 1815, quoique trŤs nombreuse, porte un caractŤre
tout ŗ fait diffťrent. Il s'agissait de fonder l'institution et non
pas de forcer une majoritť.
Les nominations de 1819 eurent lieu ŗ l'occasion d'une proposition
faite par monsieur de Barthťlemy pour la rťvision de la loi
d'ťlection, loi dont M. Decazes lui-mÍme demanda le rappel peu de mois
aprŤs. Je ne me suis jamais expliquť comment on ťtait parvenu ŗ
obtenir de monsieur de Barthťlemy d'attacher le grelot.
Lorsqu'il s'aperÁut, ŗ la fin, de tout le bruit qu'il faisait, il
pensa en tomber ŗ la renverse. La mÍme chose lui ťtait arrivťe
lorsque, presque ŗ son insu, il s'ťtait trouvť directeur de la
Rťpublique. La chute avait ťtť plus rude ŗ cette occasion puisqu'elle
l'avait envoyť sur les plages insalubres de la Guyane.
Je l'ai beaucoup connu et je n'ai jamais compris ces deux
circonstances de sa vie. C'ťtait le plus honnÍte homme du monde, le
plus probe. Il avait de l'esprit et des connaissances, une
conversation facile et quelquefois piquante; mais il ťtait timide,
mťticuleux, circonspect. Il avait toujours l'inquiťtude de dťplaire et
surtout le besoin de se mettre ŗ la remorque et de se cacher derriŤre
les autres. Jamais homme n'a ťtť moins propre ŗ jouer un rŰle
ostensible et n'a eu moins d'ambition. Loin de tirer importance
d'avoir ťtť _un cinquiŤme de roi_, il ťtait importunť qu'on s'en
souvÓnt.
Lorsque ce qu'on appela la _proposition Barthťlemy_ fit une si
terrible explosion dans la Chambre et dans le public, il en fut
consternť. Je l'ai vu ťpouvantť de faire tout ce vacarme au point d'en
tomber sťrieusement malade. Au reste, ce sont de ces ťvťnements dont
on s'occupe fort pour un moment et qui laissent moins de trace dans le
souvenir qu'ils n'en mťritent peut-Ítre, car souvent ils ont portť le
germe d'une catastrophe que d'autres ťvťnements, ťgalement oubliťs,
ont mŻrie jusqu'ŗ ce qu'une derniŤre circonstance la fasse ťclore tout
ŗ coup.
Nous eŻmes un remaniement du ministŤre avant la fin de l'annťe.
Monsieur Pasquier devint ministre des affaires ťtrangŤres. C'ťtait
rentrer dans les errements du cabinet Richelieu, et mon pŤre en fut
d'autant moins disposť ŗ s'enrŰler sous les drapeaux ultras. Monsieur
Roy arriva aux finances et monsieur de La Tour-Maubourg eut le
portefeuille de la guerre. Il dťploya dans cette nouvelle position la
mÍme honnÍtetť, la mÍme probitť, la mÍme incapacitť qu'il avait
portťes ŗ Londres.
Mes frťquents voyages en Angleterre m'avaient empÍchťe d'aller en
Savoie. Je profitai de l'ťtť de 1819 pour faire une visite ŗ monsieur
de Boigne et prendre les eaux d'Aix.
Au commencement de l'hiver, je vins m'ťtablir avec mes parents dans
une maison que j'avais louťe dans la rue de Bourbon. C'est lŗ oý j'ai
passť les dix annťes qui ont prťparť et amenť la chute de cette
Restauration que j'avais appelťe de voeux si ardents et vu commencer
avec des espťrances si riantes.
TABLE DES MATI»RES
CINQUI»ME PARTIE
1815
CHAPITRE I
Sťjour en Piťmont. -- Restauration de 1815. -- Passage ŗ
Lyon. -- Marion. -- Arrivťe ŗ Turin. -- Dispositions du Roi.
-- Son gouvernement. -- Le cabinet d'ornithologie. -- Le
comte de Roburent. -- Les _Biglietto regio_. -- La sociťtť.
-- Le lustre. -- Les loges. -- Le thť‚tre. -- L'Opťra. --
Dťtail de moeurs. -- Le marquis del Borgo. 1
CHAPITRE II
Les visites ŗ Turin. -- Le comte et la comtesse de Balbe. --
Monsieur DauzŤre. -- Le prince de Carignan. -- Le corps
diplomatique. -- Le gťnťral Bubna. -- Ennui de Turin. --
Aspect de la ville. -- Appartements qu'on y trouve. --
Rťunion de GÍnes au Piťmont. -- DÓner donnť par le comte de
Valese. -- Jules de Polignac. 17
CHAPITRE III
Rťvťlation des projets bonapartistes. -- Voyage ŗ GÍnes. --
Expťrience des fusťes ŗ la congrŤve. -- La princesse
Grassalcowics. -- L'empereur Napolťon quitte l'Óle d'Elbe.
-- Il dťbarque en France. -- Officier envoyť par le gťnťral
Marchand. -- Dťclaration du 13 mars. -- Mon frŤre la porte ŗ
monsieur le duc d'AngoulÍme. -- La duchesse de Lucques. 30
CHAPITRE IV
La princesse de Galles. -- FÍte donnťe au roi Murat. --
Audience de la princesse. -- Notre situation est pťnible. --
Message de monsieur le duc d'AngoulÍme. -- Inquiťtudes pour
mon frŤre. -- Marche de Murat. -- Il est battu ŗ
Occhiobello. -- L'abbť de Janson. -- Henri de Chastellux. 42
CHAPITRE V
Retour ŗ Turin. -- Monsieur de La BťdoyŤre. -- Marche de
Cannes. -- L'empereur Napolťon. -- Exposition du
Saint-Suaire. -- Retour de Jules de Polignac. -- Il est fait
prisonnier ŗ Montmťlian. -- Prise d'un rťgiment ŗ
Aiguebelle. -- Conduite du gťnťral Bubna. -- Haine des
piťmontais contre les autrichiens. -- Espťrances du roi de
Sardaigne. 52
CHAPITRE VI
Rťponse de mon pŤre au premier chambellan du duc de ModŤne.
-- Conduite du marťchal Suchet ŗ Lyon. -- Conduite du
marťchal Brune ŗ Toulon. -- Catastrophe d'Avignon. --
Expulsion des franÁais rťsidant en Piťmont. -- Je quitte
Turin. -- …tat de la Savoie. -- Passage de Monsieur ŗ
Chambťry. -- FÍte de la Saint-Louis ŗ Lyon. -- Pťnible aveu.
-- Gendarmes rťcompensťs par l'Empereur. -- Les soldats de
l'armťe de la Loire. -- Leur belle attitude. 64
CHAPITRE VII
Madame de La BťdoyŤre. -- Son courage. -- Son dťsespoir. --
Sa rťsignation. -- La comtesse de KrŁdener. -- Elle me fait
une singuliŤre rťception. -- Rťcit de son arrivťe ŗ
Heidelberg. -- Son influence sur l'empereur Alexandre. --
Elle l'exerce en faveur de monsieur de La BťdoyŤre. --
Saillie de monsieur de Sabran. -- Pacte de la
Sainte-Alliance. -- Soumission de Benjamin Constant ŗ madame
de KrŁdener. -- Son amour pour madame Rťcamier. -- Sa
conduite au 20 mars. -- Sa lettre au roi Louis XVIII. 76
CHAPITRE VIII
Exigences des ťtrangers en 1815. -- Dispositions de
l'empereur Alexandre au commencement de la campagne. --
Jolie rťponse du gťnťral Pozzo ŗ Bernadotte. -- Conduite du
duc de Wellington et du gťnťral Pozzo. -- …tonnement de
l'empereur Alexandre. -- Sťjour du Roi et des princes en
Belgique. -- …nergie d'un soldat. -- Obligeance du prince de
Talleyrand. -- Le duc de Wellington dťpouille le musťe. --
Le salon de la duchesse de Duras. -- Mort d'Hombert de La
Tour du Pin. -- Chambre dite introuvable. -- Dťmission de
monsieur de Talleyrand. -- Mon pŤre est nommť ambassadeur ŗ
Londres. -- Le duc de Richelieu. -- Rťvťlation du docteur
Marshall. -- Visite au duc de Richelieu. -- Dťsobligeante
rťception. -- Son excuse. 89
CHAPITRE IX
Nobles adieux de l'empereur Alexandre au duc de Richelieu.
-- Sentiments patriotiques du duc. -- Ridicules de monsieur
de Vaublanc. -- Arrivťe de mon pŤre ŗ Paris. -- ProcŤs du
marťchal Ney. -- Son exťcution. -- Exaltation du parti
royaliste. -- ProcŤs de monsieur de La Valette. -- Madame la
duchesse d'AngoulÍme s'engage ŗ demander sa gr‚ce. -- On
l'en dťtourne. -- Dťmarches faites par le duc de Raguse. --
Il fait entrer madame de La Valette dans le palais. -- Sa
disgr‚ce. -- Fureur du parti royaliste ŗ l'ťvasion de
monsieur de La Valette. 108
CHAPITRE X
FÍtes donnťes par le duc de Wellington. -- Monsieur le duc
d'AngoulÍme. -- Refus d'une grande-duchesse pour monsieur le
duc de Berry. -- On se dťcide pour une princesse de Naples.
-- Traitement d'une ambassadrice d'Angleterre. -- Faveur de
monsieur Decazes. -- Monsieur de Polignac refuse de prÍter
serment comme pair. -- Mot de monsieur de Fontanes. --
Sťjour de la famille d'Orlťans en Angleterre. -- Demande de
madame la duchesse d'Orlťans douairiŤre au marquis de
RiviŤre. 119
SIXI»ME PARTIE
L'ANGLETERRE ET LA FRANCE (1816 ŗ 1820)
CHAPITRE I
Retour en Angleterre. -- Aspect de la campagne. -- Londres.
-- Concert ŗ la Cour. -- Ma prťsentation. -- La reine
Charlotte. -- …gards du prince rťgent pour elle. -- La
duchesse d'York. -- La princesse Charlotte de Galles. --
Miss Mercer. -- Intrigue dťjouťe par le prince Lťopold de
Saxe-Cobourg. -- La marquise d'Hertford. -- Habitudes du
prince rťgent. -- DÓners ŗ Carlton House. 133
CHAPITRE II
Le corps diplomatique. -- La comtesse de Lieven. -- La
princesse Paul Esterhazy. -- Vie des femmes anglaises. --
Leur enfance. -- Leur jeunesse. -- Leur ‚ge mŻr. -- Leur
vieillesse. -- Leur mort. -- Sort des veuves. 146
CHAPITRE III
Indťpendance du caractŤre des anglais. -- DÓner chez la
comtesse Dunmore. -- Jugement portť sur lady George
Beresford. -- Salon des grandes dames. -- Comment on
comprend la sociťtť en Angleterre et en France. -- Bal donnť
chez le marquis d'Anglesey. -- Lady Caroline Lamb. --
Mariage de monsieur le duc de Berry. -- Rťponse du prince de
Poix. 155
CHAPITRE IV
La famille d'Orlťans ŗ Twickenham. -- Espionnage exercť
contre elle. -- Division entre le roi Louis XVIII et
monsieur le duc d'Orlťans ŗ Lille en 1815. -- Intťrieur de
Twickenham. -- Mots de la princesse Marie. -- La comtesse de
Vťrac. -- Naissance d'une princesse d'Orlťans. -- La
comtesse Mťlanie de Montjoie. -- Le baron de Montmorency. --
Le comte Camille de Sainte-Aldegonde. -- Le baron Athalin.
-- Monsieur le duc de Bourbon. -- La princesse Louise de
Condť. 164
CHAPITRE V
Lord Castlereagh. -- Lady Castlereagh. -- Cray Farm. --
Dťvouement de lady Castlereagh pour son mari. -- Accident et
prudence. -- Soupers de lady Castlereagh. -- Partie de
campagne chez lady Liverpool. -- Ma toilette ŗ la Cour de la
Reine. -- Beautť de cette assemblťe. -- BaptÍme de la petite
princesse d'Orlťans. -- La princesse de Talleyrand. -- Elle
consent ŗ se sťparer du prince de Talleyrand. -- La comtesse
de Pťrigord. -- La duchesse de Courlande. -- La princesse
Tyszkiewicz. -- Mariage de Jules de Polignac. 172
CHAPITRE VI
Ordonnance qui casse la Chambre. -- Rťflexion de la
vicomtesse de Vaudreuil ŗ ce sujet. -- Nťgociation avec les
ministres anglais. -- Opposition du duc de Wellington. --
Embarras pour fonder le crťdit. -- Mon retour ŗ Paris. --
Exaltation des partis. -- Brochure de monsieur Guizot. --
Regrets d'une femme du parti ultra-royaliste. -- Monsieur
Lainť qualifiť de bonnet rouge. -- Griefs des royalistes. --
Licenciement des corps de la maison du Roi. -- Le colonel
Pothier et monsieur de Girardin. -- Les quasi-royalistes. --
Soirťe chez madame de Duras. -- La coterie dite _le
ch‚teau_. -- Monsieur de Chateaubriand veut quitter la
France. -- Il vend le Val du Loup au vicomte de Montmorency.
-- Propos tenu par le prince de Poix ŗ monsieur Decazes. 185
CHAPITRE VII
Nťgociations pour un emprunt. -- Ouvrard va en Angleterre.
-- Il amŤne monsieur Baring chez mon pŤre. -- Confťrence
avec lord Castlereagh. -- Arrivťe de messieurs Baring et
LabouchŤre ŗ Paris. -- Espťrances trompťes. -- DÓner chez la
marťchale Moreau. -- Brochure de Salvandy. -- Influence du
gťnťral Pozzo sur le duc de Wellington. -- Soirťe chez la
duchesse d'Escars. -- Monsieur Rubichon. -- L'emprunt ťtant
conclu, l'opposition s'en plaint. 198
CHAPITRE VIII
Madame la duchesse de Berry. -- La duchesse de Reggio. -- Le
mariage de mon frŤre avec mademoiselle DestilliŤres est
convenu. -- ScŤne aux Tuileries. -- Le Roi en est malade. --
Le _Manuscrit de Sainte-HťlŤne_. -- Lectures chez mesdames
de Duras et d'Escars. -- SuccŤs de cette publication
apocryphe. 208
CHAPITRE IX
Monsieur de VillŤle. -- Intrigue de Cour pour ramener
monsieur de Blacas. -- La duchesse de Narbonne. -- Martin et
la soeur Rťcolette. -- Arrivťe de monsieur de Blacas. --
Dťjeuner aux Tuileries. -- La petite chienne de Madame. --
Sagesse de monsieur le duc d'AngoulÍme. -- Agitation des
courtisans. -- Trouble de monsieur Molť. -- Bonne contenance
de monsieur Decazes. -- Dťlais multipliťs de monsieur de
Blacas. -- Il est congťdiť par le Roi. 218
CHAPITRE X
Faveur de monsieur Decazes. -- Son genre de flatterie. --
Affaires de Lyon. -- Le duc de Raguse apaise les esprits. --
Discours de monsieur Laffitte. -- Monsieur le duc d'Orlťans
revient ŗ Paris. -- Histoire inventťe sur ma mŤre. -- Ma
colŤre. -- Arrivťe de toute la famille d'Orlťans. --
Dťjeuner au Palais-Royal. -- Calomnies absurdes. 229
CHAPITRE XI
Tom Pelham. -- Inauguration du pont de Waterloo. -- DÓner ŗ
Claremont. -- Maussaderie de la princesse Charlotte. -- Son
obligeance. -- Un nouveau caprice. -- Conversation avec
elle. -- Mort de cette princesse. -- Affliction gťnťrale. --
CaractŤre de la princesse Charlotte. -- Ses goŻts, ses
habitudes. -- Suicide de l'accoucheur. -- Singulier conseil
de lord Liverpool. -- Maxime de lord Sidmouth. 236
CHAPITRE XII
Le roi de Prusse veut ťpouser Georgine Dillon. -- Rupture de
ce mariage. -- Dťsobligeance du roi Louis XVIII pour les
Orlťans. -- Il la tťmoigne en diverses occasions. --
Irritation qui en rťsulte. -- Le comte de La Ferronays. --
Son attachement pour monsieur le duc de Berry. -- Madame de
Montsoreau et la layette. -- ScŤne entre monsieur le duc de
Berry et monsieur de La Ferronnays. -- Irritation de la
famille royale. -- Madame de Gontaut nommťe gouvernante. --
Conseils du prince Castelcicala. -- Madame de Noailles. 249
CHAPITRE XIII
Je refuse d'aller chez une devineresse. -- Aventure du
chevalier de Mastyns. -- …lections de 1817. -- Le parti
royaliste sous l'influence de monsieur de VillŤle. -- Le duc
de Broglie et Benjamin Constant. -- Monsieur de
Chateaubriand appelle l'opposition de gauche _les libťraux_.
-- Mariage de mon frŤre. -- Visite ŗ Brighton. -- Soigneuse
hospitalitť du prince rťgent. -- Usages du pavillon royal.
-- Rťcit d'une visite du Rťgent au roi George III. --
Dťjeuner sur l'escalier. -- Le grand-duc Nicolas ŗ Brighton. 259
CHAPITRE XIV
Je fais naufrage sur la cŰte entre Boulogne et Calais. --
Effet de cet accident. -- Excellent propos de Monsieur. --
SinguliŤre conversation de Monsieur avec …douard Dillon. --
La loi de recrutement. -- Les pairs ayant des charges chez
le Roi votent contre le ministŤre. -- Rťponse de monsieur
Canning ŗ ce sujet. -- Le Pape et monsieur de Marcellus. 272
CHAPITRE XV
Coup de pistolet tirť au duc de Wellington. -- On trouve
l'assassin. -- Inquiťtude de Monsieur sur la retraite des
ťtrangers. -- Agitation dans les esprits. -- TťnŤbres ŗ la
chapelle des Tuileries. -- Le duc de Rohan ŗ Saint-Sulpice.
-- Ses ridicules. -- Le duc de Rohan se fait prÍtre. -- Une
aventure ŗ Naples. -- Faveur du prince de Talleyrand. -- Bal
chez le duc de Wellington. -- Testament de la reine
Marie-Antoinette. -- Mort de la petite princesse d'Orlťans,
nťe ŗ Twickenham. -- Mort de monsieur le prince de Condť. --
Son oraison funŤbre. 281
CHAPITRE XVI
Mort de madame de StaŽl. -- Effet de son ouvrage sur la
Rťvolution. -- Je retourne ŗ Londres. -- Agents du parti
ultra. -- Prťsentation de la note secrŤte. -- Le Roi Űte le
commandement des gardes nationales ŗ Monsieur. -- Fureur de
Jules de Polignac. -- Conspiration du bord de l'eau. --
CongrŤs d'Aix-la-Chapelle. -- Le duc de Richelieu obtient la
libťration du territoire. 293
CHAPITRE XVII
Le comte Decazes veut changer de ministŤre. -- Intrigues
contre le duc de Richelieu. -- Il donne sa dťmission. -- Le
gťnťral Dessolle lui succŤde. -- Mariage de monsieur
Decazes. -- Le comte de Sainte-Aulaire. -- Mon pŤre demande
ŗ se retirer. -- Il est remplacť par le marquis de La
Tour-Maubourg. -- Le Roi est mťcontent de mon pŤre. -- Mes
idťes sur la carriŤre diplomatique. -- Une fournťe de pairs.
-- Monsieur de Barthťlemy. 302
CHARTRES.--IMPRIMERIE DURAND, RUE FULBERT.
End of the Project Gutenberg EBook of Rťcits d'une tante (Vol. 2 de 4), by
Louise-Elťonore-Charlotte-Adťlaide d'Osmond, comtesse de Boigne
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK R…CITS D'UNE TANTE (VOL. 2 DE 4) ***
***** This file should be named 32348-8.txt or 32348-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/3/2/3/4/32348/
Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by the
BibliothŤque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr) and Internet Archive.
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

Récits d'une tante (Vol. 2 de 4) - Mémoires de la Comtesse de Boigne, née d'Osmond
Subjects:
Download Formats:
Excerpt
The Project Gutenberg EBook of Rťcits d'une tante (Vol. 2 de 4), by
Louise-Elťonore-Charlotte-Adťlaide d'Osmond, comtesse de Boigne
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Rťcits d'une tante (Vol. 2 de 4)
Mťmoires de la Comtesse de Boigne, nťe d'Osmond
Author:...
Read the Full Text
— End of Récits d'une tante (Vol. 2 de 4) - Mémoires de la Comtesse de Boigne, née d'Osmond —
Book Information
- Title
- Récits d'une tante (Vol. 2 de 4) - Mémoires de la Comtesse de Boigne, née d'Osmond
- Author(s)
- Boigne, Louise-Eléonore-Charlotte-Adélaide d'Osmond, comtesse de
- Language
- French
- Type
- Text
- Release Date
- May 12, 2010
- Word Count
- 98,807 words
- Library of Congress Classification
- DC
- Bookshelves
- FR Biographie, Mémoires, Journal intime, Correspondance, FR Femmes, Browsing: Biographies, Browsing: Culture/Civilization/Society, Browsing: History - European
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books
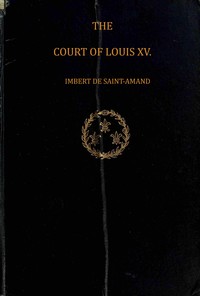
The court of Louis XV
by Imbert de Saint-Amand
English
1177h 50m read
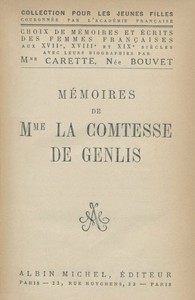
Mémoires de Mme la Comtesse de Genlis
by Genlis, Stéphanie Félicité, comtesse de
French
1696h 8m read
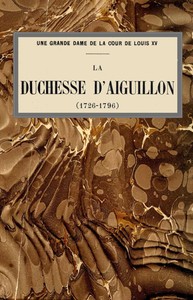
Une grande dame de la cour de Louis XV: La duchesse d'Aiguillon (1726-1796)
by Estrée, Paul d', Callet, Albert
French
2110h 25m read

L'affaire du bonnet et les Mémoires de Saint-Simon
by Grellet-Dumazeau, André
French
1392h 43m read
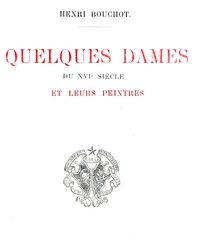
Quelques dames du XVIe siècle et leurs peintres
by Bouchot, Henri
French
463h 16m read
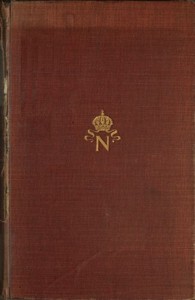
The Comedy & Tragedy of the Second Empire - Paris Society in the Sixties; Including Letters of Napoleon III., M. Pietri, and Comte de la Chapelle, and Portraits of the Period
by Legge, Edward
English
1995h 27m read